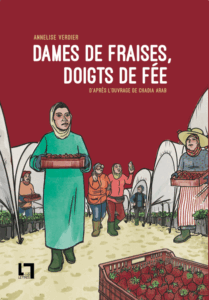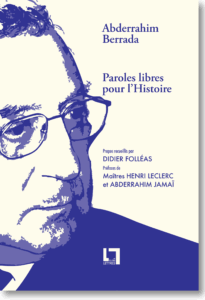Histoire d’un pionnier
Ahmed Fertat retrace la vie de Mohamed Osfour, père du cinéma marocain. Un parcours de volonté envers et contre tout.
« À lui la gloire du titre. Mais à quel prix ? » Ainsi s’interroge Ahmed Fertat à la fin de la passionnante biographie qu’il consacre à Mohamed Ben Ali Osfour, dans une belle et amère réflexion sur la question de la reconnaissance. « C’est une situation paradoxale que celle de ces hommes qui deviennent des mythes de leur vivant, élevés sur des piédestaux et qui, d’une part, sont satisfaits de la reconnaissance qu’on leur manifeste, mais qui, d’autre part, mènent, dans l’isolement et parfois le dénuement, une vie quotidienne médiocre et grise. » La reconnaissance ne serait-elle pas, surtout quand elle est tardive, l’envers du regret ? Mohamed Osfour a été le pionnier du 7ème art au Maroc. « Homme du dépassement, homme-patrimoine et homme-orchestre », il « a tant donné et si peu reçu », note non sans amertume son biographe, en considérant toutes les œuvres inachevées faute de soutien. Mais ce qu’il choisit de retenir, c’est comment ce petit homme vif a donné au cinéma marocain « une profondeur temporelle qui constitue un précieux ancrage dans l’Histoire ».
Dans l’Histoire
L’histoire de Mohamed Osfour est celle d’une infatigable volonté, contre vents et marées et dans la solitude. En été 1941, tout jeune adolescent, il plante deux piquets dans un café de Derb Ghallef, tend une toile blanche, et projette son premier film, Ibn al-Ghaba. Pour les spectateurs, à peine plus âgés que lui, il devient Tchikio ou Tarzane al maghribi. Osfour, c’est son surnom, dû à sa petite taille, et qu’il adoptera à l’état civil. Pour assouvir sa soif de cinéma, donc pouvoir y entrer gratuitement, il avait proposé au gérant de lui faire de la publicité. Passionné de technique, l’enfant jamais scolarisé n’hésitait pas à poser toutes les questions, à travailler pour se payer une caméra. Pour projeter son premier film tourné avec ses copains, il propose au tenancier du café d’augmenter le prix du thé et de partager la recette. En 1946, il participe à des tournages, même ceux où il n’est pas recruté officiellement, pour apprendre le métier. Il se fait remarquer sur celui de La rose noire, superproduction américaine, par l’électricien qui déclare au régisseur : « Débrouille-toi pour l’engager, ce sont des éléments pareils que vous devez chercher si vous voulez terminer votre foutu film ». Plus tard, assisté de sa femme Magdalena, « tour à tour actrice, camérawoman, assistante, accessoiriste », il affirme une voix singulière, qui le fait qualifier de « Méliès des pauvres », de « Walt Disney des pauvres ». D’autant que les évolutions du cinéma, ne laissant « plus de place à l’artisanat », on fait que « seul le théâtre existait en tant que spectacle moderne fait par et avec des Marocains ». Ahmed Fertat estime que « son originalité, c’est qu’il a mené un travail de professionnel par l’usage qu’il a fait d’un produit d’amateur ». Débrouillard, il a bricolé son propre circuit, s’est imposé comme le premier producteur indépendant. Pour faire Robin des Bois, Aïssa de l’Atlas, Joha… et surtout, dans l’espoir de réaliser son premier long métrage en 35mm, il n’a pas hésité à faire des tests pour pouvoir récupérer une pellicule périmée, et a travaillé sur d’innombrables productions, nationales et internationales, qui lui ont donné un regard pertinent sur le cinéma de son époque. Il rêvait de créer une école de techniciens de cinéma. Ahmed Fertat laisse entendre tout ce qu’il aurait pu réaliser dans un contexte plus favorable…
Et vous, vous lisez quoi ?
Kenza Sefrioui
Osfour, une passion nommée cinéma
Ahmed Fertat
Kulte éditions, 444 p. (226 p. en français, 218 p. en arabe, traduit par Abdelilah Khattabi), 200 DH