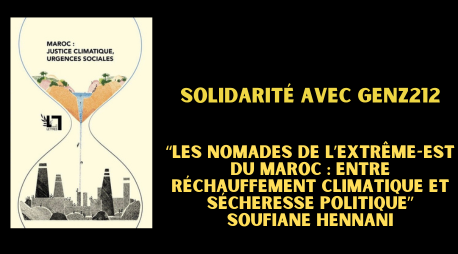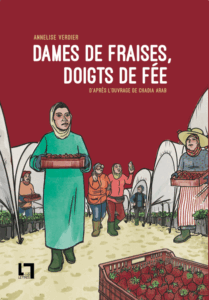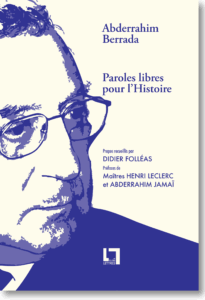Les nomades de l’extrême-est du Maroc: entre réchauffement climatique et sécheresse politique
En solidarité avec les revendications pacifiques et légitimes de justice sociale du mouvement GenZ212, En toutes lettres vous donne accès libre à plusieurs textes parus dans la collection Enquêtes, qui témoignent des conditions de vie indignes de nos concitoyens.
« « Les nomades sont des Sindbad. Ils sont le contraire des cowboys, ceux qui occupent les terres. Ils apportent la marchandise et le savoir. Être nomade c’est positif et pas négatif. »
Fatema Mernissi, Aljazeera, 10 juillet 2014
De Casablanca à Oujda, de Oujda à Bouaarfa et de Bouaarfa à Figuig, la route est longue, plate et ennuyeuse. Dans le bus, passé le col de Taza, les paysages lunaires, semi-désertiques apparaissant à la lueur de l’aube, je pensais à ces nomades qui, bien que vivant loin de notre système de consommation effrénée, étaient les plus affectés par les changements climatiques, la sécheresse, la pauvreté dont nous étions probablement responsables.
Une population vivant en marge de la société, en marge du système de santé, en marge du système d’éducation, de l’entraide nationale, de la vie tout simplement. Une population méconnue par le reste de ses concitoyens dont une grande partie ignore même l’existence. Vivant principalement de l’élevage de bétail, des clans et parfois des tribus entières se déplacent constamment, sur des centaines voire des milliers de kilomètres à la recherche de zones de pâturage et de points d’eau. En plus du caractère déjà précaire de leur existence, les périodes de grandes sécheresses, de plus en plus fréquentes, ont décimé une grande partie des cheptels. Certains, particulièrement dans le Sud, se sont convertis à l’écotourisme, à la vente de produits artisanaux ou à la recherche de météorites ou de pierres fossiles, avec pour principaux clients des touristes étrangers. La crise sanitaire liée à la Covid 19, réduisant à néant les flux de voyageurs, a fait disparaître cette rentrée d’argent aussi maigre qu’aléatoire.
Dans l’étendue des steppes de l’est marocain et de l’ouest algérien, la région où je me rends vit dans un isolement qui a durement impacté les populations nomades ou sédentaires qui y vivent depuis des siècles. Le tracé puis la fermeture des frontières entre les deux pays a modifié en profondeur leur mode de vie en remodelant le territoire et par là même le destin des tribus nomades. De Figuig à Bouarfa en passant par Tendrara, Maatarka, Beni Guil, Abou Lakhal, Ain Chouater, Bouanane, Bouchaouene, Boumerieme, Talsint et Beni Tadjit, la région est devenue une impasse, une enclave cernée par des massifs montagneux, culminant aux environs de 2 000 mètres au nord (Jebel Amour) et à l’ouest (Jebel Grouz). La ville de Figuig, chef-lieu de la région est située à 400 km au sud d’Oujda, à100 km à l’est de la ville marocaine la plus proche, Bouarfa, à peu près à même distance de la ville algérienne de Béchar, et à 7 km de Beni Ounif, ancien ksar dépendant de Figuig devenu ville frontière algérienne. Le tracé de la frontière a eu d’autres effets climatiques sur la région, puisqu’elle s’est retrouvée progressivement amputée d’une partie de ses ressources hydro-agricoles. Par ailleurs la région souffre de la hausse des températures moyennes annuelles et de la diminution des précipitations, qui entraînent sécheresse et désertification. Les oasis perdent des parties considérables de leurs surfaces de culture. La surexploitation de l’eau dans l’agriculture aggrave ces conséquences néfastes, malgré un système de partage de l’eau vertueux et ancestral, assuré par des codes sociaux et un réseau complexe, alimenté par des séguias et des bassins de stockage et de régulation. Pour les nomades, la problématique est dans la raréfaction des points d’eau. Bien que le gouvernement ait installé des points de récupération des eaux de pluie en leur faveur dans les communes de Tandrara, Jbal Lkelkha, Hammou ouarzak et Chaab Ain Chair, ceux-ci restent dépendants d’une pluviométrie aléatoire.
Entre Bouaarfa et Figuig, le bus tombe en panne. Un mal pour un bien. Je descends prendre l’air. Deux vieux messieurs en jellaba et turban font de même. Ce fut ma première rencontre avec les nomades.
M’hamed* et El Khadir* s’inquiètent d’arriver en retard au souk d’Abou L’khal à une dizaine de kilomètres de Figuig. Il faut dire que le rendez-vous est d’une grande importance pour eux. Ils m’expliquent que c’était l’un des plus grands rassemblements de nomades pour s’échanger ou vendre leur bétail. Mais ça, c’était avant la crise, précise M’hamed. « Aujourd’hui, il n’y a presque plus de bétail et une grande partie des nomades se sont installés à Figuig ou aux alentours. Le souk n’est plus qu’un lieu de petits négoces et de rencontres nostalgiques. » Tandis que le chauffeur tente toujours de faire redémarrer le vieux bus, aidé par quelques volontaires, je continue la discussion avec mes deux compagnons de route qui m’expliquent avec bienveillance toute l’organisation des nomades de la région, les tribus principales (Beni Guil et les Amor), les points de rencontres autour des puits, les conflits entre clans autour de points d’eau de plus en plus rares, le mépris des populations sédentaires, le système des castes à Figuig et à Bouâarfa… Bref, une véritable leçon d’histoire et de géographie que nos manuels scolaires ont omis de nous apprendre.
Je comprends également que les alertes et les discours alarmistes sur le changement climatique que nous écoutons dans les médias sont déjà une réalité dont souffre cette population qui a vu son mode de vie complètement chamboulé en quelques décennies. Si dans le monde citadin, certains ont peur du réchauffement climatique dans les années qui viennent, je rencontrais ceux qui en souffraient déjà.
M’hamed et El Khadir descendent à Abou L’khal. Le souk est fini visiblement. Ils reviendront dans une semaine. Retrouver leurs amis et tenter de gagner un peu de sous.
À la tombée de la nuit, nous arrivons cahin-caha à Figuig… Je m’en vais à la recherche d’un hôtel dans une ville quasi déserte. Le lendemain matin, je me renseigne auprès du réceptionniste de l’hôtel, qui proposa gentiment de m’emmener dans le quartier des Filalas* à la périphérie de Figuig où, selon lui, résident les nomades sédentarisés. J’aborde la première personne que je rencontre dans ce quartier, où persistent quelques tentes bédouines faites de morceaux de tapis mille fois rapiécés, et d’autres matériaux tout aussi disparates que précaires, disséminées entre de modestes maisons en parpaing. Nous sommes loin de l’image de carte postale vendue par les agences de tourisme, qui vantent les traditions millénaires de nomades photogéniques. L’insalubrité est évidente et les conditions de vie, ou de survie, sont visiblement des plus pénibles. Un quartier de transition où la modernité offre son visage le plus laid. Mon interlocuteur me désigne une personne, qui se reposait couchée à même le sol, couvert de sa seule djellaba de laine.
Mohamed a 40 ans et vit à douar Halouf, dans la commune de Abou L’khal. Il semble intrigué de me voir m’intéresser à lui. « Les seules personnes qui viennent nous voir sont les agents de recensements. “Combien avez-vous d’enfants ? Vous avez plusieurs épouses ? Vos enfants vont-ils à l’école ?” C’est tout ce qu’ils nous demandent. Ils ne veulent pas savoir comment je fais pour nourrir mes enfants, comment on fait pour supporter le froid toujours présent, la pluie qui se fait de plus en plus rare, et la sécheresse qui nous a enlevé le peu de bétail qu’on avait et qui nous a tués. Nous n’avons plus rien, si ce n’est le vide et l’ennui », me dit-il avec amertume. Pour lui, le principal problème reste les fossés installés par le gouvernement pour sécuriser les frontières. « Ce sont ces fossés qui nous achèvent, nous empêchent de circuler et nous bloquent dans ce périmètre », précise-t-il. Il se remémore l’époque où les siens pouvaient bouger, aller au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, à la recherche de l’eau et du soleil. « Nous ne possédions pas de terre. Mais la terre nous appartenait », me confie-t-il. Il évoque également les tensions avec les gens de la ville Figuig : « Nous sommes acculés à rester autour de Figuig. Les Figuiguis ne nous détestent pas, mais ils n’aiment pas notre mode de vie. » Certains des Amor appartenant à la tribu de M’hamed ont toutefois décidé de s’installer définitivement dans la ville. « Beaucoup vivent désormais dans le bas Figuig. Le Figuig des riches. Il y a de cela bien des années, ils se sont définitivement sédentarisés, ils ont appris à vivre comme eux. Ils se sont même mariés avec eux. Certaines familles amazighs d’ici s’allient avec des nomades car nous sommes des chorfas descendant du Prophète », explique M’hamed. L’alliance avec les Znaga, un clan de Figuiguis, a du bon. «Ces familles, à Znaga, possèdent des terres et vivent de la production des dattes, ils s’en sortent très bien et envoient toujours leurs enfants faire leurs études ailleurs, à l’étranger, à Meknès, Rabat ou Casablanca. Nous, on est restés sur la route. Nous n’avons pas de terres et nous vivons encore à la manière de nos grands-parents. Je suis probablement l’un des derniers vrais nomades. Nos enfants trouvent cette vie beaucoup plus dure. Dans dix ans, il n’y aura probablement plus rien, mais c’est Allah qui donne et qui reprend », déplore M’hamed.
Après deux nuits à Figuig, je reprends le vieux bus pour parcourir les quelques quatre-vingts kilomètres qui séparent la ville de Bouaarfa, le fief des Bni-guils, l’autre tribu nomade de la région. Dès mon arrivée, je rencontre Hamid, serveur dans un snack de la ville. Fils de nomade, Hamid m’invite dans son quartier où se regroupent plusieurs familles de nomades et semi-nomades. Un quartier à la périphérie de la ville, qui porte bien son nom, « Lahouna », ce qui veut dire « on nous a jetés dehors ». Il s’agit en effet d’un quartier dortoir tout récent, financé, selon Hamid, par un prince émirati pour caser les familles de nomades qui occupaient les terrains où cet émir avait décidé d’installer une réserve privée de chasse. Avant même d’arriver dans le quartier, une odeur pestilentielle nous prend à la gorge. Il s’agit d’une décharge sauvage au milieu des habitations, où brûlent des ordures. Tout autour de la décharge, des maisons de parpaing côtoient des cabanes en tôle. Des enfants à peine vêtus, sans chaussures aux pieds, jouent dehors alors que bétail et volaille circulent dans les ruelles aux égouts à ciel ouvert.
Hamid me présente Souadiya… Assise sur le perron de sa maison de fortune, Souadiya, 44 ans, mère de cinq enfants, semble désabusée. Elle n’attend plus rien de la vie, sinon un meilleur destin pour ses filles. Pourtant, contrairement à beaucoup de filles de sa tribu, elle a été à l’école. Son père pensait qu’elle serait mieux armée pour la vie. « Mon mari me reproche d’avoir été à l’école au lieu d’avoir appris un vrai métier de nomade : travailler la laine, faire du tissage et des tapis. C’est mon père qui a voulu que j’apprenne à lire et à écrire. Il pensait que j’aurais un avenir meilleur et me voilà aujourd’hui coincée dans ce bidonville pourri. Quand j’étais petite, les choses étaient plus simples. Nous étions de vrais nomades. Nous étions sur la route et nous nous installions là où la nature était clémente. Nous n’allions pas à l’école, c’était l’école qui venait à nous. Dans les années soixante-dix, quatre-vingt, l’État nous envoyait des enseignants là où nous étions. Nous étions toujours pauvres mais la vie était plus facile ». Le mari de Souadya refuse que ses filles aillent à l’école, contrairement aux garçons qui sont scolarisés : « Elles apprendront à tisser les tentes et à nouer des tapis, puis se marieront. C’est leur destin. J’ai essayé de raisonner leur père. Mais il ne veut rien entendre. D’ici quelques années, je suis certaine que le métier de tissage ne leur servira plus à rien. Avec la sécheresse d’un côté, et les barrières qui nous empêchent de circuler, personne n’aura plus besoin de ces maudites tentes », dit-elle. Le seul espoir de Souadya est que ses filles épousent des hommes de la ville, qui les emmèneront loin d’ici, et qu’elles échappent à un destin tout tracé, loin de cette misère : « Les hommes ici n’ont aucune considération pour les femmes. Ils en épousent plusieurs et leur font une flopée d’enfants. Certains dans le passé en avaient même plus que quatre. Mon beau-père en a eu sept. Et mon mari ne connaît même pas tous ses demi-frères tellement ils sont nombreux. »
Le lendemain matin, sur les conseils de Hamid, je prends la route de Tizgi, une piste caillouteuse qui s’enfonce d’une dizaine de kilomètres de la ville de Bouârfa. Pour seul moyen de locomotion, j’ai trouvé un pick-up, ces fameuses Honda qui servent à transporter marchandises, bétail et voyageurs. Mon chauffeur m’explique que c’était le point de rencontre de tous les Beni-Guil.
Sur la route, je rencontre Boujmaa, conduisant sa charrette. L’allure fière, le visage émacié, lunettes noires et turban sur la tête, le jeune trentenaire doit parcourir chaque jour une dizaine de kilomètres pour chercher une eau de plus en plus rare. Je décide de l’accompagner au puits. Le courant est vite passé entre nous. Celui qui deviendra mon ami m’invite à boire le thé sous la tente familiale. Boujamaa est le nomade d’aujourd’hui. Âgé d’à peine 29 ans, il garde intactes toutes les traditions de ses ancêtres, dont la principale est l’hospitalité, mais nourrit aussi de grands rêves. Voyager, voir le monde et surtout sortir ses deux enfants de la misère. Son bien le plus précieux reste son vieux smartphone, avec lequel il reste connecté au monde.
Mais les temps sont durs. Boujamaa et sa famille vivent dans le dénuement le plus total. Il espère avoir une maison en dur et quitter sa tente qui d’après lui n’est plus du tout adaptée aux conditions de vie d’aujourd’hui. Un espoir d’un avenir meilleur, d’un minimum de confort pour ses enfants, d’une vie modeste et digne… Voilà en quoi consistent ses aspirations les plus ambitieuses. Pourtant, chez Boujamaa, comme chez toutes les personnes que j’ai rencontrées, une même impression restera gravée dans mon esprit : la fierté singulière des populations nomades. Ils ne demandent rien, offrent le peu qu’ils ont, sont patients, voire même fatalistes, humbles, et font preuve d’une hospitalité hors norme. C’est autour d’un bon verre de thé et d’un plat de msemen gargantuesque que la conversation se poursuit.
« Je veux que mes enfants soient scolarisés. Autant ma fille que mon garçon. Il n’y a pas de différence. Ça fait des semaines que Leila et Anass ne vont pas à l’école, car depuis la crise du COVID, il n’y a plus de transport scolaire… Nous, on n’a rien gagné à suivre la trace de nos parents ! Je ne veux pas que mes enfants aient la même vie de misère que nous vivons aujourd’hui. Le bétail est notre seule richesse, mais il n’arrive plus à nous nourrir. Cette année les autorités nous ont donné deux sacs d’orge pour toutes les bêtes. C’est toute l’aide que nous avons reçue. Je ne sais pas ce que je ferai après. Avec le confinement, nous n’avons même plus le droit de bouger. La vie serait tellement plus simple à Bouâarfa ou à Figuig. Nous sommes les derniers, bien malgré nous », conclut Boujamaa.
Ils sont effectivement les derniers à sillonner les routes entre l’Atlas et le désert à la recherche de pâturages et de points d’eaux. Sécheresse et aléas climatiques, précarité, restriction des aires de circulation, frontières et conflits avec les agriculteurs auront eu raison d’une culture de transhumance et d’un patrimoine immatériel inestimable.
Soufiane Hennani
Caractéristiques d’une population en voie de disparition
Les nomades sont concentrés dans les régions à l’est et au sud du pays dans le Draa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa. Les plus fortes concentrations se trouvent à Guelmim, Tata, Zagora, Boujdour et Tarfaya. Certaines tribus et clans pratiquent également le nomadisme du côté de Tan-Tan, Es-Semara, Aousserd, Figuig, Guercif, Taroudant, Oued Ed-Dahab, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taza, Tiznit, Sidi Ifni, Chtouka- Ait Baha, Laâyoune, Taounate, Ifrane, Jerada et Chichaoua. Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), la population nomade recensée au Maroc en 2014 s’élevait à 25 274 personnes. Leur nombre aurait baissé de 60 % en dix ans. Environ 68,2 % des ménages nomades sont constitués de cinq personnes et plus (dont 32,8 % sont formés de huit personnes et plus). Le nombre moyen d’enfants par femme nomade (4 enfants) est presque le double de celui observé au niveau national. Comme constaté lors de ce reportage, l’accès à l’enseignement chez les enfants nomades est encore très limité voire des fois impossibles. Bien que constituées d’une population jeune (47,5 % ont moins de 20 ans et 65,5 % moins de 30 ans), les populations nomades restent majoritairement analphabètes. Grands oubliés du système d’éducation, 84 % des nomades n’ont aucun niveau d’instruction. Et toujours selon le HCP, le taux d’analphabétisme augmente à près de 90 % chez les femmes. Le taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est de 31,3 %, alors qu’il est de 94,5 % au niveau national. Seules 23,5 % parmi les petites filles vont à l’école. Globalement, 2,2 % ont fréquenté tout au plus le préscolaire, 9,3 % le primaire, 2,7 % le collège. Le secondaire et le supérieur n’ont été le fait que de 1,2 % et 0,6% respectivement.
Maroc, justice climatique, urgences sociales, collectif, 2021
Découvrez le sommaire ici.