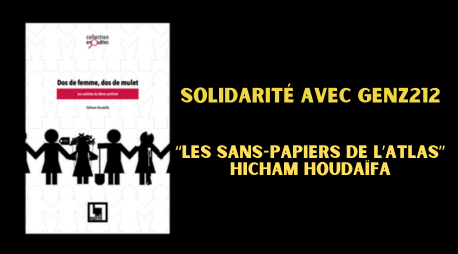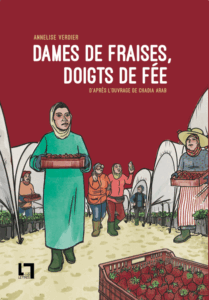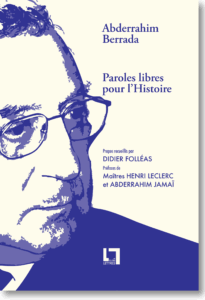Les sans-papiers de l’Atlas
En solidarité avec les revendications pacifiques et légitimes de justice sociale du mouvement GenZ212, En toutes lettres vous donne accès libre à plusieurs textes parus dans la collection Enquêtes, qui témoignent des conditions de vie indignes de nos concitoyens.
« Les sans-papiers de l’Atlas
Véritable phénomène dans les montagnes du Haut et du Moyen Atlas, le mariage coutumier, ou zwaj lfatha, concerne des milliers, voire des dizaines de milliers de femmes. Dans ces villages perchés à plus de 2 500 mètres d’altitude, des mariages sont encore prononcés par la seule Fatiha – le verset inaugural du Coran –, en présence de douze témoins. Aucun écrit n’atteste de cette union. Dans ces douars reculés, le mariage coutumier, contrat moral entre le père de la fiançée et le prétendant, a des conséquences catastrophiques sur les familles, essentiellement sur les femmes et les enfants. Ces unions sont dues à la pauvreté ou encore au fameux qanoune tmazight qui veut que l’on trouve un parti aux filles… même si elles ne sont encore que des enfants.
« Dos de femme, dos de mulet… »
Dans les villages enclavés d’Anfgou, Tisrawline, Anemzi, Aït Marzouy, Tamaloute, Tirghiste, Tighidwine, Agheddou, Aït Mhammed, Aït Abbas ou encore Amezri, la Moudawana, qui donne un cadre au mariage, est une non-réalité. Au cours des nombreux voyages que j’ai entrepris dans ces villages où la présence de l’État se limite au cheikh du douar, et où une écrasante majorité des enfants ne va pas à l’école, le temps semble s’être arrêté.Ces régions souffrent de leur enclavement, de l’absence des infrastructures de base, de la pauvreté et de l’analphabétisme. La condition des femmes y est catastrophique : elles s’occupent de tout, des tâches ménagères, des enfants… Ce sont elles qui vont dans les champs, qui coupent le bois. Ne dit-on pas dans ces régions, « dos de femme, dos de mulet… » ? En 2007, j’ai enquêté pour la première fois sur le mariage coutumier dans la région d’Aït Mhammed et Aït Abbas, près d’Azilal. Depuis, grâce notamment au soutien actif de la Fondation Ytto à travers ses caravanes de sensibilisation, je n’ai cessé de revenir dans les douars de l’Atlas, pour remarquer la persistance de ce phénomène. En 2010, dans les douars d’Anfgou et de Tamaloute, nous avions constaté, horrifiés, que des petites filles étaient mariées à l’âge de six, sept et huit ans, livrées à leurs beaux parents, le temps de l’apparition de leurs premières règles, pour que le mariage soit consommé. En 2014, ce type d’union se fait encore, parfois avec la bénédiction des agents de l’autorité, à commencer par le cheikh.
Le mariage coutumier, « par la fatiha » ou ‘orfi, est une atteinte flagrante aux droits des femmes, des hommes et des enfants. Ces milliers de familles des douars des Haut et Moyen Atlas, qui ne disposent pas d’acte de mariage, donc d’aucun document d’état civil ni de livret de famille, ne sont pas des citoyens à part entière. Lors des caravanes de sensibilisation qui ont été menées par la Fondation Ytto, les familles affluaient par dizaines, par centaines, cherchant le rsem, le contrat de mariage, afin de sortir de l’illégalité. Les bénévoles d’Ytto étaient assaillis par des mères de seize ans, dix-sept ans, mariées à douze, treize ans, portant leurs bébés dans leurs bras et voulant avoir enfin une existence juridique pour elles-mêmes, mais surtout pour leurs enfants. J’ai recueilli de douloureux témoignages. Ceux de femmes âgées d’une vingtaine d’années, pleurant sur leur sort de femmes mariées à douze ans et abandonnées, quelques mois après la venue du bébé, par le géniteur. Ceux de fillettes de douze ans qui, après avoir terminé l’école primaire, n’ont pas pu poursuivre leurs études parce qu’elles n’avaient pas d’acte de naissance. « Je veux juste continuer mes études. Sans la reconnaissance de mon père, je n’ai aucun avenir », m’avait lancé cette fillette d’Anfgou. Ou encore, les témoignages de ces femmes mariées à la coutumière à trois hommes, ayant des enfants des trois mariages. Et ces autres, de gens adultes dont les parents sont aujourd’hui décédés, qui doivent d’abord établir un acte de mariage pour leurs défunts parents avant de prétendre, eux, à une existence légale. Un véritable casse-tête…
L’absence d’acte de mariage a des conséquences terribles sur les femmes et les enfants. Une femme abandonnée avec des enfants à charge par son mari « coutumier » n’a pas droit à une pension alimentaire. Femmes et enfants sont privés de leurs droits à l’héritage, notamment sur la terre. Plusieurs se retrouvent en charge de famille à treize, quatorze et quinze ans, sans aucun droit. Elles n’ont d’autre choix que la prostitution et la mendicité. Le mariage coutumier implique également la persistance de la répudiation, pourtant abolie par la Moudawana : le « divorce coutumier » se fait devant quelques témoins, parfois même des enfants.Enfin, les enfants sont privés du droit à l’éducation.
Aujourd’hui, c’est le statu quo qui règne dans ce registre. L’article 16 de la Moudawana, qui permettait aux couples mariés « à la fatiha » de régulariser leur situation, n’a pas été prolongé depuis février 2014. Cet article précisait que «l’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» Ce qui veut dire que ces milliers de familles sont aujourd’hui hors-la-loi. «L’article 16 a été prolongé à deux reprises, constate Saïda Bajjou, assistante sociale au sein de la Fondation Ytto. L’État a ouvert cette parenthèse, mais il n’y a pas eu de mobilisation massive pour régulariser la situation de ces femmes et de leurs enfants. » Durant cette parenthèse en effet, les citoyens ignoraient l’existence même de cet article. « Chaque fois que l’on revient dans ces régions, on constate que de nouveaux mariages coutumiers ont été prononcés, comme dans la région de Ouarzazate, à Amezri, Ichabakan, mais aussi autour d’Imilchil. Si une extension de l’article 16 est décidée, elle doit être accompagnée par une action d’envergure de la part de l’État. Sinon, l’article 16 sera juste un alibi permettant d’autres mariages de mineurs », déplore Saïda Bajjou. Et d’ajouter : « Il faut aller vers les populations et organiser des opérations de légalisation collective, notamment les jours des souks hebdomadaires. C’est la seule façon d’éradiquer le mariage coutumier. » Car pour ces populations coupées de tout, s’acquitter des frais de dossier, se déplacer jusqu’à la grande ville la plus proche (Midelt, Ouarzazate ou Azilal), relève tout simplement de la mission impossible.
Nous avons choisi, pour illustrer cette enquête sur le mariage « par la fatiha », de donner la parole à celles et ceux qui militent depuis des années pour l’éradication de ce phénomène dans ces régions reculées. À Aït Abbas, au sud d’Azilal, Aïcha Aït Ouella, élue communale, se bat depuis plusieurs années pour que cette pratique cesse dans sa région et que les couples mariés à la coutumière puissent régulariser leur situation. Quant à Mohamed Baadi, il est de tous les combats dans son village d’Amezri. Notamment pour la scolarisation des fillettes, clé de voûte, selon lui, de l’éradication du mariage coutumier. Saïda Bajjou est, elle, militante de longue date, d’abord à la Ligue démocratique des droits des femmes (LDDF), puis à Insaf où elle s’est occupée des mères célibataires, avant de rejoindre la Fondation Ytto. Saïda Bajjou parle de la région d’Imilchil, de ses douars coupés du monde et de ses fillettes, mariées parfois à six, sept ans.
Aïcha Aït Ouella, la pasionaria d’Aït Abbas
« Une fille qui sort de l’école est une candidate au mariage coutumier. »
Azilal. Cette petite ville est située à 86 kilomètres de Beni Mellal. La province est l’une des plus pauvres du pays : sur 9 800 km2, elle abrite un peu plus d’un demi-million d’habitants selon le dernier recensement de 2004, et la population rurale y représente plus de 80 %. Aït Abbas est une commune perchée en altitude au cœur des montagnes imposantes du Haut Atlas, les plus enclavées du pays. En été, il fait très chaud. En hiver, très froid. La température peut monter jusqu’à 45°C au mois d’août et descendre jusqu’à -15°C en janvier. Le taux d’analphabétisme y est parmi les plus élevés du Maroc, surtout chez les jeunes filles. À Aït Abbas, le taux de mortalité infantile est important. Et les causes ne manquent pas : mariages précoces, grossesses à répétition, absence d’hygiène, accouchements difficiles, absence de contraception, absence d’infrastructures… « La commune rurale des Aït Abbas est formée de dizaines de douars qui s’étendent à une altitude moyenne de 2 500 mètres. Les habitants de la commune vivent de quelques cultures irriguées et de l’élevage de petits troupeaux de chèvres. Ils exploitent du bois destiné au chauffage. La route est impraticable pendant l’hiver et les précipitations de neige bloquent la route pendant plusieurs semaines, enclavant toute la région. Aujourd’hui encore, la plupart des douars de la région ne sont pas connectés à l’eau potable », explique Aïcha Aït Ouella, la trentaine, première femme élue de la commune d’Aït Abbas. Et d’ajouter : « Pendant des mois, les enfants ne vont plus à l’école. Les enseignants ne viennent tout simplement plus. C’est catastrophique. » Depuis 2009, Aïcha Aït Ouella utilise son poste de conseillère communale pour mettre un terme aux mariages des fillettes « par la fatiha ». « Le mariage coutumier a toujours existé dans la région. Cela est dû en premier lieu à l’enclavement. Mais il y a d’autres raisons, liées à l’analphabétisme, aux us et coutumes, et à l’abandon scolaire qui touche particulièrement les petites filles. Il y a une absence d’actions de sensibilisation, à part celles qui sont menées par la société civile », déplore Aïcha Aït Ouella. En tant que représentante de la région, elle reçoit les doléances de la population. Des doléances qui ne se limitent pas à des problèmes liés à l’école ou à la santé. « À cause du mariage coutumier, les femmes ont des problèmes de reconnaissance des enfants, de filiation, d’inscription à l’état civil. Il faut s’attaquer en urgence à ces problèmes, surtout à ce qui concerne la scolarisation des fillettes. Car une fille qui sort de l’école est une candidate au mariage, coutumier ou pas », ajoute-t-elle. Avant de conclure : « Malgré tous les efforts, cette pratique existe encore dans nos villages. Il est inadmissible qu’en 2014, des familles vivent dans leur pays sans papiers d’identité. »
Mohamed Baadi, prof de math dédié à la cause des fillettes d’Amezri
« Les services administratifs sont situés à une longue distance du village et leur déplacement coûte cher ».
Natif d’Amezri, un village enclavé près de Ouarzazate, Mohamed Baadi a fait ses études à l’école du douar avant de partir poursuivre ses études dans un collège de Toundoute Imeghrane, à 50 kilomètres. Il part ensuite à Skoura où il décroche son baccalauréat. À Agadir, il choisit les sciences mathématiques et décroche sa licence quatre ans plus tard. « J’ai été reçu dans le centre éducatif de Rabat où j’ai obtenu mon diplôme. J’ai enseigné d’abord à Tagounite avant de m’installer à Toundoute Imeghrane où j’enseigne aujourd’hui les mathématiques dans l’unique lycée », explique-t-il. Cet enseignant s’est vite impliqué dans l’action associative : « J’ai grandi dans ce petit village de 3 000 personnes, perché à 2 600 mètres d’altitude, avec des problèmes d’enclavement et de marginalisation. Je ne pouvais que m’impliquer pour un avenir meilleur pour Amezri et Ichabakan. »
Le village est situé à 40 kilomètres du siège de la commune et le premier dispensaire à plus de 35 kilomètres de piste. Durant l’hiver, le village est complètement coupé du monde. « Alors qu’on est en 2014, le village souffre de beaucoup de problèmes. Les filles ne vont pas à l’école. Il n’y a pas de route asphaltée, pas de dispensaire, pas de collège, bref, nous vivons encore dans la préhistoire », ajoute Mohamed Baadi. La plupart des enfants ne vont pas à l’école parce qu’ils ne sont tout simplement pas inscrits à l’état civil. Les mariages sont prononcés à la coutumière. « Ce qui implique que les filles sont mariées à un âge précoce, puisque leur âge n’est pas authentifié. Le mariage des mineurs est la norme dans ces villages de la région », déplore Mohamed Baadi. « C’était normal que le mariage “par la fatihaˮ prospère dans la région : les services administratifs sont situés à une longue distance du village. Par exemple, pour avoir un extrait d’acte de naissance, cela coûte au moins cent dirhams de frais de déplacement. C’est encore plus cher pour les frais administratifs pour un mariage en bonne et due forme. Les habitants sont pour ainsi dire obligés d’opter pour ce mode de mariage, d’autant plus que la pauvreté sévit comme la peste dans ces villages, sans oublier l’impact d’un analphabétisme presque généralisé. »
De retour au bercail, Mohamed Baadi milite au sein d’un réseau associatif récemment constitué. Leur objectif : encourager la scolarisation des fillettes, seul rempart, selon notre militant, pour mettre un terme à cette pratique moyenâgeuse. « Nous exerçons, avec l’appui de la Fondation Ytto, une pression sur les autorités locales ainsi que sur le tribunal de la ville de Ouarzazate afin de venir sur place régler le problème des familles sans acte de mariage. On milite également contre l’abandon scolaire des petites filles et nous travaillons pour trouver des solutions afin d’améliorer les conditions de vie de la population », conclut notre militant.
Saïda Bajjou, un combat inlassable contre le mariage des mineurs
« Les femmes divorcées à la coutumière se retrouvent obligées de se prostituer afin de faire vivre leurs enfants. »
« J’ai découvert le mariage coutumier lors d’une caravane organisée par la Fondation Ytto en 2008, dans la région d’Azilal. Les femmes sont venues vers nous pour demander de l’aide. C’est par la suite que l’on a découvert l’étendue de ce phénomène et ses conséquences catastrophiques. J’ai été saisie par ces fillettes de dix ans dont on interrompt les études pour les préparer à devenir des épouses », lance d’emblée Saïda Bajjou. Et d’ajouter : « Les femmes de Aït Abbas sont traitées comme du bétail. Petites filles, elles n’ont pas le droit à l’éducation. Esclaves de leurs pères, elles passent, après le mariage, au statut d’esclave de leur mari ou de leur belle-famille. Les femmes dans cette région travaillent plus de seize heures par jour à la maison comme dans les champs. »
Depuis Azilal, Saïda Bajjou sillonne Imilchil et sa région. « J’ai été choquée par ces mariages collectifs où des fillettes sont mariées à l’âge de sept ou huit ans. Cela a été le choc de ma vie », se souvient la militante. À Anemzi, Tamaloute et Anfgou, Saïda Bajjou, Najat Ikhich, la présidente de la Fondation Ytto et les volontaires, pour la plupart des jeunes des quartiers populaires de Casablanca, découvrent un autre Maroc où les fillettes sont mariées à sept ans. « C’étaient des filles en âge de jouer, d’aller à l’école. Mais ces enfants n’ont d’enfance que le nom. Aucune fille n’allait à l’école et elles étaient toutes mariées à la coutumière», déplore Saïda Bajjou.
La médiatisation des caravanes de la Fondation Ytto a sorti ce phénomène du registre du tabou. Ce qui a contribué à freiner la cadence des ces unions hors-la-loi. « Il y a eu peu de campagnes de sensibilisation dans ces régions pour promouvoir la Moudawana. Mais quand c’est fait, on ne prend pas en considération les spécificités de chaque région, notamment la langue parlée, qui est en général l’amazigh », explique Saïda Bajjou. Mais il y a d’autres raisons à la persistance du mariage coutumier dans ces régions du Maroc profond. Ces unions se font en général avec la complicité des agents d’autorité. Saïda Bajjou relève aussi des problèmes structurels, comme l’inexistence des structures de première nécessité et de routes. Et de conclure : « Le mariage coutumier cause des ravages dans la région et il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. Les femmes divorcées à la coutumière se retrouvent obligées de se prostituer afin de faire vivre leurs enfants. Et ces enfants ne vont pas à l’école puisqu’ils ne sont pas inscrits à l’état civil. »»
Hicham Houdaïfa
Dos de femme, dos de mulet, les oubliées du Maroc profond, Hicham Houdaïfa, 2015
Découvrez le sommaire ici.