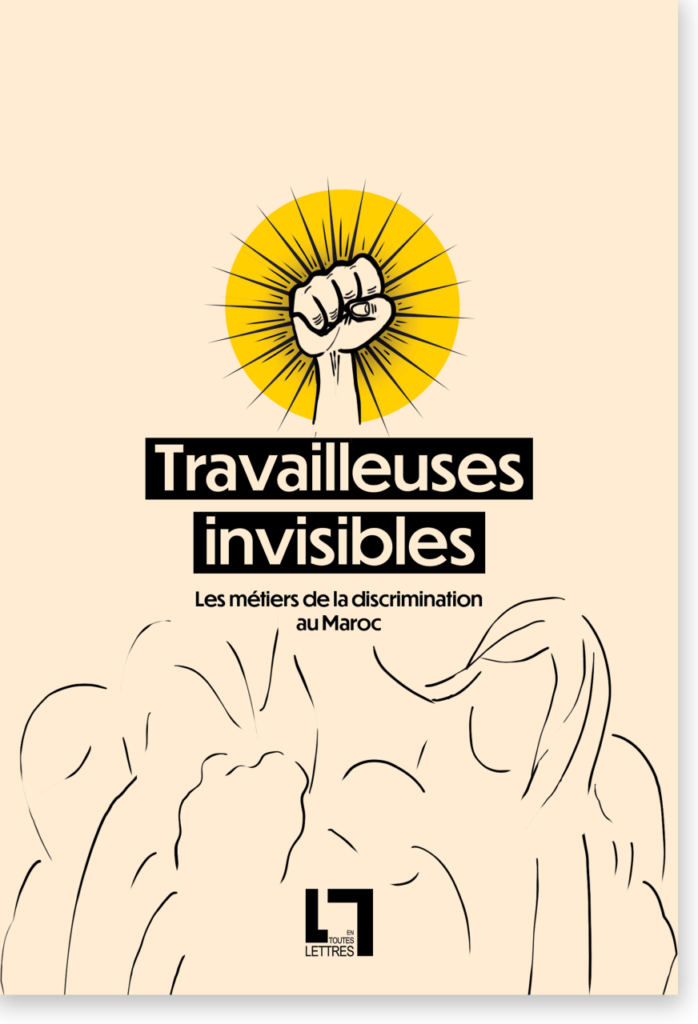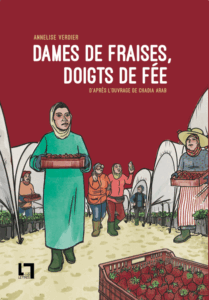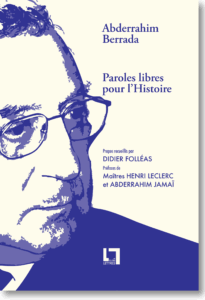Textile: Tanger, les noyées du capitalisme du désastre
En solidarité avec les revendications pacifiques et légitimes de justice sociale du mouvement GenZ212, En toutes lettres vous donne accès libre à plusieurs textes parus dans la collection Enquêtes, qui témoignent des conditions de vie indignes de nos concitoyens.
« « Le développement capitaliste a toujours été non durable à cause de son impact humain. Pour comprendre cet aspect, il nous suffit d’adopter le point de vue de ceux qui ont été et continuent d’être tués par lui. »
Mariarosa Dalla Costa[1]
Même face à la mort, les femmes subissent la discrimination ! Les victimes des trois pires drames qu’a connu le Maroc ces dernières années étaient presque toutes des femmes : Rosamor à Casablanca en 2008, Sidi Boulaâlam près d’Essaouira en 2017 et l’atelier de l’entreprise AM Fashion de Tanger en 2021. Ces trois hécatombes ont respectivement causé la mort de 56[2], 15[3] et 20 femmes à Tanger. Ces victimes ont en commun d’être des femmes des classes populaires et ouvrières. Elles sont aussi issues pour leur majorité du monde rural, poussées à l’exode dans les villes à la recherche d’un sous-emploi. Ce travail peut permettre de s’autonomiser[4] mais demeure une expérience marquée par la violence dans toutes ses formes.
Tout au long de leur vie, ces victimes ont subi moult discriminations. Sous-payées, non déclarées, surexploitées, les femmes ouvrières sont les premières victimes de la violence économique causée par le système capitaliste[5]. La discrimination devient une méthode pour soutirer le maximum de plus-value du travail féminin.
Au Maroc, dans les secteurs industriels historiques, la désindustrialisation pousse les travailleuses vers les secteurs les moins protégés et les plus précaires, notamment vers le secteur des services[6]. Le secteur textile offre encore des débouchés à une main-d’œuvre féminine urbaine abondante et sous-qualifiée, dont la majeure partie est sans-emploi. Un secteur où la protection sociale est décrite comme « en panne »[7] depuis de longues années.
Le taux de chômage féminin est de 16,8 % au Maroc contre 10,9 % pour les hommes[8]. En milieu urbain, ce chiffre grimpe à 25,6 % contre 14,4 % pour les hommes. Ces statistiques résument les ségrégations structurelles que subissent les femmes face au marché de l’emploi et qui les poussent vers les métiers les plus pénibles et les moins protégés. Un dernier chiffre illustre cette discrimination endémique : le taux d’emploi féminin, qui plafonne à 23 % depuis des années. Un taux qui signifie clairement l’échec des programmes d’autonomisation des femmes.
Les femmes sont d’autant plus exploitées que le syndicalisme, historiquement puissant dans le secteur textile[9], a subi plusieurs défaites. Autrefois présentes parmi les leaders et les délégués syndicaux, les femmes sont aujourd’hui victimes d’un rapport de force déséquilibré, plus que jamais favorable au capital sur le travail. Dans ce système, les discriminations basées sur le genre et la classe se nourrissent pour exploiter ce prolétariat féminin. Le drame récent de « l’usine de la mort » de Tanger illustre ce fonctionnement.
Le 8 février 2021 à Tanger, 28 ouvriers, dont 20 femmes, ont péri dans le sous-sol d’une usine textile[10]. Les victimes sont mortes noyées après que cette usine a été submergée par les fortes pluies. L’indignation est passagère, le drame vite oublié. Ce terrible incident condense une série de discriminations que peuvent subir des femmes et des hommes issus des classes populaires et ouvrières, et dont les familles sont victimes à leur tour. Elles sont le produit du « capitalisme du désastre » décrit par Naomi Klein dans son ouvrage La Stratégie du choc[11]. Un capitalisme libéré de toutes les contraintes et normes sociales, qui ne peut qu’engendrer des drames à répétition.
Fatima-Zahra El Khoumssi, 16 ans, est l’une des survivantes de l’usine de la mort de Tanger. Elle a vu mourir sa petite sœur Oumaima, âgée de 15 ans. Aujourd’hui, cette adolescente est brisée psychologiquement et socialement. « Je n’arrive pas à reprendre le travail pour aider ma famille », témoigne-t-elle. Elles sont plusieurs mineures parmi les victimes de ce drame.
Fathia Rmili est la mère d’une des victimes de l’usine. Sa fille Fatima Zahra, 16 ans, a péri dans l’usine de la mort. « Elle a quitté l’école pour travailler à l’usine. Elle voulait m’aider à acheter mes médicaments et payer les frais médicaux de ma maladie chronique. Je l’ai suppliée d’arrêter ce travail, mais elle tenait à m’aider », raconte cette mère désemparée. Fatima Zahra avait arrêté de travailler durant quatre mois en raison du confinement sanitaire.
Le drame est survenu la première semaine de reprise de l’activité à l’usine. La majorité des ouvriers n’étaient pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Ils n’avaient pas bénéficié de l’indemnité gouvernementale versée durant la période du Covid-19. Ghizlane Bourkiba, 28 ans, fait partie aussi des victimes. « Ma sœur avait travaillé à l’usine durant trois ans. Elle avait à maintes reprises demandé au patron de la déclarer à la CNSS, sans résultat », regrette amèrement son frère Mohamed. Joumaâ Bourkoune, une autre victime, a connu le même sort. « Ma sœur avait un salaire de 8 dirhams de l’heure et n’était pas déclarée à la CNSS », explique Saïdia, sa sœur, qui travaille également dans le secteur du textile à Tanger : « Quand on est dans le besoin, on accepte de travailler n’importe où et à n’importe quel prix. » De son côté, le patronat du secteur du textile se porte bien et se dit « résilient »[12] face au spectre de crises qu’ils ne cessent d’agiter pour mieux négocier concessions sociales et avantages fiscaux[13].
Une exploitation principalement féminine
Avec 1 628 entreprises employant 189 000 personnes, le textile est essentiel pour l’économie marocaine et le marché de l’emploi. Il représente 8 % du PIB et 27 % des emplois industriels. Ce secteur permet de générer un chiffre d’affaires de 50,48 milliards de dirhams (MMDH) et de 36,5 MMDH à l’export, ainsi qu’une valeur ajoutée de 15,88 MMDH, selon les données du ministère de l’Industrie[14].
La reprise après la pandémie s’est annoncée « prometteuse » pour le secteur. « Depuis le début de l’année 2021, le Maroc a enregistré la plus forte évolution des exportations vers l’Europe avec plus 23 % », se réjouit le département ministériel[15], qui gratifie le patronat d’un Plan d’accélération industrielle avec subventions et avantages fiscaux. Le patronat lance aujourd’hui sa nouvelle stratégie intitulée : « Textile 2035 – Une vision, des convictions »[16].
Dans ce secteur, la main-d’œuvre est utilisée intensivement. 70 % des salariés du secteur textile formel sont des femmes[17]. Leurs conditions de travail sont historiquement marquées par l’exploitation et l’absence de déclaration à la CNSS[18]. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma, le textile emploie 55 000 personnes, dans les 417 unités. Il est à préciser que l’informel, sous ses différentes formes, représente 54 % du secteur du textile au Maroc[19].
Zineb Issayeh est membre de l’association Attawassoul à Tanger et activiste au sein de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH). Cette militante a suivi de près le drame de Tanger : « Le chômage frappe les femmes sans diplômes. Cette situation les condamne à travailler dans des conditions indignes, avec les salaires les plus bas. Ce n’est pas du travail, c’est de la traite d’êtres humains. »
Un des indices de cette misère ouvrière est la présence de quatre fratries parmi les victimes de ce drame. La famille Belhkir a perdu quatre de ses filles. La famille Amdjar, deux de ses filles. La famille Mekkouki, un garçon et une fille. Et la famille Cherif, deux jeunes garçons. Une hécatombe familiale. Parmi les victimes aussi, un couple de jeunes mariés (le couple Benayad-Taoufik).
Vols sur les dépouilles
Le 8 février à midi, le Maroc est sous le choc. À 15 heures, les communiqués pleuvent pour « dénoncer » ce tragique événement. À 20 heures, les autorités locales donnent l’ordre aux familles d’enterrer leurs morts le soir même. La majorité des familles n’a pas pu tenir tête aux autorités et ont dû enterrer leurs enfants à 2 heures du matin. « C’était dur de supporter de tels comportements », s’indigne Hicham Benayad, qui a perdu sa sœur Aïcha, 23 ans, et son beau-frère Ahmed, 26 ans, et un des rares à ne pas avoir obtempéré : « Les autorités m’ont informé que le corps était prêt pour l’enterrement. On a refusé cet ordre. Nous voulions voir une dernière fois les défunts. » Presque deux ans après cet épisode, Mohamed n’en revient pas du comportement méprisable des autorités : « Nous aussi, nous avons refusé d’enterrer notre sœur le soir. On a ramené la dépouille à la maison. Le lendemain, à 10 heures du matin, des membres des services de sécurité et le caïd se sont présentés devant la maison. On leur a demandé de nous laisser juste le temps de l’enterrer au moment de la prière d’Al-dohr (midi), mais ils ont refusé. »
Autre fait marquant survenu le même jour, et que les familles n’oublient pas : les victimes, au moment de leur déplacement de l’usine vers la morgue de Tanger, auraient été volées. «Le jour du drame, les ouvriers avaient reçu leurs salaires. Entre leur transport de l’hôpital à la morgue, elles ont été dépouillées de leurs biens. Des gens ont osé voler des morts ! », s’indigne Mohamed. Même cri de colère de Hicham : « À la morgue, nous avons protesté contre le vol des objets qu’ont subi les victimes. » Et Mohamed de poursuivre : « Ma sœur portait ses boucles d’oreille, un bracelet, une montre. On ne nous a rien remis. Même si ces objets étaient insignifiants, pour nous c’était d’une grande violence de voir ces femmes même mortes dépossédées de leurs biens. »
Rahma, jamais sans mes filles
Au lendemain du drame, le Maroc oublie rapidement « l’usine de la mort ». Les familles et les survivants sont abandonnés de toute part. Anéanties, ils souffrent psychologiquement de cette tragédie. Lors de nos entretiens entre février et septembre 2022[20], nous avons rencontré des familles brisées mais dignes dans l’adversité. La mère de Fatima-Zahra raconte le traumatisme vécu par sa fille : « Depuis le jour du drame, elle a une phobie de l’eau. Elle est traumatisée. Elle prend difficilement une douche. Ma fille n’a plus aucune activité sociale. Je me bats seule entre les hôpitaux de Tanger et d’Al Hoceïma pour lui trouver une prise en charge. »
« Toutes les familles souffrent psychologiquement. Des semaines après la mort de sa fille, une des mères de victimes sortait chaque soir dormir près de la tombe de sa fille », décrit Hicham. La mère de Mohamed ne dormait plus. Fathia Rmili vit le même cauchemar : « Chaque nuit, je voyais ma fille rentrer chez moi à la maison », confie cette mère. Grâce aux efforts de l’association Attawassoul, plusieurs mères arrivent à obtenir des consultations chez des psychiatres bénévoles. Les autorités locales sont aux abonnés absents. « Pire, ils nous ont traités de manière arrogante », affirme un des parents de victimes qui a requis l’anonymat.
Le drame ne s’arrête pas là. Le 12 novembre 2021, Rahma Stitou, qui a perdu ses filles Sanaâ et Fatima-Zahra à l’usine de Tanger, décède suite à la dégradation de son état de santé physique et psychologique. « Elle avait une santé très fragile. Sa famille avait contacté la wilaya pour la prendre en charge rapidement, mais un responsable de la wilaya a refusé, ce qui a été pris pour une provocation. Et l’irrémédiable s’est produit, Rahma a perdu la vie, faute d’accès aux soins. Elle pouvait être sauvée », insiste Zineb Issayeh d’Attawassoul. Aujourd’hui, le mari de Rahma est toujours sous le choc d’avoir perdu ses deux filles et son épouse. La défunte, âgée de 42 ans seulement, a laissé derrière elle cinq autres enfants, dont Nouhaila, 2 ans. Lors de notre rencontre en février 2022, cet homme n’a pas pu témoigner. Un silence qui dit l’ampleur de la violence que subissent ces familles.
Autre forme de violence subie par les familles des victimes, la violence socio-économique. « Les victimes apportaient des revenus aux familles, qui ont parfois perdu leur unique source de revenus», rappelle Zineb. « Des familles sont devenues presque des SDF car elles n’avaient même pas de quoi payer leur loyer », déplore Hicham. Pourtant, la wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma avait promis de prendre en charge les familles démunies des victimes. « Après ces promesses, il y a eu un silence des autorités durant des mois », observe Zineb. « Dès le début, l’État nous a méprisés. Avant le ramadan, la wilaya nous a envoyé un panier alimentaire. Certes, nous sommes dans le besoin, mais ce n’est pas ce panier qui va nourrir nos familles », dénonce un parent de victime qui a requis l’anonymat.
Les patrons du textile ont proposé une somme d’argent, par charité, aux familles des victimes. « Malgré leur immense besoin, les parents de victimes ont tous refusé cette proposition. Ils ont répondu qu’ils exigeaient la dignité qu’ils méritaient ainsi que les droits qui leur revenaient, et non pas la charité », martèle Zineb.
Pour l’ensemble des familles rencontrées, « c’est grâce à la solidarité entre nous et au soutien de quelques associations et bienfaiteurs que nous avons pu résister». Mais elles n’étaient pas au bout de leur peine. C’est ensuite la violence politique qu’elles ont subie pour avoir décidé de se constituer en mouvement de revendication.
Intimidation et répression
« Dès le départ, les autorités ont voulu nous faire taire », estime Hicham. Pour y parvenir, les agents d’autorité ont utilisé des techniques d’intimidation. Ils ont fait le tour des familles des victimes avec un seul message : « Évitez de parler aux médias et aux ONG.» Mohamed, qui a reçu plusieurs visites du moqaddem de son quartier, raconte cet épisode : « Le wali en personne est venu nous promettre que Sidna veillait à l’ouverture d’une enquête. On était rassurés, au début. Après quarante jours, on n’a rien vu venir. On a commencé à chercher les autres victimes. »
L’association Attawassoul a pris contact avec les familles. « Il a fallu chercher dans les quartiers populaires de Ben Dibane et Beni Makada, où se concentrent plusieurs familles. Le mouvement était composé au départ de 17 familles», témoigne Zineb, la cheville ouvrière de ce mouvement avec son camarade Boubker El Khamlichi. Six mois après le drame, c’est toujours le même silence des autorités. « Nous avons envoyé des lettres au Chef du gouvernement, au ministre du Travail, à la CNSS, sans réponse de leur part », relève Mohamed. Les familles passent alors à l’action.
« On a décidé d’organiser un sit-in devant l’usine pour commémorer la mémoire des victimes et exiger la vérité », explique Hicham. Attawassoul et les familles mobilisent les ouvriers dans les différentes zones industrielles de la ville. « Notre action symbolique a été interdite. Les forces de l’ordre ont passé deux jours devant l’usine interdisant à toute personne de s’en approcher », se rappelle Mohamed, qui ne digère pas cette répression. Zineb, militante pourtant aguerrie, est choquée par l’ampleur de la répression de ce sit-in. « Les ouvrières et les mères étaient venues très tôt pour assister au sit-in, mais elles ont été chassées par la police. Les forces de l’ordre ont insulté les familles avec des mots vulgaires », assure-t-elle. Zineb rapporte également qu’un policier a rabroué une mère de victime, en lui disant : « Vas-t’en prier chez toi pour ta fille ». Et elle ajoute : « A-t-on besoin désormais d’une autorisation pour prier les morts ? » Mais les familles et leurs soutiens ne baissent pas les bras.
« Notre stratégie tablait sur la mobilisation locale et une pression médiatique, y compris internationale et en particulier espagnole », commente Zineb. Salvados TV est l’un des médias indépendants espagnols qui couvre ce dossier. Lors de son déplacement au Maroc, l’équipe de cette Web TV est arrêtée et refoulée du territoire marocain. « On a tenu un sit-in devant la préfecture de police de Tanger. Ces journalistes sont venus au Maroc uniquement pour nous apporter un soutien. Ils ont été libérés après notre sit-in. Ces épreuves ont forgé l’esprit solidaire des familles. On a tenu tête à cette répression», se réjouit Hicham. Grâce à leur lutte, les familles vont obtenir une victoire en demi-teinte : une compensation financière mais en dehors du système judiciaire, dont elles subissent la violence de plein fouet.
La charité, pas la justice
Les familles adressent plusieurs lettres à la multinationale de textile espagnol Inditex pour qu’elle rende des comptes sur sa responsabilité dans ce drame. « L’usine était un sous-traitant au Maroc d’Inditex[21]. L’entreprise nous a répondu qu’elle était prête à nous aider, mais qu’elle ne nous verserait aucune indemnité officielle », précise Mohamed. Dans la foulée, une association composée d’industriels espagnols et marocains du textile rencontre les familles. Mais l’issue continue d’être imprécise. Le 12 novembre 2021, quand Rahma meurt, les autorités sont en état d’alerte et les industriels accélèrent la mobilisation. « La wilaya a repris contact avec nous. C’est à partir de ce moment que le dossier s’est débloqué et que les familles ont réussi à obtenir des aides », explique Hicham. Une association nommée Al Ghait, constituée du patronat du textile à Tanger, récolte plusieurs millions de dirhams en un temps record de la part des industriels dont, indirectement, Inditex. Les familles des victimes ont obtenu des logements sociaux à Tanger et le reliquat de la collecte – 13 millions de dirhams – a été distribué aux 28 familles des victimes. « Il fallait une martyre supplémentaire et un drame de plus pour voir les autorités et le patronat mobilisés si vite », déplore Zineb.
Pour les familles, c’est une première victoire, mais insuffisante. « Les aides reçues étaient une bouffée d’oxygène car nous vivions ce drame au quotidien. Mais notre combat n’était pas fini. C’est celui de l’ensemble des ouvriers au Maroc et avec une revendication : “Assez de ces drames !” La dignité des ouvriers n’est pas à vendre », lance Hicham. C’est pour cette raison que la majorité des familles se sont constituées partie civile dans le procès de l’usine de la mort.
« Ce procès était douloureux », confie Fathia Rmili. L’enjeu principal, pour les familles et leur défense, était de prouver la responsabilité pénale du patron de l’usine dans la mort de 28 ouvriers, ainsi que la responsabilité de l’État. Mais ces deux niveaux de responsabilité n’ont pas été retenus par le système judiciaire, qui n’a reconnu que la responsabilité civile de la société en charge de la distribution d’eau et d’électricité, Amendis. « Le patron écope d’un an et demi de prison ferme et de 1 000 dirhams d’amende. C’est une honte ! C’est à peine un mois pour chaque vie perdue dans l’usine ! », s’emporte Mohamed. Pour sa part, Amendis devait s’acquitter des indemnisations au profit des familles, à hauteur de 200 000 dirhams par famille, soit un total de 4,8 millions de dirhams. « C’est insuffisant », estiment toutes les familles interrogées. Le verdict a été rendu en décembre 2021, mais le jugement n’a pas encore été exécuté[22].
Du côté des industriels du textile, les petits ateliers aux grands bénéfices ont repris leur activité deux semaines après le drame de Tanger. « L’État ne peut pas fermer ces usines, c’est une soupape de sécurité face à la crise socio-économique aiguë que vivent les classes populaires de Tanger et sa région. C’est la seule réponse que l’État offre face au chômage de masse des femmes », explique Zineb. Des ateliers où les ouvrières sont condamnées à l’exploitation ou à la mort. Cette situation intenable du prolétariat féminin au Maroc et dans le monde est le résultat d’une nouvelle division internationale du travail (NDIT) promue par la mondialisation néolibérale.[23]
Aux racines du drame
Le drame de l’usine de Tanger rappelle la catastrophe des ateliers de Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui avaient causé la mort de 1 135 ouvriers et ouvrières. L’effondrement de cet immeuble qui abritait plusieurs ateliers de textile est la plus grande catastrophe industrielle et le symbole de la violence de la mondialisation envers les femmes[24]. Ce crime économique est le produit de la recherche du profit à tout prix, des complicités locales et de la NDIT promue par la fast fashion à Tanger ou Dacca au Bangladesh. Ces usines sont les symboles de l’appauvrissement et de l’exploitation subis par le prolétariat féminin à travers le monde, spécialement dans le Tiers-Monde. Les femmes sont une clé dans cette NDIT. « La paupérisation du Tiers-Monde a permis une réorganisation internationale de la reproduction qui transfère du “Nord” au “Sud” une part importante du travail requis pour la reproduction de la main-d’œuvre utilisée dans les métropoles. Cela signifie que les femmes du tiers-monde sont désormais “intégrées” dans l’économie mondiale comme productrices de forces de travail qui vont être utilisées et “consommées” dans les régions industrialisées du monde, en plus de leur fonction de productrices de biens pour l’exportation », écrit l’universitaire Silvia Federici[25].
Dans les zones franches ou encore pire dans les ateliers, les ouvrières sont maintenues « en dessous du minimum vital »[26], comme le montrent les conditions de travail à l’usine de Tanger. Autant le patronat du secteur textile se targue de visions idylliques, autant les conditions de travail semblent aller en régressant[27]. Les femmes « sont forcées de travailler de longues heures dans des conditions de sécurité très précaires, elles sont persécutées quand elles tentent de s’organiser et sont sujettes à de constants abus, comme des fouilles corporelles quotidiennes pour vérifier qu’elles ne font rien sortir de l’usine »[28], poursuit Silvia Federici. Toujours à l’usine, « ces femmes sont souvent enfermées, pour s’assurer qu’elles vont remplir leurs “quotas”, de sorte que, pendant des heures et des heures, elles ne peuvent pas prendre de pause – travail, qui parfois se prolonge dans la nuit »[29], dénonce la sociologue italienne. Cette situation d’exploitation est favorisée par un contexte néolibéral qui a réussi « à affaiblir ou à abolir les repères et les solidarités collectives » grâce à l’existence « d’une armée de réserve de main-d’œuvre docilisée par la précarisation et par la menace permanente du chômage », comme l’écrivait Pierre Bourdieu[30]. Poussé à l’extrême, ce système d’exploitation donne des situations tragiques comme celle de Tanger.
Le jour du drame, le patron a préféré sortir sa voiture de l’usine pour éviter qu’elle ne prenne l’eau, tandis que les ouvriers ont continué à travailler au sous-sol. À ses yeux, ces prolétaires étaient invisibles. Pour l’État, ils n’étaient que des clandestins.
ANNEXE : Les victimes de l’usine de textile de Tanger : des noms contre l’oubli
- Hassania Belkheir
- Chaimae Belkheir
- Fatima Belkheir
- Amal Belkheir
- Aicha Ben-Ayyad, 24 ans
- Ahmed Tawfik, 28 ans
- Yousra El Znagui, 21 ans
- Fatima-Zohra Amjar
- Sanae Amjar
- Oubaida Alach
- Ghizlane Bourkiba, 28 ans
- Oussama Hamioui, 25 ans
- Rachida El Halouti, 25 ans
- Soukaina Mekouki, 23 ans
- Yasmine Makouki, 25 ans
- Soukaina El Ghelich, 27 ans
- Saloua El Khoulti, 22 ans
- Yassine Chrif
- Mohammed Chrif
- Youssef El Mrabet
- Abdelmalak Erradi
- Mouad Eddarbaoui, 21 ans
- Mahammed Essbiae
- Joumaâ Bourkoune
- Oumaima El Khoumssi, 15 ans
- Fatima Eljaghdal, 20 ans
- Mohammed Elafia, 23 ans
- Fatima Zohra El Rmili, 16 ans
- Rhama Stitou, épouse Amjar, décédée en novembre 2021, 42 ans.
[1] Dalla Costa, Mariarosa, (1995) « Capitalism and Reproduction », in Bonefeld, Werner, Gunn, Richard, Holloway, John et Psychopedis, Kosmas, Open Marxism III, Londres, Pluto Press, 1995.
[2] Le Monde avec AFP et Reuters, « Maroc : le patron d’une usine en garde à vue après la mort de 55 personnes dans un incendie », in Le Monde, 26 avril 2008 (consulté le 1er septembre 2022).
[3] Ahdani, Jassim, « À Sidi Boulaâlam, des témoins racontent le dimanche noir », in TelQuel, 20 novembre 2017, (consulté le 1er septembre 2022).
[4] Bouasria, Leila (Coord.) Migration féminine à Casablanca : entre autonomie et précarité, Casablanca, La Croisée des chemins, 2020.
[5] Collectif, Attac Maroc « Les Marocaines au temps de la mondialisation » (en arabe). Disponible sur https://(consulté le 28 septembre 2022).
[6] « La contribution du secteur manufacturier dans la création de richesse au Maroc a diminué au fil des années et a été accompagnée, aussi, d’une baisse de sa part de l’emploi, atteignant les 10,4 % de l’emploi total en 2015, alors qu’il représentait environ 12,2 % en 1999. » Cf. Ait Ali,Abdelaziz et Msadfa, Yassine, La transformation structurelle au Maroc et chaînes de valeurs mondiales : une vulgarisation du débat, Policy Paper, OCP Policy Paper, 2019. Disponible ici (consulté le 28 septembre 2022).
[7] Mellakh, Kamal, « Les ouvrières du textile : une protection sociale en panne », in Economia, 11 avril 2015. Disponible ici (consulté le 1er septembre 2022).
[8] Haut commissariat au plan (HCP), « Situation du marché de l’emploi au Maroc en 2021 », Disponible ici (consulté le 1er octobre 2022).
[9] Voir les documentaires réalisés par Souad Guennoun sur ces luttes féminines historiques dans ce secteur entre 2001 et 2012 à Salé, Rabat, Casablanca et Tanger ici.
[10] Voir la liste complète des victimes en annexe.
[11] Klein, Naomi, La Stratégie du choc, montée d’un capitalisme du désastre, Paris, Actes Sud, 2008.
[12] Brun, Thomas, « Entretien avec Fatima-Zohra Alaoui, DG de l’AMITH : “Les entreprises du secteur font preuve d’une grande résilience” », in revue Conjoncture, n°1039, 15 septembre-15 octobre 2021. Disponible ici. (consulté le 28 septembre 2022).
[13] « Industrie du textile : Une résilience à toute épreuve », site du ministère de l’Industrie, Royaume du Maroc, 30 juin 2021. Disponible ici.
(consulté le 1er septembre 2022).
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Communiqué de presse de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), « Textile 2035 – Une vision, des convictions », le 30 novembre 2021, Casablanca.
[17] « Zoom sur le secteur du textile et l’habillement au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma », in Le message économique, magazine de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma, n°10, avril-juin 2021, p. 10.
[18] Bourquia, Rahma, Genre et emploi dans l’industrie textile marocaine, Genève, Publication de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le Développement social (UNRISD), 1999.
[19] Znagui, Bachir, « Synthèse de l’étude de la CGEM, L’informel d’après le patronat marocain », in Economia, 25 juin 2018. Disponible ici (consulté le 3 octobre 2022).
[20] Cet article s’est fait en collaboration avec Anass Laghnadi, de la rédaction de ENASS.ma, qui a recueilli le témoignage de Fatima Zahra El Khoumssi.
[21] Contrairement à ce qu’ont affirmé les autorités sécuritaires locales à Tanger, l’usine n’était pas « clandestine » mais immatriculée au Registre de commerce et recevait l’Inspection du travail depuis 2017. Voir à ce propos le travail journalistique de qualité de nos confrères de Media24 sur ce sujet : Khatla, Kenza, « Drame de Tanger : l’usine était régulièrement inspectée par le ministère du Travail », 15 février 2021. Disponible ici (consulté le 1er septembre 2022).
[22] C’était encore le cas jusqu’à la date du 10 novembre 2022, au moment de l’édition de ce texte.
[23] Le nouvel ordre économique néolibéral modifie la division internationale du travail, ce qui entraîne un accroissement des migrations de travailleurs et de travailleuses. Actuellement, une personne sur dix dans les régions développées est migrante, et les femmes représentent la moitié de ce nombre. Cf. Verschuur, Christine et Reysoo, Fenneke (Dir.), Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations, Genève, Graduate Institute Publications, 2005. Disponible ici (consulté le 24 octobre 2022).
[24] Rapport d’Oxfam, « Fashion Revolution Week : 9 ans après le Rana Plaza où en est-on ? », 19 avril 2022. Disponible ici (consulté le 10 septembre 2022).
[25] Federici, Silvia, « Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail », in Verschuur, Christine, & Reysoo, Fenneke (Dir.), Genre, mondialisation et pauvreté, in Cahiers Genre et développement, n°3, 2002. Disponible ici (consulté le 28 septembre 2022).
[26] Ibid.
[27] « Le secteur textile et du cuir connait un taux d’emploi en baisse. Un mouvement qui s’est accentué à partir 2009, avec un rythme moyen de -2,8 % par an. » Voir Ait Ali, Abdelaziz et Msadfa, Yassine, art. cit.
[28] Federici, Silvia, « Reproduction et lutte féministe », art. cit.
[29] Ibid.
[30] Bourdieu, Pierre, « L’essence du néo-libéralisme », in Le Monde Diplomatique, mars 1998. Disponible ici (consulté le 1er septembre 2022).
Salaheddine Lemaizi
Travailleuses invisibles, les métiers de la discrimination au Maroc, collectif, 2022
Découvrez le sommaire ici.