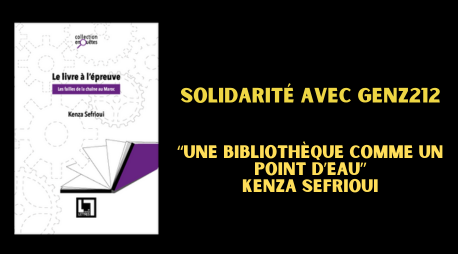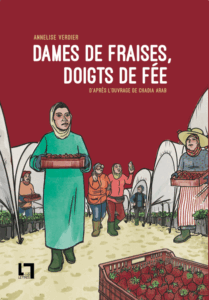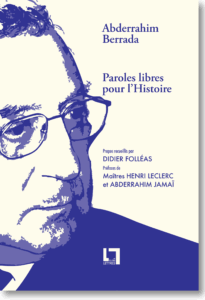Une bibliothèque comme un point d’eau
En solidarité avec les revendications pacifiques et légitimes de justice sociale du mouvement GenZ212, En toutes lettres vous donne accès libre à plusieurs textes parus dans la collection Enquêtes, qui témoignent des conditions de vie indignes de nos concitoyens.
« C’est grâce aux livres que je ne suis pas devenu khammas », songe Moubarik Chentoufi[1]. Né en 1953 à Douar Chorfa, dans la commune de Bouhouda, à une centaine de kilomètres au nord de Fès, il a vu sa région s’enfoncer dans la pauvreté. Non loin de la petite ville de Taounate, Bouhouda se trouve sur les premiers contreforts du Rif, à quelques encablures de l’arrière-base de Abdelkrim Khattabi. C’est par là que passait la frontière entre la zone espagnole et la zone française, du temps des protectorats. Ses collines surplombent l’ancienne Route de l’Unité qu’avait mise en œuvre Mehdi Ben Barka. C’est une région rurale, verdoyante grâce à l’abondance de sources. Ses collines sont couvertes d’oliviers, d’amandiers, de caroubiers. Mais Bouhouda est à l’écart de tout. Ses douars ne sont pas tous raccordés au réseau électrique ni d’eau courante, malgré le barrage qui a été construit dans la région. L’élevage et l’agriculture ne suffisent pas à faire vivre la population qui a augmenté constamment depuis les années 1960 et comptait, selon le recensement de 2014, plus de 26 000 habitants. Moubarik Chentoufi a été témoin de la fragmentation à l’extrême de la propriété : une maison et un petit lopin de terre à partager entre une vingtaine d’héritiers, forcés de partir se louer comme journaliers, travailler dans les semailles et la menuiserie à Ketama, à 15 kilomètres, ou encore développer la culture de haschich…
Moubarik Chentoufi et son frère Hocine, de trois ans son cadet, ont eu la chance d’échapper à cette condition. Leur grand-père étant alem et qadi, le goût du savoir imprégnait la famille. Dès l’âge de douze ans, ils ont été envoyés au collège de Taounate, puisqu’il n’y avait pas, en 1967, de collège à Bouhouda. Là, ils ont eu accès à une bibliothèque, pleine de romans et d’essais en arabe et en français. Le poète français Ghislain Ripault, qui y enseignait et organisait des ateliers théâtre et poésie, leur a fait découvrir la revue Souffles, pôle d’un riche mouvement artistique, intellectuel et politique, dirigée par Abdellatif Laâbi. Moubarik Chentoufi se souvient qu’il lui est arrivé de ne manger qu’un jour sur deux pour économiser, sur les 4 ou 5 dirhams envoyés chaque semaine par ses parents, de quoi louer des livres. Les deux frères ont poursuivi leurs études au lycée Moulay Idriss de Fès et se sont inscrits à l’Institut français, pour avoir accès à sa bibliothèque. Hocine Chentoufi s’est ensuite orienté vers les mathématiques, Moubarik vers les sciences politiques. Tous deux ont quitté leur région natale pour travailler à Rabat. Le cadet y enseigne les mathématiques depuis 1981. L’aîné a travaillé quelques années à la SMER (Société marocaine des études réunies), maison d’édition dirigée par Mustapha El Alaoui, où il fait connaissance d’acteurs culturels et d’intellectuels comme Leïla Shahid- Berrada, Abdelkebir Khatibi, Paul Pascon. « En m’occupant de la diffusion, j’ai beaucoup appris sur le livre marocain, sur la production marocaine éditée en Égypte et au Liban. » Mais c’est au ministère de la Jeunesse et des Sports, où il entre en 1984, qu’il fait carrière, jusqu’à devenir au fil des années administrateur principal.
La culture au cœur du développement
Moubarik et Hocine Chentoufi sont restés très attachés à Bouhouda et entendent faire bénéficier ses habitants de ce qui leur a permis de faire librement leurs choix. Surtout les jeunes. « Bouhouda, c’est près de 800 élèves de primaire, 200 collégiens et 700 lycéens », rappelle Moubarik Chentoufi. Conscients des problèmes de pauvreté, d’analphabétisme, d’absence d’équipements de base, mais aussi de clientélisme et de corruption, ils veulent impulser une dynamique de développement qui s’installe dans la durée et ne puisse pas être récupérée par un puissant du coin. Pour eux, seule la culture permet de former les gens sur la longue durée, parce que « c’est un droit humain et la base de la citoyenneté ». En particulier le livre. « J’ai toujours eu l’idée de créer une bibliothèque pour les jeunes », insiste Moubarik Chentoufi. Créer une dynamique de lecture à Bouhouda est ce qui donne sens à sa vie.
En septembre 2000, ils constituent avec les gens du douar l’Association locale pour la coopération et le développement social de Bouhouda. Hocine Chentoufi en devient président, Moubarik vice-président. Le premier s’occupe du montage des dossiers, le second conçoit le projet culturel global. L’association commence par des actions sociales, des cours de broderie. Dès 2003, elle se lance dans un programme d’alphabétisation, de soutien scolaire et d’éducation non formelle. En octobre 2003, en effet, un discours royal avait annoncé le lancement d’une campagne de lutte contre l’analphabétisme intitulée Masirat al- Nour, la marche de la Lumière. Dans la foulée, l’association propose une opération en partenariat avec le secrétariat d’État chargé de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle : 300 bénéficiaires dans huit douars dès la première année, 600 la seconde, touchant quatre douars de plus et la commune voisine de Aïn Mediouna, 700 la troisième année y compris dans la commune de Tissa. L’emploi du temps est adapté au rythme du travail agricole et aux jours de souks, pour permettre aux gens, surtout des femmes âgées de 15 à 65 ans, journalières dans les champs ou l’élevage, de venir. Au programme, lecture et écriture en arabe, calcul, éducation religieuse et à la citoyenneté.
En 2005, Moubarik Chentoufi prend sa retraite anticipée. L’argent qu’il touche pour ce « DVD », environ 620 000 dirhams, c’est à l’association qu’il le consacre. À l’alphabétisation s’ajoute une action d’éducation non formelle, en partenariat avec trois autres associations de la région. Une convention est signée avec la direction de l’Éducation non formelle, une seconde l’année suivante avec l’Agence espagnole pour la coopération internationale. 68 jeunes de 9 à 15 ans, qui n’ont jamais été scolarisés ou ont quitté l’école, suivent un programme de trois ans, à raison de quinze heures hebdomadaires, pour récupérer un niveau de primaire. Un projet d’initiation à l’informatique est également mis en place, avec le soutien du ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité : 150 000 dirhams pour acheter des ordinateurs et des meubles. « On était précurseurs, se félicite Moubarik Chentoufi. Même dans les grandes villes, en 2005, il n’y avait pas ce mouvement pour apprendre l’informatique. » L’association, jusqu’alors domiciliée au douar, dans la maison familiale, loue un local dans le centre de Bouhouda, avec un loyer de 550 dirhams.
Et surtout, Moubarik Chentoufi se consacre pleinement à faire lire Bouhouda. « J’ai commencé à amener des livres accessibles aux jeunes du collège ». Succès immédiat. Et pour cause, au collège de Bouhouda, il n’y a rien. Un bâtiment sinistre, délabré, qui n’a eu de toilettes qu’en 2013, après le raccordement au réseau d’eau courante – or l’absence de toilettes est la première cause d’abandon de la scolarité pour les filles… Pas de salle de sport. Pas de préau en état : des pierres et des trous partout au sol. Et bien sûr, pas de bibliothèque. « Quand j’ai vu l’engouement des jeunes pour la lecture, l’idée de créer une bibliothèque s’est imposée. » D’autant que la commune non plus n’en dispose pas.
L’art de monter les dossiers
« À l’époque, l’État encourageait les associations à faire des projets. J’ai présenté à l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en 2006 un projet de 250 000 dirhams pour la création d’une bibliothèque. Cela a été agréé par la commission provinciale. C’est un des rares projets culturels qui a été retenu. » L’association apporte le quart du budget avec les livres et les équipements dont elle dispose déjà. L’INDH fournit le reste, dont la moitié sert à l’achat d’étagères et de tables pour la salle de lecture, d’un rétroprojecteur, etc. L’autre moitié, près de 100 000 dirhams, est consacrée à l’achat de livres auprès de grandes librairies de Rabat et de Casablanca – « aucune librairie de Fès n’était compétente, surtout pour fournir des ouvrages pour les jeunes », regrette Moubarik Chentoufi.
Cependant, l’INDH ne finance pas de budget de fonctionnement. Pour payer le loyer, passé à 1 500 dirhams par mois car l’association s’est étendue à l’étage, pour recruter une secrétaire et quelqu’un pour l’assister, Moubarik Chentoufi paie de sa poche, aidé par quelques donateurs. Mais cela ne suffit pas pour que les salariés soient déclarés.
Le Centre Bouhouda pour la culture et le développement ouvre donc ses portes en 2006, dans le centre du village, et donne accès à une bibliothèque riche de plus de 4 000 livres, en français et en arabe. Les cours de soutien scolaire et d’informatique y attirent en moins d’un an plus d’un habitant de la commune sur dix : 640 personnes, dont 265 élèves de l’école primaire, 307 collégiens et 68 adultes. Dès la deuxième année, la bibliothèque touche plus de mille personnes, écoliers, collégiens, femmes, retraités et paysans. Des enfants descendent des douars très tôt pour être là dès l’ouverture, à 8 heures du matin, pour emprunter les livres avant d’aller en classe. Jusqu’à 15 heures, tous les jours, une cinquantaine d’enfants vient lire, seuls ou en groupe, et discuter de leurs lectures.
Autre chose que le livre scolaire
« Mon but, c’était de donner l’envie de donner autre chose que le livre scolaire », insiste Moubarik Chentoufi. À Bouhouda en effet, la quasi-totalité des jeunes n’a jamais vu de livre en dehors du manuel scolaire, « parce qu’il n’y avait pas un seul livre ». Lui-même grand lecteur, Moubarik Chentoufi a veillé personnellement à la qualité des achats. « J’ai passé deux mois en librairie à les choisir, car je tenais à ce que les livres, qu’ils soient édités au Maroc, au Liban ou en Égypte, soient adaptés aux jeunes ». Il a remué ciel et terre à Rabat et Casablanca pour obtenir des dons auprès d’éditeurs, comme Tarik éditions, et de particuliers. « Je prends tout. Lors de son dernier désherbage, l’Institut français m’a offert plus de 30 caisses de livres : des BD, des livres neufs de chez Gallimard, de petits romans… » Lui-même ne cesse de puiser dans ses fonds propres pour enrichir la bibliothèque de nouveautés et de classiques… Et qu’on n’aille pas lui dire que les gens ne s’intéressent pas à la lecture : « Ce n’est pas que les gens ne veulent pas lire, mais on ne fait rien pour les appâter ni les séduire. Le manque d’intérêt pour la culture est structurel, et c’est cela qu’il faut faire bouger. Il faut se demander : qu’est-ce qu’on publie pour les jeunes ? qu’est-ce qu’on a à donner à lire aux Marocains ? Il en faut pour tous les goûts. Dans ma bibliothèque, il y a des livres de cuisine, des romans roses pour les femmes. Il y a aussi Naguib Mahfouz, Yussuf Sibai, Ahmed Abdessalam Bakkali les nouvelles pour enfants tirées des 1001 Nuits par Mohamed Msellak chez Dar Taqafa, des revues en français, comme J’aime lire… » Pour les petits, il amène des contes ou Les aventures de Joha. On trouve des classiques de la littérature égyptienne, comme Al-Ayyâm de Taha Hussein, des romans algériens, comme Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, le Coran, des bandes dessinées, des dictionnaires, des recueils de proverbes et de sagesse…
Tout cela est en accès libre. L’abonnement est gratuit. « Au départ, on a eu 800 jeunes abonnés : tous les élèves du primaire et les collégiens. Ils prenaient environ quatre à cinq livres par semaine. Il y a des jeunes qui ont lu environ 400 livres par an », s’enthousiasme Moubarik Chentoufi. « D’ailleurs les professeurs ont reconnu la hausse de niveau, que ce soit en arabe ou en français ». Au-delà de l’amélioration des résultats scolaires, la familiarité avec le livre a permis l’éclosion de talents d’écriture. Dès 2007, Najia composait des poèmes en anglais. À neuf ans, Aouatif écrivait « des textes sur la nature ». Widad, onze ans, s’exprimait en arabe quand elle voulait faire des poèmes, et en français quand elle voulait raconter une histoire. Soumia avouait qu’elle « n’écrivait pas encore » mais l’écriture faisait déjà partie de ses projets. Quant à Oumaïma, treize ans, elle versifiait en français et en arabe, composait du zajal et était déjà l’auteure de plusieurs pièces de théâtre en français, qui ont été montées au collège par un atelier théâtre créé spécialement pour l’occasion. Fille d’un fonctionnaire de la commune, elle trouvait à la bibliothèque une ouverture sur l’imaginaire : « À la maison, il y a des dictionnaires, des livres sur l’islam et la politique, sur l’expérience de l’écriture. Depuis toute petite, je voulais lire des histoires et des romans. »
Le fait que les enfants fréquentent la bibliothèque a créé une dynamique. Les femmes au foyer, d’abord venues voir ce qu’y font leurs enfants, s’abonnent à leur tour. « À la fin de l’année, beaucoup de livres n’étaient pas rendus », relève Moubarik Chentoufi, pour qui le plus important, c’est que « de vraies passions pour la lecture se sont découvertes ». Un bémol le fait cependant enrager : « À part trois ou quatre, les professeurs ne viennent jamais prendre des livres. » Or c’est eux qu’il faut en priorité motiver, car ils sont les principaux prescripteurs de lecture. « Le seul moyen de promouvoir la lecture, c’est pas le biais des instituteurs. » Pour rapprocher le livre de l’école, Moubarik Chentoufi a organisé des cérémonies de remise des prix chaque 10 juillet depuis 2005. Mais, regrette-t-il, « on a arrêté depuis trois ans », faute d’argent pour acheter les livres remis aux trois premiers de chaque classe.
Premier festival indépendant du livre
Dès 2008, l’association organise un festival de la lecture. Cet événement qui met en fête tout le village et les communes avoisinantes vient « en complément de l’action menée dans le cadre de l’INDH », explique Moubarik Chentoufi, et vient aussi consolider les liens avec le corps enseignant. La première édition s’est tenue du 26 au 28 mai 2008. Officiellement inauguré par le wali, l’événement a permis à 400 enfants et adolescents, accompagnés de leurs parents, de voir les livres présentés par les stands de quelques libraires et éditeurs venus de Rabat et de Casablanca, et de bénéficier d’ateliers animés par des artistes de renom. Au programme, atelier de peinture avec Bouchta El Hayani et calligraphie avec Sadik Haddari pour l’éveil artistique, mais aussi rencontres littéraires. BouazzaTaïk, secrétaire général de l’Association marocaine des enseignants de français, invite les écoliers et collégiens à lire leurs textes. Ambiance survoltée et enthousiaste. Les artistes et écrivains, venus de Rabat ou d’Asilah, transmettent avec générosité leurs trucs et leurs techniques. Chez Bouchta El Hayani, la réalisation de grandes œuvres collectives cosignées par plus de 150 enfants, dont certains ont bénéficié des cours d’éducation non formelle, invités à dessiner des lettres en couleur et à s’approprier l’espace du papier est l’occasion de réviser l’alphabet, de rectifier l’orientation d’une lettre… La lettre est aussi au cœur de l’atelier calligraphie, mais sans qu’il y ait le moindre aspect normatif : Sadik Haddari préfère les sensibiliser au rythme graphique, les laisser jouer avec les pleins et déliés et apprécier la charge d’encre de Chine. Beaucoup proposent des phrases religieuses, s’inspirant du seul usage qu’ils connaissent de cet art, mais d’autres improvisent des compositions sur leur prénom. À l’école primaire et au collège, Amina Hachimi Alaoui, directrice des éditions Yanbow Al Kitab, spécialisées dans le livre jeunesse, vient distribuer 1 400 livres dans le cadre d’une opération intitulée « Un livre, un enfant ». 1 400, c’est le nombre d’élèves du primaire et du secondaire à Bouhouda. Amina Hachimi Alaoui a trouvé des mécènes qui ont acheté des ouvrages de l’ensemble de son catalogue avec 40 % de remise, pour un montant total de 40 000 dirhams, et avait préparé les paquets classe par classe. Pour cet événement, et les cinq autres qui ont suivi, l’association a eu un soutien financier de la Province et du ministère de la Culture. Le
premier a permis de loger et de nourrir les invités, le second de payer un cachet aux intervenants. En revanche, déplore Moubarik Chentoufi, « le conseil communal n’a jamais déboursé un centime pour soutenir ce festival. Il nous donne mille dirhams de subvention, comme aux autres associations, même celles qui ne font rien. » Faute d’argent, l’initiative a dû s’interrompre en 2012. Une 6ème édition a été organisée en 2013, mais depuis 2014, plus rien. Moubarik Chentoufi espère pouvoir réunir les fonds pour relancer cette initiative, qui est une des rares manifestations non étatiques au Maroc, en 2017.
Ouverture sur l’ailleurs
Désenclaver Bouhouda et rattacher la commune au reste du pays, ce n’est pas seulement y faire venir des écrivains, artistes et professionnels du livre. C’est également faire découvrir le pays aux enfants. Pour récompenser les lauréats, l’association a ainsi organisé des voyages culturels pour visiter le site archéologique de Volubilis et emmené les enfants aux deux principaux salons du livre : le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca et le Salon international de Tanger des livres et des arts. La plupart d’entre eux prenaient le train et voyaient la mer pour la première fois. En dépit des difficultés matérielles, les parents avaient remis des sommes parfois importantes aux enfants. Certains avaient 30 dirhams en poche, d’autres jusqu’à 300 dirhams. Au SIEL, où les exposants se plaignent régulièrement du manque de préparation des visites scolaires et des dérangements causés par les groupes, les enfants de Bouhouda ont étonné par leur maturité. Le SIEL était pour eux l’unique occasion de l’année de voir ce qui était publié et de se constituer une petite bibliothèque personnelle. Curieux de tout, livres illustrés, romans, dictionnaires, en français et en arabe, ils circulaient dans les stands par petits groupes, les grands veillant sur les petits, prenaient le temps de lire de larges extraits avant de se décider. Les paniers présentant des promotions les intéressaient, mais pas question d’acheter des livres s’ils jugeaient la qualité médiocre. Certains s’associaient à leurs amis pour acheter des ouvrages qu’ils se prêteraient. Personne n’oubliait de prendre quelque chose pour les petits frères et sœurs… Ils ont aussi profité des joies du SIEL : se faire prendre en photo avec les personnalités qu’ils reconnaissaient, comme Hafid El Badri, la star de leurs sitcoms préférées, ou écouter la conteuse Halima Hamdane. Mais là encore, faute de financement pérenne, ces initiatives sont restées sans lendemain.
Difficultés à pérenniser l’action
D’autres projets n’ont pas abouti faute d’argent. « Je voulais acheter des mulets mais n’ai pas pu le faire », regrette Moubarik Chentoufi. Il s’agissait d’acheminer des livres dans les douars les plus éloignés, accessibles par des pistes dans les hauteurs, parce qu’« il doit y avoir une bibliothèque partout, comme un point d’eau ». L’association a quand même pu créer huit points de lecture, entre 2009 et 2010. Là encore, les instituteurs sont les relais : « Toutes les deux semaines, on donnait aux instituteurs autant de livres qu’ils avaient d’élèves. Ça a marché. » Mais depuis 2012, l’association n’a plus les moyens d’assurer ce suivi et l’initiative s’arrête. C’est qu’elle a eu des soucis avec le nouveau local dans lequel elle devait emménager. « Dans le cadre du programme MEDA, l’Union européenne a construit un local, mais les travaux n’ont pas été fait correctement. Il y a des infiltrations, on a toujours des réparations à faire. On s’est donc concentrés sur le centre », explique Moubarik Chentoufi. « Et puis, ajoute-t-il, il ne me reste plus d’argent ». Responsabiliser les habitants ? « L’an dernier, nous avons établi une carte d’adhésion à la bibliothèque à 20 dirhams. Nous n’avons eu que 50 adhérents. Quand c’était gratuit, nous en avions 500. » Mais il est optimiste. Infatigable malgré l’âge et une santé fragile, il continue à faire ce travail de sensibilisation notamment auprès des enseignants, à remuer ciel et terre pour obtenir livres et financements, à monter des budgets pour pouvoir recruter un secrétaire. Sans relâche, il fait la navette entre Rabat et Bouhouda, un sac toujours plein de livres pour enrichir d’année en année cette bibliothèque qui compte désormais plus de 10 000 titres et attire même des lecteurs de Taounate. Un travail discret, patient, motivé par l’inébranlable conviction que l’ignorance est la pire des oppressions.
Résister à l’obscurantisme
2011, les revendications de justice sociale portées par le Mouvement du 20 Février le touchent. Mais le mouvement s’essouffle, les législatives portent au pouvoir un parti conservateur et se réclamant de l’islam politique. Lui qui a passé six mois dans les prisons de Derb Moulay Cherif et Ghbila en 1976 car il militait dans le mouvement marxiste- léniniste Ilal Amam, et qui a été renvoyé de la Direction des affaires rurales du ministère de l’Intérieur en raison de son passé militant n’en démord pas : « les révolutions ne peuvent pas aboutir sans travail culturel », car le savoir est une des clefs de la dignité.
Dès 2007, l’association a lancé un Club d’éducation à la citoyenneté et aux droits humains qui a touché cinquante jeunes et a permis d’en emmener deux à la rencontre du Cinquantenaire du développement humain qui a eu lieu en novembre 2007 dans la station balnéaire de Bouznika. Bouhouda a donc fait partie des 570 ateliers où plus de 20 000 jeunes ont formulé leurs recommandations. Au centre, on discute donc des textes de référence édités par Transparency Maroc et le Forum de la Citoyenneté. Droits de l’enfant, violence faite aux femmes, lutte contre la corruption… Chaque semaine, les jeunes, surtout des filles, âgés de neuf à quatorze ans, viennent débattre de ces questions ainsi que des problèmes de la commune. Cette dynamique citoyenne s’est enclenchée aussi chez les adultes. L’association organise régulièrement des réunions où elle invite les parents. La dizaine de pères qui vient est très investie pour l’amélioration des cours d’informatique, de théâtre, l’organisation de séances de lecture en groupe pour aider la lecture individuelle. Tous ont conscience de l’importance de coordonner le travail de l’association, de l’école et des familles pour combler les lacunes et résorber les inégalités de capital culturel. La discussion porte aussi sur les problèmes quotidiens. L’école qui date des années 1950 et menace de s’écrouler sur les enfants. Le détournement de la somme destinée à réparer le collège et le silence des autorités malgré les pétitions qui leur ont été adressées. Les intrusions dans l’enceinte du collège. L’inexistence d’un système de ramassage scolaire. Les classes surchargées, avec parfois plus de cinquante élèves. L’absentéisme d’enseignants nommés à Bouhouda sans aucune prise en compte de leur situation familiale, et qui arrivent parfois trois mois après la rentrée. Le lycée, enfin construit en 2012, mais avec un internat qui ne peut accueillir que 150 jeunes, trop peu au vu des besoins de la région. « Ce lycée n’a même pas de bibliothèque, enrage Moubarik Chentoufi. Je les ai mis en contact avec le ministère de la Culture et la Faculté des Lettres de Rabat pour qu’ils fassent des demandes, je leur ai amené les livres moi-même. Tout cela a disparu dans la nature. Il n’y a même pas de salle de lecture. » Il y a aussi le barrage qui a été emporté parce que l’étude préalable était inadaptée, le problème de l’assainissement, etc. On débat, on s’interroge sur l’action des pouvoirs publics. Débat, sens de la responsabilité… ce sont les bases d’une vraie citoyenneté qui se diffusent au fil des réunions.
L’association insiste sur son indépendance par rapport aux partis et aux syndicats. « En m’engageant dans l’action culturelle, j’ai toujours tenu à ne pas manifester mes opinions ni mes sympathies politiques et ne me suis jamais présenté aux élections locales pour qu’il n’y ait pas de mélange », insiste Moubarik Chentoufi. « Cela suppose qu’on soit ouverts et qu’on ait un fonctionnement démocratique. » Son autonomie vis-à-vis des élus est la clef du respect qu’on lui porte autant que de sa liberté de parole. Il s’inquiète de l’usage des subventions à des fins clientélistes au niveau du conseil communal et du conseil provincial : « Chacun a des associations à sa solde, qui lui servent lors des élections. » Et il s’indigne de l’absence de suivi du ministère de la Culture et des autorités provinciales quant à l’état et l’activité des maisons de la culture et des bibliothèques : « C’est un gaspillage d’argent public et tout le monde s’en fout ! Dans son fascicule, le ministère n’a recensé que les bibliothèques publiques qu’il gère directement. Mais ces bibliothèques ne fonctionnent pas, les livres qu’il y envoie restent dans les cartons. Même celles qui sont ouvertes ne servent pas à donner des livres, mais comme espaces où les jeunes peuvent réviser. Les maisons de la culture de Taounate, Aïn Mediouna et Tissa sont pleines de livres bidons, mal choisis, achetés aux Habous à des libraires qui leur ont refourgué ce qui ne se vendait pas, des livres de mauvaise qualité, qui salissent les mains. » À l’inverse, il salue le travail fait par le conseil communal de Karia Ba Mohammed : « Ils ont monté une bibliothèque dans les règles de l’art, en 2008. C’est un joyau architectural, agréable, avec de bons livres, des ordinateurs et un matériel multimédia moderne. Ce type de partenariat entre le conseil communal et le ministère de la Culture devrait être dupliqué pour créer de vrais foyers culturels. » Le contrat de délégation de service public pourrait aussi être une solution – « Le conseil communal le fait bien à Casablanca pour le ramassage des ordures ! » Bref, « c’est une bataille qu’il faut continuer. » Pour que quand les enfants de Bouhouda disent que quand ils seront grands, ils seront médecin, ingénieur ou avocat, ils puissent avoir de vraies chances de réaliser leurs rêves.
[1] Ce chapitre se base en partie sur deux reportages que j’ai publiés dans Le journal hebdomadaire : « Quand la culture change le monde », n°305, 2-7 juin 2007, et « Eau, électricité ET culture », n°353, 7-13 juin 2008.
Kenza Sefrioui
Le livre à l’épreuve, les failles de la chaîne au Maroc, Kenza Sefrioui, 2017
Découvrez le sommaire ici.