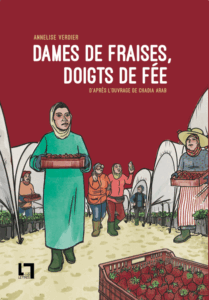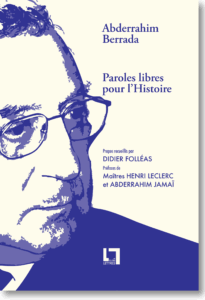Driss Ksikes: l’indisciplinarité de l’art
En avant-première de la parution du prochain livre de Driss Ksikes, L’Art d’être indiscipliné, prévue en 2021 dans la collection Les Presses de l’Université citoyenne, nous partageons le texte de sa conférence donnée le 16 septembre 2020 à l’invitation de la curatrice Alya Sebti et de l’essayiste Thierry Fabre à l’Institut d’Études Avancées d’Aix-Marseille (IMERA) à Marseille. Driss Ksikes intervenait en clôture des rencontres Méditerranée, traits d’union? organisées dans le cadre de Manifesta 13 Marseille.
L’indisciplinarité de l’art
La formule inscrite au programme de la biennale -l’art d’être indiscipliné- est assez large. En plus d’être le titre de mon prochain ouvrage, elle concerne un éthos, une méthode et une manière d’être au monde, mais elle désigne en creux, ce qui nous réunit ce soir, à savoir ce que je formulerais comme l’indisciplinarité de l’art.
Alors, posons-nous une question simple : est-ce que l’art est une discipline ? Vous entendez probablement ceci : est-ce que les différentes branches artistiques constituent des disciplines d’apprentissage académique ? A cette question, d’apparence rhétorique, certains d’entre vous seraient tentés de répondre par un hochement de tête approbateur et d’autres, plus circonspects, par une moue dubitative. A propos de quoi, justement ? Du fait que l’on réduise les arts performatifs et visuels -pour ne citer que ces deux champs- à la notion de discipline dans le sens d’un corpus fixe, d’un ensemble de normes à apprendre, de mécanismes à comprendre, de techniques reproductibles à assimiler et, quand les méthodes sont permissives, des cheminements cadrés et des formats reconnaissables. Or, cette forme de scepticisme, d’apparence formelle, en cache bien d’autres.
La plus prégnante des formes, sous tendant les études postcoloniales et la conscience qui en découle d’une justice épistémique à rétablir, interroge les traditions euro-centrées qui fondent le corpus des disciplines artistiques. Elle se pose surtout des questions légitimes sur la mise à l’écart, du domaine des études, de pratiques ancestrales, orales, ingénieuses, socialement ancrées, politiquement folklorisées, maintenues sans nom, sans traces, hors de la géographie des savoirs consacrés. Ces voix, danses, fêtes, dessins, témoignages, représentations, archives sauvages pouvant être parfois les marqueurs d’une modernité mutique, subissent, comme le souligne le théoricien portoricain, Ramon Grosfoguel, un effet d’épistémicide. Aussi, de par leur marginalité ou absence programmée, elles semblent hors-cadre, inadaptées aux moules préétablies des disciplines comme construits industriels, en amont fabriqués pour huiler la machine d’administration des savoirs et en aval pour faire perdurer l’offre créative et de divertissement. Face à quoi, émergent, ça et là, par des cheminements divers, des artistes en quête de l’insondable, de l’inexploré, soucieux de décentrer les histoires et curieux d’en appréhender le sens interdit. Ils cherchent, en marge de disciplines apprises, et parfois contre la doxa qui les légitime, à donner à leurs explorations détournées, un nom et une histori-cité. Ainsi, le premier motif, dé-colonial, des artistes pour se défaire des disciplines renseigne sur le fait qu’ils les abordent non seulement comme des contenants de savoirs et techniques, mais également comme des construits politiques, portés par des institutions, lieux de transmission, de représentation et d’exposition, qui se comportent souvent en temples de reproduction d’héritages esthétiques dominants.
L’autre raison du doute que l’assertion de départ suscite provient d’artistes passionnés qui ne sauraient se concevoir en disciples. Il est en effet utile de rappeler que le premier sens du mot disciplina indique la soumission d’un disciple à son maître. Cette subordination se base sur le compagnonnage par les plus expérimentés, le devoir d’obéissance des apprentis, et à travers eux, selon la formule de. Michel Foucault, « le gouvernement de corps libres et dociles » pour se conformer à un mode de pensée, d’action et de production. Or, ce dispositif archaïque, reproduit par les nouvelles formes aliénantes de prolétariat, ne concerne, dans le monde des arts, que sa face cachée, industrieuse, artisanale, technique, et au mieux l’art dans son sens allemand de manière de faire. Elle ne saisit de la poétique et de l’esthétique que les mécanismes de répétition et d’intériorisation des canons. Mais elle ignore la part de l’aesthesis, qui renvoie à la sensibilité que ressent l’artiste vis-à-vis de son environnement, du monde autour, comme elle ne saisit pas la part d’intuition, d’errance, de jeu, de tâtonnements, d’interrogations qui débordent de la discipline, l’éclatent et appellent à s’en défaire pour créer.
Dans un monde, de plus en plus fragmenté, fondé par des injustices et les inepties qui le traversent et le malmènent, créer des percepts, toucher les affects -puisque c’est ce qui donnerait une raison d’être à l’art- passe nécessairement par des effets d’hybridation que les cloisons disciplinaires excluent ou trouvent suspectes. Ainsi, faire dialoguer cultures hautes enseignées par les règles du logos, et cultures populaires humées, ressenties à travers le prisme de la déambulation, du mythe, du conte et de l’imaginaire, demande un doigté, un art secret, qui se forge à part, à l’ombre des lumières partagées par tous. Mieux encore, traiter sur un pied d’égalité les savoirs estampillés scientifiques par les effets de classement, de catégorisation et de vérification, et les subjectivations littéraires et artistiques, fondés sur l’observation, l’imagination et la composition, passe souvent aux yeux des gardiens des temples académiques et muséaux, pour une profanation. Or, si Platon a initié par ses dialogues en tant qu’artiste-philosophe une possibilité de relier logos et mythos, notons que c’est un écrivain bibliothécaire, Jorge Luis Borgès, qui a poussé la transgression de cette frontière étanche le plus loin possible. Sur un autre registre, chez les artistes de scène surtout, passer, sans transition, avec une fluidité déconcertante, des formes consacrées aux improvisations, des méthodes éprouvées aux expérimentations sans filet, demande une dextérité et une vision de funambule, dans le sens que lui donne Friederich Nietzsche et auquel initient à peine par la seule pratique les écoles qui enseignent les arts du cirque.
La question initiale (Est-ce que l’art est une discipline ?) peut également être entendue dans un sens autre, d’apparence moins équivoque : faut-il avoir un certain sens de la discipline pour faire de l’art (et y perdurer) ? Il serait d’ailleurs plus juste, à ce niveau, de parler d’auto-discipline, d’effort sur soi, d’ascèse, de rituel, d’acceptation de contraintes et la pratique de la répétition, non pour refaire mais pour trouver organiquement, par l’épuisement des sens, les variations qui élèvent. Ce propos est séduisant et porte en lui une sagesse indéniable. Les exemples abondent pour en étayer la pertinence, que ce soit à travers la métaphore de l’écrivain comme coureur de fond, chez le romancier japonais Haruki Murakami, celle de l’acteur épuisé corporellement pour se débarrasser de ses automatismes et accéder à l’essence de son personnage, comme l’a développé le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski, ou encore celle de l’artiste visuel comme archéologue, déterrant patiemment et révélant les cadres effacés, comme suggéré par la jeune artiste et architecte palestinienne contemporaine, Saba Innab, à travers ses pratiques de relevé de terrain, de cartes et d’inversion des échelles.
Mais conditionner l’art par cette tendance à se discipliner prend parfois l’allure d’un discours normatif. Non seulement parce qu’il condamne à terme les bohémiens, les dépendants, les passionnés et autres habités, qui ne conçoivent l’art que comme éclats et jaillissements. Mais aussi, parce que, derrière cette assertion, pointe un néo-puritanisme, une sorte de religion du bien-être qui se transforme en injonction, comme unique voie de salut et de permanence. Or, il serait fallacieux de prédéfinir les voies. Il est crucial de faire confiance aux chemins, de ne pas se précipiter de dire ou de s’exprimer et à apprendre surtout à entendre, écouter, et saisir les résonnances qui adviennent. Et cela passe parfois par l’art oisif de flâner et capter, sans s’y préparer, en toute sérendipité, ce que nous ne cherchons pas.
Cela passe par un double geste : décoloniser les disciplines en les décloisonnant, comme nous le suggère la philosophe franco-algérienne, Seloua Luste-Boulbina. Il ne s’agit pas là d’une simple posture à afficher, mais d’une prise de conscience à avoir, d’une démarche humble vis-à-vis des subalternes à adopter, d’une quête de contre-voix à faire entendre pour faire contrepoint dans le monde. Et cela passe nécessairement par la compréhension fine de deux concepts : la positionnalité et l’intersectionnalité. Je suis admiratif d’artistes qui échappent aux cadres préétablis et qui sont de plus en plus enclins, face à l’universalisme surplombant des lumières et les essentialismes identitaires de repli, à repartir de leurs positions, à assumer la subjectivité du regard qu’ils portent sur les choses à partir de leurs lieux de naissance, de rêve, de départ, d’exil, à se mettre en quête et donner à voir ou écouter ce qui a été oblitéré, ce qui permet de redonner un sens à leur vie et habiter le monde à partir de là où ils sont, sans se soucier de la hiérarchie des nations, des récits ou des modes de pensée. Je suis tout aussi interpelé par leur démarche de chercheurs, autodidactes ou aguerris, à l’affût, comme des renifleurs ou des enquêteurs, des intersections sociales et politiques que les récits dominants ignorent. En croisant les questions de genre, de classe, de race, de localité, de trajectoires, avec les représentations en vogue, les discours qui prédominent, ils réinventent les pratiques artistiques et souvent relèvent un double pari : nous surprendre et nous faire pointer du doigt une part de l’essentiel.
C’est à tout cela et bien plus que renvoie l’indiscipline supposée des artistes. D’où la question de méthode, en miroir à la première, en quoi consiste l’indisciplinarité de l’art ? Je me méfie des définitions, des modes de pensée et d’agir prédéterminés. Sans doute parce que c’est d’abord une affaire d’éthos, d’attitude, de conscience et de cheminement, où l’on ne rejette pas la discipline en bloc, mais on la met en dialogue et en tension avec d’autres. Et puis, on la met surtout au service de ce qui fonde nos paradoxes intimes. Les miennes seraient la quête de sens couplée avec l’amour du jeu, le plaisir de rire et le souci du questionnement et, au bout du bout, la recherche permanente d’un émerveillement qui surprend et bouscule à la fois. Chacun son cheminement, ses obsessions, mais il y a, me semble-t-il, trois notions qui transcendent complètement les disciplines et pourtant aident à mieux asseoir l’art auxquels ils initient : la liberté, l’ancrage et le lien.
La liberté n’est pas aisée à atteindre. Elle nécessite souvent le passage par une discipline de base à maîtriser, pour mieux s’en émanciper, trouver son langage, forger sa grammaire, comme le ferait un joueur de jazz. Ainsi, l’autonomie que cela suppose passe par une libération des savoirs acquis, pour mieux sentir l’inconnu, l’inexploré et resté ouvert à l’expérience sans être prisonnier de grilles de lecture et de modèles imposés.
L’ancrage est ce qui nous permet de faire de notre village, comme Chinua Achebe, l’équivalent du Dublin de Joyce. Creuser, explorer, rester à l’écoute, être le réceptacle de contes oubliés, d’expériences invisibilisées, et surtout se faire le révélateur de l’inconscient de son territoire ou du pouls de son époque. C’est l’aventure que mènent avec dextérité et délicatesse, quelques artistes sensibles, empathiques. A Casablanca, c’est à cette tâche-là, d’artiste ancré en dialogue avec le monde à partir de son propre langage et un code partagé, qu’a dédié sa démarche, l’artiste visuel Hassan Darsi.
Mais de ces trois notions, c’est bien celle du lien (qui rappelle le trait d’union en suspens entre les deux rives de la Méditerranée) qui me semble la plus difficile à appréhender. Car s’il y a une raison d’être indiscipliné, ni soumis par devoir ni rebelle par principe, mais juste et inclassable, ce serait le fait de relier ce qui est habituellement dissocié, ce qui est historiquement désarticulé et ce qui est politiquement séparé. Mais pour quoi faire ? Pour remembrer notre humanité.
J’aime beaucoup ce mot « remembrer » qui, détourné de l’anglais, renvoie à la remémoration et donc à la réparation des oublis voulus, programmés ou incidents, et, pris dans son sens premier, désigne la ré-articulation de membres disloqués. En art, cela se traduit de mille et une manières, à travers le fait de relier le théâtre aux réalités sociales invisibles, la danse aux refoulés qui traversent le corps social, la peinture au rapport au sacré, faire fusionner les rythmes contemporains et anciens, etc. Dans ce sillage, j’aime cette formule d’Edgar Morin sur la complexité où, pour battre en brèche les silos académiques, il dit que les arts et les savoirs « ne sont pas insulaires mais péninsulaires ».
Quand je dis « remembrer notre humanité », je le dis aussi dans le sens de réinventer l’humanisme, en le décentrant, en faisant émerger les contre-récits, en éclairant ses zones d’ombre impériales, en en se mettant à l’écoute des subalternes, et en trouvant le moyen de faire entendre toutes les voix, d’où qu’elles viennent. Cet humanisme critique et séculier, tel que forgé par Edward Said, trouve sa sève originelle chez le philologue italien, Giambettista Vico. Celui-ci, prenant le contre-pied au XVIII° siècle du cogito cartésien -faisant du sujet pensant des Lumières le centre du monde- montre, selon Jacques Derrida, que « l’homme a de tout temps et dans toutes les civilisations été foncièrement poète ».
L’une des chercheurs les plus singulières dans ce registre, fondatrice de l’ethnopoétique, Florence Dupont, nous fait réaliser que le theatron grec n’est pas plus universel que la hila[1] de Sindbad, la halqa de Jamâa El Fna ou le Nô japonais, et qu’à l’origine, les fêtes dionysiaques n’étaient pas tout à fait des drames écrits mais des rites situés, essentiellement chantés, comme pouvaient l’être les rituels du hakawati en Orient ou le conteur griot chez les nomades subsahariens. La différence est que le modèle grec a été à partir du XIX° siècle, refaçonné, repartagé et universalisé. Et il a fallu plusieurs décennies et l’effort de chercheurs patients et justes, avant que le théâtre, entendu dans son sens occidental, devienne un sous ensemble d’une pratique humaine diverse qui l’englobe et le dépasse.
La nécessité de déconstruire les nouages et faire lien avec l’immensité est une responsabilité partagée entre chercheurs et artistes. C’est dans ce sens que j’ai eu le plaisir, dans le cadre de la chaire Fatéma Mernissi, de lancer aux côtés de mon ami et complice, le curateur, poète et traducteur, Omar Berrada, un projet appelé Houdoud (voulant dire en arabe frontière et limite), oxymore, invitant de jeunes chercheurs et artistes visuels et performatifs à interroger ces questions-là en sortant des limites que leur imposent leurs disciplines respectives et chercher à interroger le passage, le déplacement, en l’expérimentant eux-mêmes.
Aujourd’hui, la responsabilité de ces traversées incombe davantage aux lieux, structures et institutions alternatives, marginales qui tentent de refonder les interactions, les dialogues, en se débarrassant des hiérarchies héritées, des logiques marchandes dominantes et des cloisonnements académiques et économiques consacrés. C’est ce que font les connecteurs organiques qui tressent des pratiques, des sensibilités et des discours non convenus. C’est le cas de Chimurenga à partir de l’Afrique du Sud, de Dream City à Tunis, de l’Appartement 22 à Rabat, des ateliers de la pensée à Dakar ou encore Le 18 à Marrakech. C’est aussi ce que tente de réinitier le projet du Bauhaus méditerranéen à partir d’ici, à Marseille en dialogue avec Berlin et Casablanca. C’est clairement ce qui, petit à petit, refonde l’agenda des bailleurs des arts et de la culture dans la région (comme AFAC à Beyrouth) qui réalisent l’urgence de défier les essentialismes de tous bords qui prennent racine des deux côtés de la rive méditerranéenne.
Tous les passeurs qui y officient, par les idées, le réseau et le tissage de nouvelles communautés, sont conscients et agissent pour rafistoler des ponts brinquebalants, pour tresser autrement l’histoire du futur à inventer. Et cette compétence géo-poétique, dans le sens que lui donne le poète martiniquais Edouard Glissant, est probablement ce qui donne le plus de sens à l’indisciplinarité de l’art. Parce que ces lieux qui relient pensée et arts, se révèlent être plus résilients et agiles que les instances de savoir et de conservation, où les résistances au changement sont fortement ancrées.
Évidemment, le diktat du marketing, des circuits, des modes, des étiquettes, des formats, des représentations vendables, font souvent écran aux créativités qui y échappent ou en détournent les codes. D’où la nécessité de s’approprier la force des liens faibles, non de sang mais d’amitié, non de filiation mais d’affiliations, telle que théorisée par le sociologue américain, Marc Granovetter. Cela implique de relier les relayeurs, de connecter les lieux, de densifier les contacts avec les sensibilités et les expérimentations qui bifurquent, surprennent ou juste rappellent avec délicatesse et talent ce que les amnésies construites tendent à effacer, ce que la mondialisation des valeurs tend à niveler ou ce que les disciplines apprises ne parviennent même pas à imaginer.
J’en conclus en un mot que les disciplines, quoique utiles, sont amputées, insuffisantes, dans le sens où elles ne contiennent pas en elles ce qui suffit pour saisir la multitude ou autoriser l’utopie. Qu’il ne suffit pas de faire de l’interdisciplinaire, de l’entre-deux, au risque de rester au milieu du gué ou d’instrumentaliser une discipline par l’autre. Et que l’enjeu est d’oublier les disciplines, d’élargir sa boîte à outils et garder en tête que l’essentiel n’est pas l’instrument mais la lune, pas la méthode comme modèle mais le chemin comme expérience. Et que cela nécessite une prise de risque permanente, un doute incessant et un attachement à l’humain dans sa beauté et sa complexité et un contournement des pouvoirs et cadres qui limitent le rêve de créer.
Driss Ksikes
[1] La ruse du voyageur nomade.