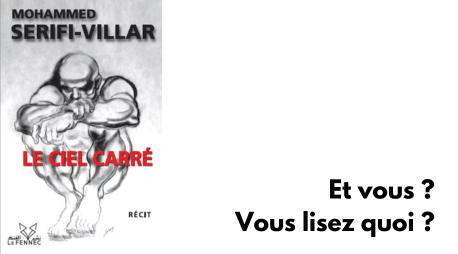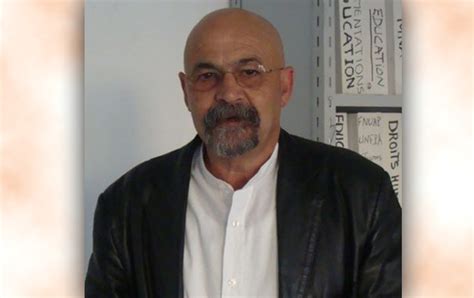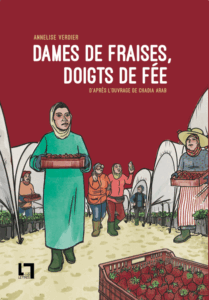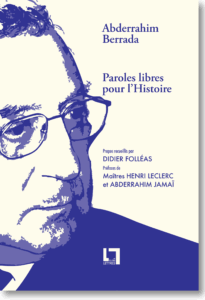Au-delà des entrailles de pierre
Plus de trente ans après sa libération, Mohammed Serifi-Villar éclaire à son tour l’univers carcéral que n’ont que trop connu ceux qui ont lutté pour la liberté et la démocratie. Un témoignage essentiel.
« Comment vivre en paix alors que ces lignes seront peut-être lues par nos anciens tortionnaires ? », s’inquiète Mohammed Serifi-Villar, dont le témoignage vient enrichir le corpus hélas abondant des témoignages de prison et, au-delà, souligne les persistances des structures de domination. Rojo, comme l’appellent ses amis, est fils d’une républicaine espagnole qui, devenue veuve, a fui Franco avec ses trois enfants orphelins, et d’un pêcheur qui, s’il ne savait ni lire ni écrire, lui a transmis un sens aigu de la dignité humaine. Élevé dans l’arabe, l’espagnol et le français, face à un bidonville tangérois, il comprend très tôt que « le régime se nourrissait de pauvreté, d’analphabétisme et de religion ». Avec ses aînés, il découvre la philosophie, et son « premier initiateur révolutionnaire », le Rousseau du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Inscrit à la fac de Rabat en licence d’espagnol et en sciences économiques, il milite à l’UNEM, rejoint Ilal Amam, est condamné d’abord à perpétuité par contumace en 1973 pour avoir revendiqué « l’émancipation des masses, la généralisation de l’enseignement, une réelle répartition des richesses, dans un cadre de liberté générale ». C’est ensuite la clandestinité, les tracts, la rencontre avec Christine Jouvin, future Christine Daure-Serfaty. Puis l’arrestation, Derb Moulay Cherif, le procès, les interminables années de prison…
Refuser l’oubli
Libéré parmi les derniers – dans la douleur d’avoir vu son père mourir de chagrin lors d’un discours de Hassan II décrétant « les laisser en héritage » à son fils – Mohammed Serifi-Villar raconte ces dix-huit années dans une nécessaire « schizophrénie » maîtrisée, pour à la fois surmonter la dureté de l’épreuve et ne pas devenir inhumain, insensible à la souffrance de plus fragile que soi. Au-delà de la violence de ce qui est raconté, c’est une expérience humaine d’une grande intensité qu’il retrace, non sans une certaine nostalgie : « Nous étions comme des sismographes captant toutes les possibles secousses, tous les regards, les bruits qui nous entouraient. »
Celles et ceux qui ont lu les nombreux témoignages de prison retrouveront des figures connues : celles des avocats, en particulier Me Abderrahim Berrada ; les militants amis et proches, comme Abdellah Zaazaa, Abdelaziz Mouride, Abraham Serfaty… ; il documente les sinistres agissements des tortionnaires, comme le sadique Kaddour Yousfi, nommé plus tard à la tête de la commission marocaine contre la torture… Comme ses prédécesseurs, Mohammed Serifi-Villar rend hommage au courage et à la dignité de ses parents, de sa compagne Rabea. Il raconte la solidarité en prison, les déchirures, puis la libération et la difficulté de revivre « parmi les humains », en prenant conscience des changements chez les gens.
Dans ce témoignage d’une grande lucidité politique, Mohammed Serifi-Villar analyse les ressorts de l’engagement politique comme « une réaction contre les événements du réel », nécessairement « alimenté par l’actualité du dehors » ; il insiste sur la souffrance d’être déconnectés, malgré les efforts pour s’informer. La force de ce livre, outre ce parcours exceptionnel de ténacité et de courage, est le lien qu’il fait entre différentes époques, par la nécessité d’un engagement pour une même cause : celle de la liberté et de la dignité humaine. Mohammed Serifi-Villar observe les évolutions de façade et conclut : « Si les transitions ne portent pas en elles les germes de leurs propres dépassements, elles finiront par être rattrapées par le poids du passé, qui pèse, encore, très lourdement, dans notre présent, et vie. »
Et vous, vous lisez quoi ?
Kenza Sefrioui
Le ciel carré
Mohammed Serifi-Villar
Le Fennec, 332 p., 140 DH