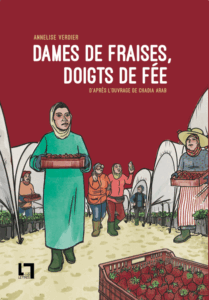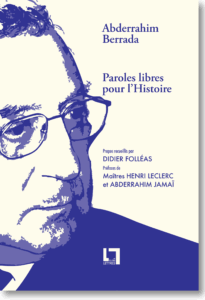« Le livre et les livres » ouvre les Nuits des philosophes
Pour le coup d’envoi de la 4ème édition des Nuits de la philosophie à Rabat, le 10 novembre dernier, il a bien sûr été question de livres. Jean-Claude Monod, qui assurait le commissariat de l’événement aux côtés de Driss Ksikes, a prononcé la conférence inaugurale sur « Le livre et les livres. »
 |
Jean-Claude Monod, directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l’ENS Paris, a beaucoup travaillé sur les rapports entre politique et religion, a choisi de s’attacher sur cet « objet moyen », qui vous donne parfois « le sentiment d’être anachronique », mais dont certains ont façonné des sociétés entières. Voyage, d’Homère au Manifeste du Parti communiste en passant par les Mille et Une Nuits à travers ce formidable véhicule d’idées, d’émotion, et de liberté.
Le livre et les livres
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisDuMaroc/videos/1537917762938679/
Le texte intégral ici.
La philosophie ne serait sans doute pas née – du moins sous la forme qu’elle a prise en Grèce ancienne – si des gens n’avaient pas ressenti tout à la fois le besoin et le plaisir de parler ensemble des choses les plus diverses : pas seulement des « affaires courantes » ni seulement des affaires politiques, mais de discuter – peut-être parfois des nuits durant – de la nature et de l’invisible, de ce que nous pouvons connaître et de ce que nous pouvons espérer, de l’injustice et de l’égalité, et de ce que veut vraiment dire cette opération même : discuter pour approcher une certaine vérité…
À notre tour nous allons donc parler, mais le sujet dont j’ai choisi d’aborder maintenant – le Livre (avec une majuscule) et les livres (minuscules) peut surprendre : pourquoi s’attarder sur cet objet, qui semble n’être après tout qu’un moyen, un véhicule pour transmettre du sens ?
Le fondateur même de la philosophie, Platon, n’a-t-il pas marqué l’infériorité de l’écriture par rapport à la parole ? Pourquoi cette infériorité ? Parce que dans la parole on peut répondre de ce qu’on a dit, lui porter secours, – et on voit que c’est l’un des intérêts d’événements comme ces Nuits : nous allons tous pouvoir débattre de ce que nous avons dit parce que nous sommes là en chair et en os ! Alors que l’écriture, d’après le Phèdre de Platon, est à la fois comme « morte » et comme « orpheline » : son auteur, son père ou sa mère n’est pas là quand on lit pour pouvoir venir s’expliquer, justifier ou corriger ce qu’on a dit… On observera cependant que cela n’est plus si vrai avec l’apparition de l’écriture électronique et des chats, des discussions écrites en direct, des dialogues par « posts » interposés : les thèses philosophiques sur l’écriture perdent en pertinence à mesure de ses transformations technologiques.
Quant au présent, il ne semble pas plus favorable à notre objet : encore il y a dix ans lorsqu’on prenait le métro à Paris et qu’on lisait un livre, on était un parmi un certain nombre de lecteurs ; aujourd’hui, on est bien souvent tout seul au milieu d’une forêt incandescente de smart phones, on se sent exotique et presque anachronique !
Certes, sur ces smartphones et ces tablettes, on continue bien de lire et d’écrire – et l’on peut se demander si le livre n’aura pas simplement été un support passager, un moment dans l’histoire de cette forme plus fondamentale : l’écriture. L’écriture a précédé le livre et lui survivra sans doute s’il disparaît.
Ce serait, ou ce sera pourtant un bouleversement, peut-être déjà à l’oeuvre, car le livre et les livres ont été d’une importance décisive dans la configuration culturelle de l’humanité, en particulier dans la culture européenne et dans la culture arabo-musulmane; d’abord ceux qu’on a désignés comme « les Livres » ou le Livre majuscule, les Livres sacrés, la Torah, les Évangiles, le Coran, les Livres fondateurs de ce qu’on a appelé les « religions du Livre ». Cette désignation est d’ailleurs une invention musulmane, c’est dans le Coran que les juifs et les chrétiens sont désignés comme « gens du Livre ».
Faut-il en conclure que la figure du Livre majuscule, du Grand livre rassemblant l’enseignement essentiel, est une problématique héritée des religions abrahamiques (judaïsme, christianisme, l’islam) ?
Avec un autre statut, les Upanishad pour la religion hindoue constitueraient un tel « Livre », mais pour le bouddhisme on estime qu’il n’y a pas un Livre mais trois ensemble de textes, le premier portant sur la discipline, le second sur l’enseignement et le troisième sur des questions métaphysiques…
Il faudra y revenir. Bien sûr, au plan de l’effet « formateur de culture », on peut citer aussi une foule d’autres livres, non religieux, dont l’effet a été et demeure profond – peut-être plus souterrainement. Si l’on en croit le philosophe allemand Heidegger, notre rapport au réel, largement déterminé aujourd’hui par une appréhension scientifique et une domination technique du monde, s’origine dans la métaphysique et dans sa volonté de fixer la présence des choses par les Idées ; et ce « projet » s’est bien déposé, exprimé et transformé, selon ses « époques » et ses formes successives, dans des livres, de la République de Platon jusqu’aux fragments de Nietzsche sur la volonté de puissance, en passant par Descartes et le fameux projet de rendre l’homme « comme maître et possesseur de la Nature ». Alors on discute toujours pour savoir si Heidegger n’a pas été victime d’une vaste « déformation professionnelle », comme s’il avait cherché dans la philosophie, dans les ouvrages marquants de l’histoire de la métaphysique, la clé de l’histoire réelle, – économique, technique, politique, de l’histoire tout court. C’est probable, mais on peut difficilement nier que certains livres ont « fait époque », ont paru saisir le mouvement même de leur temps, et ont pu à leur façon « transformer » les choses, les sociétés, les cultures, y compris au plan politique – pensons au Contrat social de Rousseau – qui a inspiré les acteurs de la Révolution française – ou au Manifeste du parti communiste ; et il faudrait bien sûr s’interroger sur les effets plus indirects mais parfois également marquants de la littérature, qui forge et imprègne des imaginaires – comme l’Odyssée (on a dit que Homère était « l’instituteur du peuple grec ») ou les Mille et une nuits, – mythes et contes dont le relais serait peut-être pris, aujourd’hui, par le cinéma ou les séries, par les expressions renouvelées du besoin humain de se raconter des histoires.
Écriture détachée du papier
Si l’on prend en considération cet effet « configurateur de culture » de certains livres, d’abord des Livres fondateurs des religions mondiales ou des formes politiques modernes, on aboutit alors à ce paradoxe : nous vivons aujourd’hui dans des sociétés qui ont été façonnées par des Livres et qui portent toujours l’empreinte de ceux-ci, mais où… on ne lit pratiquement plus… de livres. La précision est importante : où on ne lit presque plus de livres, cet objet particulier, mais on continue bien aujourd’hui, des deux côtés de la Méditerranée, de lire de nombreux textes – « posts » sur Facebook, articles trouvés sur des sites, « tweets » et jusqu’aux « textos » et sms échangés quotidiennement par dizaines par les adolescents de nos pays. En France en 2012 il avait été estimé qu’un adolescent envoyait en moyenne plus de 80 sms par jour.
On peut dire qu’en ce sens, on écrit peut-être plus qu’on n’a jamais écrit par le passé, mais l’écriture, le texte, la lettre, se sont détachées du Livre, de la page, du papier, de la ligne. Derrida, l’avait annoncé et pressenti dans De la grammatologie – nom d’une discipline imaginaire qui devait porter, justement, sur le « gramme », c’est-à-dire la « lettre » en grec (on trouve cette racine dans les mots télégramme, programme, grammaire…) ; les sms et textos sont ainsi faits de mots – à la graphie souvent transformée loin de l’ortho-graphe, beaucoup plus « phonétisée » ! – mais aussi de signes, réactivant des formes d’écriture non-alphabétiques, – des « émojis » et « émoticons » qui rappellent, en un sens, les anciens hiéroglyphes.
Contrairement à ce qu’on avait pu penser et attendre, donc, en s’attendant à ce que l’écriture disparaisse entièrement au profit de l’audio-visuel, pour l’heure le déclin du livre n’entraîne pas l’écriture dans sa chute, l’écriture prolifère sur de nouveaux supports.
Et c’est sans doute un événement dont les conséquences sont et vont être multiples, parce que l’écriture a toujours été, bien sûr, un vecteur de savoir, un instrument de conservation et de mise en forme du savoir, de diffusion de l’information, mais elle a toujours été aussi un moyen de pouvoir, dans les deux directions : un moyen d’exercer le pouvoir, et de le consolider, mais aussi un moyen de le contester.
J’aimerais profiter de cette situation où nous sommes d’éclipse du Livre pour aborder trois questions : d’abord, cette idée même du Livre majuscule, qui peut être le Livre sacré mais il y a eu aussi, comme on va le voir, d’autres conceptions – politiques, poétiques – du Livre qui contiendrait toutes les réponses essentielles ; ensuite, j’aimerais évoquer la tension entre cette idée du Livre majuscule et l’existence des livres, c’est-à-dire d’une multiplicité d’interprétations et de perspectives sur le monde ; et je reviendrai brièvement, pour finir, sur certaines mutations actuelles.
Interpréter le livre du monde
Un ouvrage d’un (autre) philosophe allemand du XXème siècle, Hans Blumenberg, s’intitule La Lisibilité du monde. Il s’attache à la métaphore du Livre comme unité de sens qu’on pourrait déchiffrer : cette métaphore a été appliquée au monde ou à la Nature dans la philosophie et la science, y compris dans la science moderne, [avec la fameuse formule de Galilée : « la Nature est écrite en langage mathématique »].
Certes, cette idée d’une structure mathématique du monde était présente dès les origines de la science et de la philosophie occidentales, chez Pythagore ; mais le fait de parler du monde comme d’un Livre, estime Blumenberg, aurait été tout à fait bizarre pour un Grec ancien. Pourquoi ? D’une part, parce que le livre, en Grèce ancienne, était un objet rare, plutôt un papyrus, et n’était pas valorisé : il était vu comme un support mort pour des traces. On le constate dans le fameux dialogue de Platon sur l’écriture auquel j’ai fait allusion, le Phèdre.
Mais donc, l’idée qu’un livre puisse, en quelque sorte, contenir la totalité du monde – ou toutes les réponses aux questions que l’on pourrait se poser sur lui – était étrangère aux Grecs : pour qu’elle fût possible, il fallait l’idée de « Livres sacrés » comme la Bible, alors que la religion, en Grèce ancienne, était plutôt affaire de rites et de transmission orale, il n’y avait, de ce fait, pas vraiment de « dogmes », plutôt des « mythes »…
Avec les Livres sacrés énumérant des commandements et racontant la genèse du monde, quelque chose apparaît qu’on peut appeler Le Livre majuscule, le livre divin. Mais on retrouve ici le caractère second de l’Ecriture : ce Livre est présenté comme la consignation d’une « Parole » divine, transmise à et par un ou plusieurs prophètes, – Moïse, Jésus, Mahomet – ou, dans le cas de Mahomet, ai-je vu, on dit plutôt que les « versets » divins ont été « déversés » sur Mahomet.
Notons que cette notion a conduit certains philosophes, comme Spinoza, à soulever des questions bizarres mais intéressantes. Par exemple celle-ci : la Révélation que consigne un Livre sacré est la parole de Dieu ; mais en quelle langue Dieu parle-t-il ? Y a-t-il une langue de Dieu ou bien Dieu parle-t-il la même langue que les hommes ? De toute façon, s’Il veut se faire comprendre des hommes, il faut bien qu’il parle leur langue. Mais laquelle ? Dans la Genèse, il est posé qu’il y a eu une langue primitive universelle, parlée au Paradis par Adam – entouré d’animaux, Adam leur trouve des noms. Mais les invente-t-il lui-même, ou bien les noms lui sont-ils soufflés par le Créateur ? Quoi qu’il en soit, il y a l’idée qu’il y avait d’abord une langue unique, peut-être directement soufflée par Dieu, mais cette la langue unique aurait disparu avec l’épisode de la tour de Babel. Là, Dieu empêche les hommes de monter jusqu’aux cieux en répandant entre eux la diversité des langues, semant la confusion : ils ne se comprennent plus et n’arrivent plus à construire leur tour. Mais dès lors, quelle langue utilisera Dieu pour sa Révélation ? Réponse : La langue de son ou de ses prophètes : l’hébreu avec Moïse, dans le cadre d’une Alliance avec le peuple élu, l’arabe avec Mahomet… et pour le christianisme, les choses se compliquent, du fait que les Évangiles sont écrits dans une langue (le grec) différente de celle que parlait Jésus (l’araméen) ; le livre saint est ici déjà lui-même une « traduction ».
Un certain nombre de théologiens chrétiens refusent donc la formule « religion du Livre » pour le christianisme et insistent, dans le sillage de Saint Paul, sur la prééminence de « l’esprit » par rapport à la « lettre » : « la lettre tue, et l’esprit vivifie », c’est une sorte de variation sur le thème de Platon, le « Logos », la parole est vivante, l’écriture, elle, est figée, il faut lui « donner sens » par l’interprétation. Origène, un Père de l’Eglise du IIIème siècle, affirme que celui qui lit le texte à la lettre et s’y arrête peut être comparé à un blasphémateur car il réduit Dieu à des affaires littérales.
Mais dès lors qu’est reconnu un espace pour l’interprétation, dès lors qu’on constate que les religions du Livre sont pour une part des religions de l’interprétation, le Livre, rapidement, se dédouble : accompagnant la Torah, il y a le Talmud, c’est-à-dire un corpus d’interprétations et de commentaires anciens et traditionnels du judaïsme sur la Bible, et plus précisément sur la Torah. L’Évangile se décline au pluriel, selon ses rédacteurs, si bien qu’on parle plutôt des Évangiles et comme tous rapportent en principe la parole de Jésus, leurs différences ouvrent un espace de comparaison, de recoupement et d’interprétation. Avec le Coran il y a les hadiths, et l’importante distinction entre versets univoques et équivoques, explicites et versets non-explicites implique que pour ces derniers au moins un travail d’interprétation est nécessaire. Certes, il est dit au verset III, 7 que seul Allah lui-même connaît l’interprétation du Coran, mais ce qui suit immédiatement diffère selon… les interprétations de la ponctuation, absente dans les exemplaires anciens du Coran. En raison de l’absence de ponctuation dans les versions anciennes du Coran, deux traductions sont possibles, qui renvoient à deux interprétations, chacune donnant alors une place différente à l’interprétation « humaine » –savante : une scansion dit : « Nul autre que Dieu-Allah ne connaît l’interprétation du Livre. [Point.] Ceux qui sont enracinés dans la science disent : ‘nous y croyons ! Tout vient de notre Seigneur !’ ».
Une autre transcription autorisée, reprise par Averroès dans le Discours décisif lit le même verset autrement : « Nul ne détient la science de l’interprétation du Livre sinon Dieu-Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Ils disent : « ’nous y croyons ! Tout vient de notre Seigneur !’ ».
Alors, Dieu seul ou Dieu et ceux qui sont ancrés dans la science ? Et si même Dieu seul connaît l’interprétation juste, les hommes ne doivent-ils pas chercher à approcher cette interprétation ?
Il faudrait aussi savoir qui sont ces hommes « ancrés dans la science », mais je laisse cela… Toujours est-il qu’on peut poser ceci : tout Livre appelle une interprétation, et avec cette ou ces interprétations, ce sont bien souvent de nouveaux livres qui apparaissent ou qui sont sollicités, traduits, pour aider à comprendre le Livre ou pour le compléter. Ainsi les philosophes arabes d’Andalousie comme certains philosophes persans du Moyen Age ont-ils traduit et commenté des ouvrages de multiples traditions, pour comprendre le monde mais aussi pour éclairer le Coran, la prophétologie – Al Farabi, qui parlait un grand nombre de langues et fut surnommé « le second maître » – après Aristote – a ainsi comparé le prophète et le philosophe-roi de Platon, par exemple, pour mieux comprendre leur statut respectif. Du côté chrétien, dans la Somme contre les Gentils, Thomas d’Aquin soulignait la nécessité d’acquérir des connaissances scientifiques pour le croyant, sans quoi il risquerait de « prendre pour article de foi quelque chose » dont il est facile de prouver qu’il s’agit d’une erreur manifeste, et exposera alors « la vérité de la foi à la risée de l’incroyant », écrit Thomas d’Aquin. D’où sa formule célèbre, en latin : timeo hominem unius libri, « je crains l’homme d’un seul livre », au sens où celui qui croit qu’il peut se dispenser des autres livres et des connaissances acquises au cours du temps ne rend pas service à la foi elle-même.
Avec ces philosophes musulmans et chrétiens du Moyen Age, on est au plus loin de ce qui a été décrit, à propos de mouvements régressifs actuels, comme des formes de « sainte ignorance » qui prélèvent des fragments de textes – souvent les plus violents ou les plus liés à des mœurs anciennes, notamment sur les rapports entre les sexes –, sans les contextualiser ni les balancer par la prise en compte d’autres textes.
Pour en revenir à la lisibilité du monde : ce qui intéresse Blumenberg, c’est le fait que dans la culture occidentale on s’est assez vite mis à parler métaphoriquement de deux livres, le livre de Dieu, disons, et… le Livre du monde.
C’est une image qu’on trouve par exemple chez Saint Augustin. C’est dans son allégorèse du Psaume 45 que l’on trouve la métaphore des deux livres, je cite : « que la page divine soit pour toi un livre afin que tu l’entendes ; que le cercle du monde soit pour toi un livre, afin que tu le voies. Seuls ceux qui connaissant les lettres lisent ces volumes ; dans le tout du monde, même l’ignorant lit ». Il faut admettre que Dieu n’a pas seulement écrit ou dicté le livre de la révélation, mais qu’Il est d’abord l’auteur de l’autre livre, le livre de la Nature, (contre ceux qui se demandaient si le monde n’avait pas été créé par un mauvais démiurge, les gnostiques, qui avaient tendance à opposer le faux dieu créateur et le vrai Dieu, sauveur).
Craindre « l’homme d’un seul livre »
Avec la figure du Verbe divin, du Logos déposé en Un livre, du Livre sacré comme lieu où est déposée une Vérité, le judéo-christianisme ouvrait ainsi la possibilité de la métaphore du monde comme livre. Mais il semblait la fermer aussitôt en posant ce que Blumenberg appelle « l’absolutisme du Livre » : la Bible contient tout, et dès lors prétendre lire dans la Nature un contenu de vérité sans la médiation de l’écrit sacré est dénoncé par certains Pères de l’Eglise comme dénué de sens ou impie. Autrement dit, note Blumenberg, aussitôt que le livre a été « autonomisé en une expérience propre de la totalité, comme c’est exemplairement le cas (…) dans le Livre des livres, l’expérience du livre entre en rivalité avec l’expérience du monde » (LW, p. 11).
Cette rivalité est présente chez Saint Augustin, qui avertit ses lecteurs : il ne faut pas que la curiosité pour le monde devienne trop forte et fasse oublier… la cura, le souci pour le salut de l’âme ; il ne faut pas que le livre du monde détourne du livre de Dieu. (Un autre Père de l’Eglise dit plus radicalement : on n’a plus besoin de curiosité après le Christ !)
Pourtant, au cours de l’histoire du christianisme on voit ces questions ne cesser de revenir : Est-ce que le livre de Dieu (ici la Bible) contient toutes les réponses sur le monde ? Ou bien la créature humaine n’est-elle pas appelée, par Dieu même qui l’a faite intelligente, à chercher à « comprendre » le monde qui se donne à voir et qu’elle cherche à « déchiffrer », aiguillonnée par une curiosité qui ne saurait être entièrement égarante ? Est-ce qu’alors le livre du monde (métaphore pour la Nature) doit être interrogé en quelque sorte à partir de lui-même, avec d’autres façons d’interroger, un autre rapport à l’expérience plutôt hérité… des Grecs, rapport qu’on appellera : la science ? Comment concilier les enseignements des deux livres, faut-il penser que le livre religieux enseigne plutôt la bonne conduite, la « loi », tandis que les vérités sur la nature sont plutôt le fait de la science ? Que faire de ces commandements eux-mêmes quand ils paraissent liés à des formes de vie disparues, contraires à la morale commune ou ce qu’on appellera plus tard la « raison pratique », – par exemple en ce qui concerne la violence ou l’inégalité ? Ces mêmes questions se retrouvent chez les savants musulmans, par exemple dans l’Andalousie musulmane du XIème siècle, – même si Blumenberg ne mentionne pas d’exemple de la métaphore du livre du monde chez Averroès ou Avicenne, on trouve en revanche chez Averroès la distinction entre une « science divine » et une « science humaine », la philosophie, qui porte sur le monde et doit pouvoir être poursuivie librement, au moins chez les philosophes eux-mêmes ; et je trouve dans l’Histoire de la philosophie islamique d’Henry Corbin (1964, rééd. Folio, 1986, p. 251) une mention comparable du « livre de l’être », dont la méditation est opposée à l’apprentissage à travers les livres de la tradition (philosophique, cette fois), chez Abu-l-Barakat al-Badghdadi : « s’il a lu les livres des philosophes [dit-il], il a lu aussi le grand ‘livre de l’être’, et ce sont les doctrines suggérées par celui-ci qu’il lui est arrivé de préférer à celles des philosophes traditionnels ».
De son côté, Blumenberg montre que le développement de la science en Occident a impliqué d’autonomiser le livre de la Nature par rapport au Livre divin, mais aussi par rapport à des livres dont la scolastique, au Moyen Âge, avaient fait « l’autorité intellectuelle » par excellence, comme ceux d’Aristote.
En présentant la Nature comme un livre chiffré, c’est un véritable programme de déchiffrement qui est inscrit dans cette métaphore, mise en avant par Kepler et Galilée : « la nature est écrite en langage mathématique » – ouvrant vers la mathématisation de la physique, tandis que les philosophes modernes, pour se libérer de l’absolutisme du Livre, ne cessent d’insister sur la « fraîcheur » de l’expérience par contraste avec des « livres » antiques et dépassés.
Il serait beaucoup trop long de suivre toutes les transformations ultérieures de la métaphore des deux livres qu’étudie Blumenberg, notons seulement deux éléments. D’un côté, le programme scientifique de déchiffrement du monde se poursuit aujourd’hui et est même porté à son comble, avec l’idée d’un déchiffrement du génome humain, d’une « carte génétique » qui définirait chacun d’entre nous. De l’autre, les succès de la science moderne ont entraîné le développement de méthodes de recherche, d’établissement des faits, qui ont été, à leur tour, appliquées… aux Livres sacrés, avec un mode de lecture historique et critique – faisant apparaître les couches successives de leur élaboration.
Mais l’idée du Livre majuscule, du Livre unique n’a bien sûr pas disparu pour autant, et on peut se demander si elle ne renvoie pas à une aspiration, à une tendance de l’Esprit – aspiration qui n’est pas seulement religieuse, mais qui a pu prendre des formes poétiques ou politiques. Blumenberg rappelle qu’on trouve ainsi dans la poésie moderne, dans le romantisme allemand ou chez Mallarmé par exemple, l’idée que tout (grand) poète aspire peut-être à écrire Le livre, le Livre définitif ; et dans le champ politique, certains livres ont pu être constitués en fondements absolus et en clés pour une compréhension totale de l’histoire.
J’ai emprunté le titre de cette intervention, « Le Livre et les livres », à des « entretiens sur la laïcité », un dialogue entre Benny Lévy et Alain Finkielkraut, où il était suggéré que le religieux était plutôt l’homme du Livre (unique), le Livre (en l’occurrence la Torah, ou le Talmud) comme « loi » d’une existence – tandis que le laïc, la laïcité seraient l’homme et le cadre pour lesquels tous les livres devraient être ouverts sur notre table, y compris, bien sûr, les livres saints, mais sans exclusive. Il me semble juste de dire que la laïcité suppose de considérer qu’aucun Livre n’annule tous les autres, qu’aucun Livre n’est vrai contre tous les autres, et qu’il faut préserver la libre recherche, par chacun, de la vérité. Mais le « religieux », dans ce dialogue, confronte le Livre sacré à une multiplicité d’ouvrages, et le « laïc » ne dénie pas à son interlocuteur le droit de donner un privilège absolu à un livre (à condition bien sûr que ce « privilège » ne se traduise pas en exclusion ou en criminalisation des autres livres, y compris ceux qui critiquent cette religion, ou des interprétations multiples de ce livre). – La laïcité n’est pas antireligieuse, mais fondée sur la liberté de conscience, et la reconnaissance de la pluralité « des » livres dignes d’intérêt est une position qui peut – et doit – évidemment être admise, qui l’a été et qui l’est, par de nombreux individus « religieux »…
Il y a des « religions du Livre », il y a aussi, dit-on, des « peuples du Livre », ou des « communautés » que le Livre saint entend « fonder », au-delà des divisions existantes entre « peuples » distincts : le « peuple de Dieu » catholique, l’umma musulmane… Un livre et des livres peuvent ainsi contribuer non seulement à former des peuples mais à transformer la religion des peuples entre eux, aussi bien que la relation des peuples à leurs « chefs », à leurs dirigeants politiques ou spirituels…
Éloge de la distance critique
Et on pourrait s’interroger, pour finir, sur les transformations actuellement à l’œuvre : quels effets politiques, cosmopolitiques, théologico-politiques a – et aura dans les prochaines années – le passage de l’imprimé au numérique, du papier à l’informatique, de la diffusion des journaux à la propagation virale des vidéos ? La Révolution française avait été rendue possible par la diffusion de l’imprimé, préparée par des pamphlets, de cahiers de doléances où le peuple exprimait ses colères et ses frustrations, etc. Or les formes de mobilisation politiques évoluent avec les techniques de communication, de même d’ailleurs que les formes de surveillance et de contrôle. Les révoltes et rébellions passent aujourd’hui par Internet, les réseaux sociaux, Facebook, – interdit en Chine –, toutes choses que les appareils d’État classiques ont du mal à maîtriser et à contrôler. Mais s’il peut se faire vecteur de lutte contre la corruption et le despotisme, Internet peut aussi être la caisse de résonance de la haine, de l’appel au meurtre, de l’apologie de la violence…
Il n’y a pas de réponse unique à ces processus, mais peut-être peut-on rappeler, alors, un intérêt de ces objets supposés obsolètes : les livres, précisément. Ceux-ci n’agissent pas avec l’immédiateté des images, ils ont sans doute un moindre pouvoir d’émotion – puissances des images, pour le meilleur et pour le pire ! –, mais ils ont parfois un plus grand pouvoir de réflexion. Seulement pour cela, il faut accepter de se débrancher du flux continu des « informations », qui tue la formation, la culture de soi, la « lenteur » nécessaire à la prise de distance et au jugement critique.
Il faut alors revenir sur le sentiment d’anachronisme du lecteur dans le métro parisien. Il y a une part de la philosophie qui est tournée vers l’avenir, celle qui se demande, avec Nietzsche, « combien d’aurores n’ont pas encore lui ? » Mais il y a aussi une part de la philosophie qui se nourrit du passé et qui sait que la raison, dont elle se réclame, ne date pas d’hier – on peut bien plutôt parler, avec cette tradition, d’une « raison bi-millénaire ». Celle-là doit défendre la lecture patiente des livres, et du Livre, au présent, au besoin contre le présent et contre les détournements si fréquents des textes, sacrés ou non, aussi bien que des images, à des fins de manipulation des esprits et de renforcement des haines.
Jean-Claude Monod