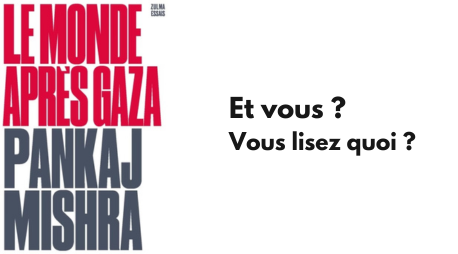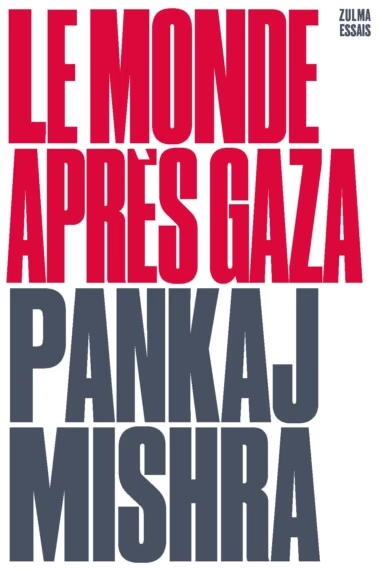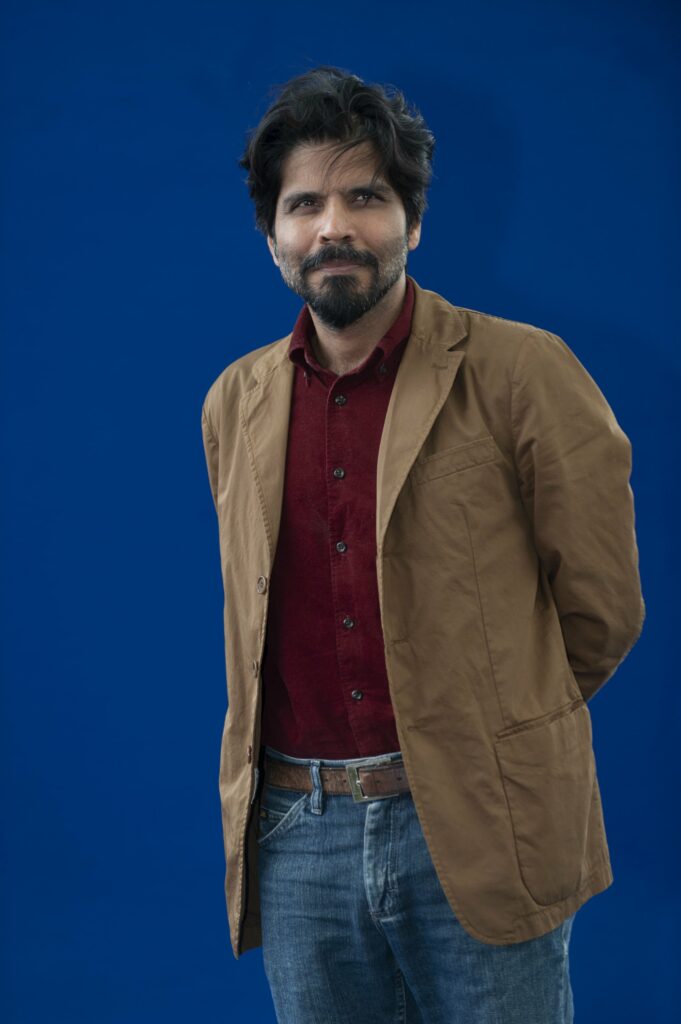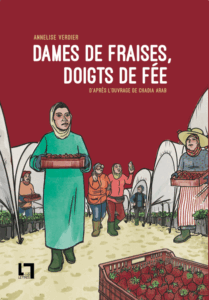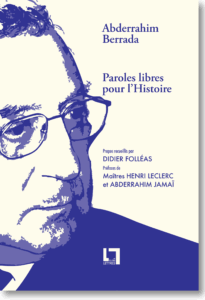Pour l’humanité, contre la concurrence mémorielle
L’essayiste indien Pankaj Mishra retrace la manière dont l’Occident a construit la Shoah comme une référence morale universelle et analyse les raisons de sa trahison face au génocide de Gaza.
Après L’âge de la colère, où il analysait les promesses non tenues de la modernité et de la démocratie promues par les Lumières, Pankaj Mishra pointe la nouvelle trahison de l’idéal humaniste à l’œuvre dans la complicité de l’Occident avec l’État génocidaire israélien et à sa « psychose survivaliste » – un « signe avant-coureur d’un monde épuisé, en faillite ». Dans cet essai très documenté, l’auteur propose une histoire de la Shoah dans les récits sioniste et occidental, mais aussi indien et du Sud global, pour montrer l’articulation complexe entre mémoires, éthique et intérêts économiques et politiques. « L’antagonisme entre Israéliens et Palestiniens, qui semble impossible à désamorcer, épouse aujourd’hui les contours d’une des lignes de fracture les plus traîtresses de l’histoire moderne : la “ligne de couleur”, décrite par W. E. B. Du Bois comme le problème central de la politique internationale, c’est-à-dire celui de savoir “jusqu’où les différences de race […] serviront d’argument pour refuser à plus de la moitié des habitants de la planète le droit de jouir, autant qu’ils le peuvent, des opportunités et privilèges de la civilisation moderne” ».
Contre toutes les démagogies
Critique littéraire, c’est dans les travaux de Du Bois, Jean Améry, Primo Lévi, Hanna Arendt, Edward Saïd, James Baldwin, etc., que Pankaj Mishra puise la matière de ce récit passionnant, dont la préoccupation principale est de contrer la rivalité des récits mémoriels, issus de la Shoah comme de l’esclavage et du colonialisme. « Si les mémoires collectives sont censées exprimer des vérités essentielles, informant en profondeur les membres d’une communauté imaginaire de qui ils sont, et de quelle est leur place dans le monde, alors la mémoire du suprémacisme blanc des puissances occidentales compte aujourd’hui plus d’adhérents que la mémoire de la Shoah. »
Son livre rappelle également que les récits du sionisme et de la Shoah sont mouvants en fonction du contexte : « Il est bon de se souvenir que de tels réexamens du sionisme et de son évolution ont eu lieu dès les premiers temps de l’État d’Israël. » L’auteur insiste en particulier sur la manière dont l’Allemagne et les États-Unis ont été les relais du discours israélien sur la Shoah, la première pour obtenir « l’absolution morale d’une Allemagne insuffisamment dénazifiée et toujours profondément antisémite en échange d’argent et d’armes », les derniers opérant un déplacement du stigmate raciste : « bon nombre de nationalistes blancs visent maintenant à obtenir le même avantage moral en rejetant le stigmate de l’antisémitisme sur les musulmans pour s’en débarrasser, et en se proclamant solidaires d’Israël ». Pankaj Mishra critique d’autre part la fascination pour Israël dans les milieux nationalistes et populistes, comme dans l’Inde de Modi, elle aussi revendiquant une dimension religieuse et messianique.
L’enjeu de ce livre est de contribuer à redonner espoir dans la possibilité d’une éthique universelle, en rappelant la nécessaire lecture critique des récits présentés comme des blocs immuables, argument d’autorité pour faire obstacle à l’élan inédit issu de la décolonisation qui « apporta à la fois l’égalité raciale et la possibilité d’être acteur de l’Histoire aux non-Blancs en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les coins les plus reculés d’Asie et d’Afrique ». Un ouvrage passionnant et nécessaire.
Et vous, vous lisez quoi ?
Kenza Sefrioui
Le monde après Gaza
Pankaj Mishra, traduit de l’anglais par David Fauquemberg
Zulma essais, 304 p., 290 DH