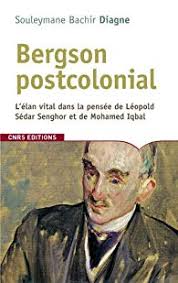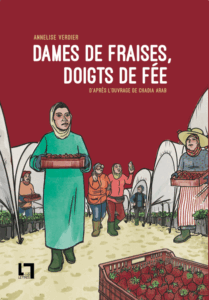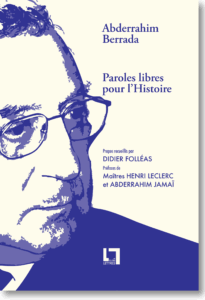Souleymane Bachir Diagne : « Penser le pluriel au cœur de tout »
Le 15 février à la Faculté des lettres et des sciences humaines, en parallèle du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca l’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne et le sociologue marocain Mehdi Alioua ont pris part à une table ronde sur le thème de « Penser l’Afrique dans le monde et le monde à partir de l’Afrique ». Chacun a abordé la question à travers les prismes de l’épistémologie, de la philosophie, de l’économie etc.
Synthèse de l’intervention de Souleymane Bachir Diagne.
« Dans le discours le plus authentique que nous pensons tenir sur nous mêmes, il est toujours possible que des éléments extérieurs se soient logés. Le post-colonial peut en effet simplement reprendre, pour le détourner ou le renverser, un discours déjà tenu sur nous.
Dans le cadre des Ateliers de la pensée, mis en place par Felwine Sarr et Achille Mbembe, nous essayons de tenir un discours qui ne soit pas obsédé ni par la répétition ni par la rupture, qui parte des problèmes et se donne les moyens de les penser. Les problèmes, on les rencontre, nous a enseigné Gilles Deleuze. Rencontrer un problème et le penser, c’est faire en sorte que le problème vienne avec les éléments théoriques qu’exige sa solution.
En 1955, la conférence de Bandung marque le début de la pensée postcoloniale – même si le mouvement des décolonisations a précédé cette date. À Bandung, 29 États proclament qu’aucune culture n’est justifiée en quoi que ce soit si elle se lance dans l’aventure d’en coloniser une autre. Ce principe ne figurait dans aucune déclaration antérieure. Coloniser quelqu’un d’autre au prétexte de lui apporter sa culture n’avait jamais été condamné explicitement. À Bandung, des pays asiatiques et africains se réunissent sans avoir été convoqués par ce qui était le centre, l’Europe : l’idée d’un monde décentré, où l’Afrique est en position d’aborder par elle-même les questions qui la touchent, émerge. Le monde de Bandung n’a plus de centre. Se recentrer sur nous-mêmes n’est pas réinventer un autre centre, mais dire que le monde est pluriel et sans centre, et que dans ce monde, c’est à nous Africains de penser les problèmes qui sont les nôtres.
Le postcolonial serait ainsi le versant culturel de ce projet politique, la proposition épistémologique pour dire : « Nous ne pensons pas dans des catégories à nous imposées, en particulier celle d’un universel qu’on considère naturellement incarné dans les cultures et langues européennes. » Le pluriel a fait irruption, avec les masses afro-asiatiques, dans nos manières de penser le monde : il ne peut pas y avoir un universel dicté par une région du monde. Après Bandung, on dit que l’universel n’a jamais eu lieu, et non pas que l’universel s’est fractionné. Si l’universel s’est défini sans les langues qui ont donné aussi visage à l’aventure humaine, alors il n’a pas encore eu lieu.
Est-ce que cela veut dire se donner une épistémologie particulière ? Déclarer que les humains sont multiples, et qu’il y a donc une pluralité irréductible d’épistémologies (une « occidentale », « africaine »…). Toute ma démarche consiste à dire que cela n’a aucun sens.
Au fond, le postcolonial est sans date : est postcolonial tout propos qui fait pièce au colonialisme, à l’idée qu’une langue puisse s’attribuer une dimension impériale qui exigerait des autres qu’elles s’alignent sur elle. Dans Bergson postcolonial (CNRS, 2014), j’écris que la pensée de Bergson aura été ainsi postcoloniale car les outils théoriques qu’il a mobilisés ont servi à nourrir la manière de penser les problèmes de l’Afrique, de l’Inde etc. L’élan vitalde Bergson, qui est le cœur de sa philosophie, va avoir, de manière inattendue peut-être, une résonance particulière dans le monde colonial.
Le postcolonial n’est donc pas une rupture mais une relecture. Il ne s’agit pas de déplacer le centre du monde, mais de décentrer celui-ci. Il s’agit de penser le pluriel dans le tout. Le Bandung épistémologique faisant suite au Bandung politique est à la base de notre questionnement.
Aujourd’hui, parmi les problèmes à résoudre, il y a l’unité africaine. Feu l’OUA est devenue l’Union africaine. Et parler d’unité est se rappeler que le Sahara n’a jamais été un mur qui a séparé deux mondes africains. Dans l’histoire, il a toujours été un espace traversé, partagé. Pendant des centaines d’années, l’espace de l’Ouest africain était en contact avec le monde de l’islam dans son ensemble. Il faut que nous sachions penser l’unité africaine à travers le Sahara, qui a toujours été traversé par des biens, des personnes, des savants, des étudiants. On ne comprend rien à l’histoire intellectuelle de l’Afrique si on ne comprend pas cela.
La grande division entre un monde nord-africain qui relèverait de l’orientalisme (science des sociétés islamiques, arabes, avec écriture) et un sud-Sahara qui relèverait de l’anthropologie (science des sociétés sans écriture) se traduisant en spécialisations (qui pouvaient faire qu’on soit un ethnologue spécialisé dans l’Afrique de l’ouest sans rien connaître de l’islam) est une absurdité. Lorsque les occupants du Nord Mali sont arrivés à Tombouctou et ont commencé à détruire les tombes des « 313 saints », l’opinion internationale s’est mise à craindre pour les manuscrits : elle découvrait que considérer les cultures africaines comme par essence orales était un stéréotype faux.
C’est un nouveau panafricanisme qu’il faut réinventer. Le panafricanisme est né dans les Amériques et s’est pensé d’abord comme une réunification entre nouveau et ancien monde, avec le retour possible de ceux que l’esclavage avait arrachés au continent. Progressivement, cet idéal a été recontinentalisé, et le témoin a été passé à des leaders en Afrique (Krumah, Nasser, etc.). Ainsi, il s’est déracialisé aussi : ce n’était plus seulement d’une solidarité noire qu’il s’agissait, portée par la mémoire de l’esclavage, mais d’une unité continentale du Cap au Caire, qui ne ferait pas fi du pluriel et des différences. C’est cette Afrique-là qui pèsera dans le monde.
La pire chose qui pourrait nous arriver serait le jacobinisme. Il faut construire l’unité africaine à partir d’une insurrection du pluriel au sein de chaque État nation. Le pluralisme linguistique, religieux, culturel, est ainsi extrêmement important. C’est une Afrique réconciliée avec elle-même, et qui aura détruit les frontières internes, qui pèsera dans le monde : construire le continent c’est lever les barrières à l’intérieur de ce continent.
La trajectoire suivie par le Maroc est pleine de signification. En ayant une politique orientée vers le sud, en réclamant sa place dans l’Ouest africain, le Maroc réclame sa place dans l’espace atlantique. Cela respecte des cohérences historiques et économiques. »
Propos recueillis par Kenza Sefrioui