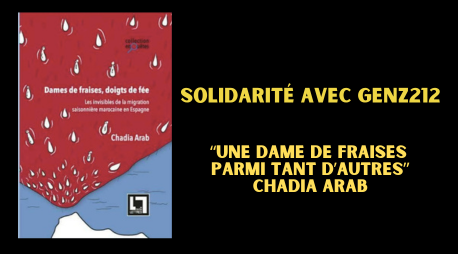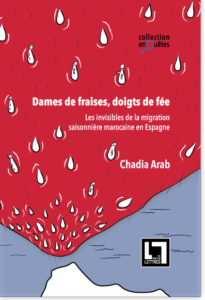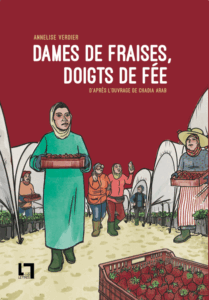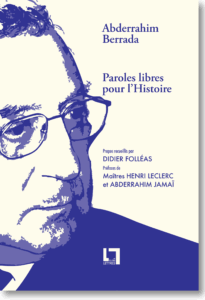Une dame de fraises parmi tant d’autres
En solidarité avec les revendications pacifiques et légitimes de justice sociale du mouvement GenZ212, En toutes lettres vous donne accès libre à plusieurs textes parus dans la collection Enquêtes, qui témoignent des conditions de vie indignes de nos concitoyens.
« Je ne suis jamais allée à l’école. Seuls les hommes de ma famille ont pu y accéder, ainsi que ma dernière sœur qui est allée jusqu’en quatrième année au collège. J’ai été mariée à l’âge de 15 ans. Je ne voulais pas, c’est mon père qui m’a fortement incitée à accepter, je n’ai pas eu le choix. Mon mari était militaire. Nous sommes restés quatre ans ensemble. On avait plutôt une bonne relation, mais c’est avec ma belle-famille que cela se passait mal. Mon mari travaillait au Sahara, il était absent assez souvent. Je devais m’occuper de la maison de sa famille et supporter les remarques désobligeantes de sa mère. Après une énième dispute virulente, je me suis enfuie avec notre fils en bas âge. Mon mari a tenté de me faire revenir, mais en vain. Il s’est aussitôt remarié et a emmené sa nouvelle femme avec lui au Sahara. Moi, je me suis retrouvée seule, à me battre pour récupérer mon fils resté chez mon ex belle-famille. Grâce à un avocat, j’ai pu le reprendre. Puis j’ai entamé une procédure pour obtenir une pension pour l’élever, mais j’ai dû abandonner assez rapidement, car la procédure était longue, complexe et chère. À aucun moment, mon ex-mari ne m’a aidée pour l’éducation de notre fils.
Je me suis alors prise en main. Ma famille est très pauvre, il est hors de question d’être une charge, avec deux bouches de plus à nourrir. J’ai cherché du travail. Dans un premier temps, mon père ne voulait pas que je travaille hors du village. J’ai fait de la broderie à domicile et ai essayé de la vendre, mais cela ne rapportait pas assez. Mon fils va à l’école et travaille bien. Mais il lui faut des livres et des cahiers que je ne peux acheter. Plus il grandit, plus il a des besoins que je ne peux satisfaire. J’ai convaincu mon père de me laisser aller travailler dans une usine de piments rouges, qui produit des sachets de paprika. Le responsable de cette entreprise était espagnol. Il venait me chercher en camionnette pour m’amener à l’usine. J’avais un salaire de 30 dirhams (environ 3 euros) par jour et travaillais de 7 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Mais l’entreprise a été mécanisée et il y a eu moins besoin de personnel. Puis le patron espagnol est décédé et l’usine a fermé. Je n’y ai donc travaillé que quatre ans. Là, j’ai connu d’autres femmes dans le même cas que moi, dans la précarité car divorcées ou veuves avec enfants. Ça a été ma première vraie expérience professionnelle.
Ensuite, il a fallu retrouver du travail. J’ai voulu aller au mawkef[1], mais c’était loin. Il fallait aller à Afourar, habiter là-bas. Mes parents ne voulaient pas, car les filles du mawkef ont mauvaise réputation, ils avaient peur que je devienne comme elles. Une cousine qui était divorcée m’a proposé d’aller à Agadir avec elle pour travailler. Mon fils était en CE2 et demandait de plus en plus de moyens financiers, mais mon père n’a pas voulu que j’aille à Agadir. La première année, je l’ai écouté et ne suis pas partie. L’année suivante, c’était tellement dur financièrement que je ne l’ai plus écouté. On est allées à Béni Mellal chez une fille qui allait partir. On a fait le voyage avec elle, elle nous a logées quatre jours à Agadir. Avec ma cousine, on a fait le tour des usines d’Agadir. Mais à chaque fois, on nous demandait si on avait fait des études, et nous, on ne voulait pas mentir. On est allées dans une usine de fleurs tenue par un Espagnol, mais lui aussi nous a demandé si on avait été à l’école. Toutes les deux, on a répondu que nous n’avions pas été scolarisées. On les a suppliés de nous prendre mais ils ont refusé. On est allées à l’usine de poisson au port d’Agadir. Comme j’avais une expérience de travail en usine, l’employeur a accepté de me recruter, mais pas ma cousine. Et comme on ne souhaitait pas être séparées, j’ai refusé. Puisqu’il était difficile de trouver du travail à l’usine, on est allées faire le tour des fermes. Mais ma jeune cousine, qui n’avait jamais travaillé et avait été élevée en ville, n’a pas supporté le travail à la ferme. On a commencé à travailler, moi à la cueillette d’haricots et ma cousine à la cueillette de fraises. Au bout de deux jours, elle a abandonné, mais moi j’ai tenu pendant une semaine.
J’ai travaillé plusieurs mois à Agadir. À mon retour de vacances, j’ai emmené avec moi d’autres femmes de mon village, des divorcées et des veuves qui avaient besoin de travailler. Nous avons d’abord été dans les champs. On cueillait, selon les saisons, des haricots, des piments, des tomates, des petits pois, des courgettes, etc. Nous étions payées environ 50 dirhams (environ 5 euros) par jour. Je logeais avec d’autres filles dans des maisons qu’on louait à plusieurs. Le jour du souk, le patron nous emmenait faire nos courses. Il y avait aussi des hommes, mais dans les champs, nous étions séparés. J’ai ensuite travaillé dans une usine d’emballage de tomates tenue par un Espagnol. Le responsable était content de mon travail, car je suis travailleuse, consciencieuse et rapide. Je travaillais de 7 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, et touchais 5,50 dirhams de l’heure. Parfois, je faisais des heures supplémentaires de 18 heures à minuit. On travaillait nuit et jour pour pas grand-chose. Au Maroc, ce sont vraiment des salaires de misère.
Je suis restée sept ans à Agadir. Ensuite, comme mon père était malade, j’ai préféré rentrer. J’ai alors travaillé dans la cueillette des olives près de Béni Mellal.
L’opportunité de l’Espagne
Puis, en 2007, s’est présentée l’opportunité de l’Espagne. C’est une amie du village qui nous en avait parlé. Avec quatre de mes amies, on est allées s’inscrire et instruire nos dossiers auprès de l’ANAPEC, l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences[2]. Une de mes amies a été refusée : elle était divorcée mais son fils avait 24 ans, trop âgé, d’après les agents de l’ANAPEC. Une autre, divorcée mais sans enfant, a été refusée aussi. Cette année les agents administratifs du caïdat et des municipalités sont allés chercher des femmes dans les zones de montagne, car, d’après eux, les filles de la ville n’arrivent pas à travailler.
Il y a eu une réunion de préparation à Mohammedia. Les recruteurs ne prenaient pas les grosses, car elles ne pouvaient pas travailler. Moi, le recruteur ne m’a pas regardée les mains, mais certaines de mes amies m’ont dit qu’ils vérifiaient les mains. Il y en a même qui disent qu’il faut être moche pour travailler. Surtout ne pas arriver et se présenter bien habillée ou maquillée. Il faut être comme on est d’habitude. Moi j’y suis allée avec ma djellaba. On était 6 000 femmes à aller à Mohammedia. On faisait la queue, tout le monde se poussait. On montrait à la télévision comment on était, comment on travaillait et comment ramasser la fraise en Espagne. C’était un spectacle assez surprenant et impressionnant. Ils faisaient l’appel à haute voix en prononçant nos prénoms et noms. Si on avait la feuille, la verte, ça voulait dire qu’on avait gagné. On a beaucoup rigolé. Car quand on y pense, on s’est battues pour aller travailler dans la misère. C’est la misère qui nous fait partir.
Ensuite, les agents de l’ANAPEC nous ont donné rendez-vous le 3 décembre à Tanger. On était très nombreuses ce jour-là, des milliers de femmes. Le 4 décembre, je suis partie pour l’Espagne. C’était la première fois que je prenais le bateau, j’avais très peur. Les agents de l’ANAPEC nous avaient pris nospasseports. Quand on est arrivés à Tarifa, plusieurs médiateurs nous attendaient. Ils avaient des haut-parleurs et faisaient l’appel. Ils nous ont pris une fois de plus nos passeports. Il y avait cinq cars en tout qui nous attendaient. On était une soixantaine dans le car. À Séville, on s’est arrêtés pour manger. C’était très bien organisé.
Puis on est arrivées à Moguer. Il y avait des filles d’Azilal dans les autres cars. Elles m’ont fait signe de la main et je suis restée avec elles. On est montées dans un autre bus avec un Espagnol qui a emmené une cinquantaine de femmes. On a roulé près d’une demi-heure depuis Moguer pour arriver au milieu des serres. Le patron espagnol nous a donné une maison pour une dizaine de filles, on était quatre par chambre. Il nous a donné trois cadenas neufs pour pouvoir fermer les chambres à clé. Il ne nous parlait qu’avec des gestes. Il nous a dit de faire attention aux voisins, que c’était des « coca-cola ». Des Maliens. Il a fait un signe avec sa main, a touché son ventre pour dire « attention à ne pas vous faire engrosser », sous-entendu par les Maliens. Ensuite il nous a donné une bouteille de gaz et nous a fait visiter la maison. Il a branché le réfrigérateur, nous a montré le fonctionnement de la machine à laver. Dans cette coopérative on était une soixantaine en tout à travailler. 19 Marocaines, des Maliens, des Roumaines, des Polonaises. Il y avait un Marocain avec le patron qui traduisait ce qu’il nous disait. Le Marocain nous a donné des conseils : il fallait nous entendre avec les autres communautés, les Polonaises et les Maliens étaient très bien, mais il fallait se méfier des Roumaines, elles étaient comme les Marocaines, sous entendu mauvaises.
Quand on est arrivées, on a réglé nos montres et on est allées faire nos prières…
Au bout de quelques jours seulement, il y a eu quatre « fugueuses ». L’une est partie à Bordeaux, en France, et les trois autres sont restées en Espagne. Le patron est venu nous interroger, mais nous, on n’avait rien à lui dire. Il a commencé à nous traiter de menteuses. Il n’y avait que les Marocaines qui s’enfuyaient, les autres nationalités étaient sérieuses, disait-il…
À Moguer, j’ai retrouvé plein de filles de tout le Maroc, mêmes des filles avec qui j’avais travaillé à Agadir…
Au début on n’était pas équipées. Les Polonaises avaient des bottes. Pas nous. Elles se sont moquées de nous, les premiers jours. Elles nous attendaient au tournant. Donc nous, les Marocaines, on a travaillé, travaillé et travaillé dur pour leur montrer qu’on était capables. On n’a pas rechigné à la tâche. On avait compris comment ça se passait. Les fraises les plus mûres, on les mettait de côté pour les jus et les confitures.
Au début on mettait des gants, mais les Espagnols nous ont demandé de les enlever car ça écrasait la fraise. On les a enlevés, mais la cueillette de la fraise, ça abîme les mains. C’est pas grave, on était venues pour ça. Par contre, les Polonaises se sont révoltées, elles n’étaient pas d’accord, elles voulaient garder leurs gants. Nous, on n’a rien dit, on n’a pas osé. On portait aussi le voile, des pantalons, des cols roulés, des casquettes, car on ne voulait pas revenir au Maroc toute noires. Par contre, dans la serre, il fait très chaud. Parfois, des filles faisaient des malaises. Il paraît que dans certaines coopératives, on leur a interdit le voile à cause de ça. Mais nous, on ne nous a rien dit, juste de ne pas mettre trop de vêtements.
Au bout de trois mois de travail, on n’en pouvait plus, mais on avait pris l’habitude. Les dix derniers jours, on ne faisait plus le tri, on mettait tout dans les mêmes chariots. Les fraises étaient trop mûres. Après, il a fallu nettoyer la coopérative. À la fin, ils ont baissé nos salaires, ils nous payaient au kilo et non à l’heure. Avant qu’on reparte, le patron, José, qui était content de notre travail, nous a dit qu’il nous rappellerait l’année suivante.
De 2008 et 2010, j’ai donc travaillé à Moguer, chez José. Mais en 2011, il nous a refait des contrats temporaires pour travailler chez lui, mais à notre arrivée, il n’a pas voulu nous reprendre. Un mois avant, il y avait eu des bagarres à répétition et un vol commis par une Marocaine. Il était exaspéré et en avait marre des Marocaines. Il n’est pas venu nous chercher. Ce qui fait qu’avec deux amies d’Azilal, on est restées les dernières dans le car à attendre que nos noms soient appelés. Il était tard et on avait peur que personne ne vienne nous chercher, peur d’être renvoyées, de ne pas travailler cette année, de devoir rentrer au Maroc sans un sou, peur de la honte. Les médiateurs nous ont rassurées. Ils ont dû appeler plusieurs employeurs qui n’étaient pas au courant pour leur dire qu’il y avait trois Marocaines et leur demander s’ils voulaient nous prendre. C’est comme ça qu’on a atterri à El Rocio. Le contremaître d’El Rocio voulait que je sorte avec lui mais je ne voulais pas.
En 2013, le chef, qui était associé à un Allemand, nous a clairement dit qu’il était content de notre travail mais qu’il ne pourrait pas nous faire revenir l’année suivante car il ne pouvait plus nous payer le seguro (l’assurance). Il avait des problèmes financiers. C’est là que j’ai décidé de rester. Avant de venir, je savais que j’allais rester. J’avais pris ma décision. Depuis 2008, je venais tous les ans. Pendant longtemps, mon objectif principal était de rentrer au Maroc et repartir l’année suivante. J’étais très critique de celles qui se sauvaient. Je trouvais que c’étaient des filles de mauvaise vie, des trompeuses de maris, des femmes qui fument, qui boivent, qui sortent avec des hommes… Il y avait la pression de la famille, qui me disait tantôt de rester, tantôt de rentrer. Ça a été une décision très dure à prendre. Mais j’en avais assez d’aller et revenir. Assez de la route, d’aller jusqu’à Tanger, faire la traversée, ne pas savoir où tu vas atterrir quand tu arrives. Assez aussi de dépenser tout ce que je gagnais. Cela ne me suffisait plus. En plus, avant de partir, il faut au moins 300 euros. Je ne trouvais jamais personne pour m’avancer cette somme. J’en avais assez et j’avais peur de ne plus pouvoir revenir. Plusieurs de mes amies étaient restées et avaient eu leurs papiers. J’ai cédé à la tentation de faire comme elles.
La galère d’une « sans-papière »
Là, j’ai connu la clandestinité et la hogra. J’ai subi le mépris, les humiliations, l’injustice, les bas salaires et l’exploitation de la part d’Espagnols et de certains Marocains qui me savaient dans le besoin. Mais il me fallait des papiers à tout prix. Je suis restée à El Rocio où j’habite en colocation avec deux Marocains. C’est grâce à mon contrat de travail que j’ai pu régulariser ma situation. J’ai remplacé un été une fille d’Oulad Moussa, près de Béni Mellal, dans une famille et ils m’ont gardée. Ce contrat, je ne l’ai pas acheté mais c’est tout comme. Je suis si mal payée que c’est comme si mon employeur me facturait chaque mois le contrat qu’il m’a établi. Il y en a qui vendent des contrats jusqu’à 5 000 euros. Moi, mon employeur me paye 500 euros par mois. Je travaille tous les jours, excepté le vendredi. Je commence à 8 heures et termine tous les jours à 20 heures. Je ne m’arrête jamais, c’est très fatigant. Et dès que je m’assois pour me reposer, on me trouve une tâche à faire. La maison est grande. Il y a le couple de vieux, leurs deux filles et leurs maris, et leurs petits enfants. Le week-end, tout le monde est là, et il faut en plus des tâches quotidiennes s’occuper des petits enfants. Nous sommes quatre à travailler chez eux. La fille grâce à qui je travaille ici, que le patron paye 800 euros alors que ça fait dix ans qu’elle travaille pour eux, s’occupe de la vieille dame et prépare les repas. Elle est logée chez eux. Il y a une Espagnole qui s’occupe du vieux et fait aussi à manger. Elle est payée 600 euros. Une autre Espagnole qui vient de temps en temps de manière ponctuelle, pour le repassage et d’autres tâches de ménage. Et moi, qui m’occupe du ménage, sol, linge, rangement, poussière, etc. J’aide les autres pour les repas ou quand elles ont trop de travail. Il nous arrive de nous entraider.
Mais, lghorba, c’est très dur. Cheb Khaled dit « lghorba, shiba ou rdara, l’exil est dur et traître ». Quand je chante cette chanson, j’ai la voix pleine de larmes. Mais j’ai résisté. En septembre 2017, j’ai enfin obtenu mes papiers, une carte de résident d’une année, et suis rentrée un mois au Maroc, pour la première fois depuis quatre ans. J’ai enfin pu revoir mon père malade, ma mère qui a tant vieilli, mes frères et sœurs, et mon fils. En mon absence, il est devenu un homme… »
Chadia Arab
[1] Le mawkef est l’endroit où se retrouvent les hommes et les femmes qui cherchent du travail, souvent en tant que journaliers. Ils se font repérer par les employeurs. Les femmes sont recrutées pour différentes tâches ménagères en ville, et agricoles dans les zones rurales.
[2] L’ANAPEC gère le recrutement sur place au Maroc des saisonnières qui iront par la suite travailler en Espagne.
Dames de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne, Chadia Arab, 2018, 2e éd. augmentée 2023
Découvrez le sommaire ici.