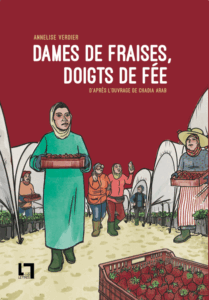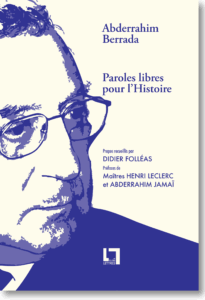Caroline Vabret: Pour une éthique de la francophonie
Après une licence en philosophie et un diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris, Caroline Vabret a fait carrière dans la diplomatie française. Elle a été chargée de mission culturelle à l’Institut français de Casablanca puis à Rio de Janeiro.
Dans le cadre de son master 2 en Études culturelles, elle a travaillé sur la francophonie.
Sa lecture de Maroc : la guerre des langues ?
Le bilinguisme au Maroc
Quiconque s’intéresse à la place de la langue française au Maroc relève d’emblée un paradoxe : même si les études varient sur le sujet, on estime qu’elle est la deuxième langue la plus utilisée, après l’arabe, et avant l’amazighe (berbère) – pourtant désignées comme les deux langues officielles du royaume selon la Constitution de 2011. Selon l’Organisation internationale de la francophonie[1], alors que moins d’un Marocain sur trois parle le berbère, plus d’un tiers de la population marocaine serait francophone. Ramenés à la population alphabétisée, ce sont même 2/3 des Marocains qui maîtriseraient la langue française. Le recensement mené en 2014 par le gouvernement marocain chiffre quant à lui la proportion de francophones à près de 50 %[2].Le français, enseigné dès le primaire en tant que seconde langue (non obligatoire), est par ailleurs la langue d’enseignement exclusif des études supérieures dans les domaines scientifiques et techniques, et reste largement utilisé par les médias et dans l’administration, ainsi que sur les réseaux sociaux.
En bref, pour des raisons historiques liées à la période du protectorat français entre 1912 et 1956, et malgré les velléités d’arabisation post-indépendance (néanmoins tardives puisque datant des années 1980), le Maroc a hérité d’une situation linguistique où le français conserve aujourd’hui une place essentielle (indépendamment de la présence de nombreuses langues vernaculaires, en plus de l’arabe littéraire), au point que l’on parle aujourd’hui de bilinguisme, en général et dans de multiples domaines spécifiques. Ce bilinguisme arabo-français illustre donc une dimension nationale spécifique de la francophonie, dans le cadre d’un pays anciennement colonisé par la France, qui a souhaité un temps s’affranchir de ce « butin de guerre[3] », mais où le français est resté très présent et structurant, notamment dans le domaines des sciences, des arts et des lettres, et non sans conséquences politiques et sociales.
Ce dossier s’intéressera donc à la question du bilinguisme français-arabe au Maroc principalement sous l’angle académique et littéraire, en abordant également sa dimension sociale et historique, et son enjeu en terme de diplomatie éducative et culturelle pour la France. Il évoquera également, mais sans l’approfondir, la question du bilinguisme arabe littéraire-arabe dialectal, essentielle et ayant partie liée au bilinguisme arabo-français – mais qui devrait faire l’objet d’une étude à part entière.
Nous envisagerons dans un premier temps la genèse de la situation de la francophonie au Maroc, en adoptant une approche politico-historique, pour en souligner les prolongements sociaux et postcoloniaux se retrouvant aujourd’hui dans différents domaines. Nous nous intéresserons ensuite aux différentes possibilités s’offrant aux acteurs concernés, au Maroc comme en France, pour assumer ce bilinguisme de fait et réhabiliter la francophonie marocaine en en faisant notamment une richesse et un tremplin vers un multilinguisme « heureux ».
Le constat : le bilinguisme français/arabe au Maroc est largement associé à une diglossie, à forte dimension postcoloniale
Le poids de l’héritage colonial sur le statut des langues au Maroc
Le protectorat, en imposant le français comme langue d’élite, a instauré un rapport ambivalent entre les Marocains et la langue française, perdurant à l’ère postcoloniale
À l’image des autres pays africains colonisés par la France, le Maroc hérite à l’indépendance d’un déséquilibre linguistique venant opposer la langue française, « haute », imposée comme celle de l’administration et des élites coloniales, aux langues locales, en l’occurrence berbère, arabe dialectal et arabe littéraire (cette dernière ayant toutefois un statut spécifique : écartée pendant les années françaises mais désormais amenée à revenir à une autre forme d’élite). On pourra parler dès lors pour caractériser la situation dans le pays, non seulement de bilinguisme mais aussi de « diglossie », selon le concept formulé par les linguistes William Marçais en 1930[4], puis Charles Ferguson en 1959[5], désignant l’état dans lequel se trouvent deux variétés linguistiques coexistant sur un territoire donné et ayant, pour des motifs historiques et politiques, des statuts et des fonctions sociales distinctes, l’une étant représentée comme supérieure et l’autre inférieure. Depuis le protectorat et jusqu’à la politique d’arabisation, le système scolaire marocain est ainsi caractérisé par la coexistence de la « mission » (enseignement français réservé à une élite), de l’école dite « nationaliste » marocaine (bilingue français-arabe) et de l’école coranique (enseignement traditionnel associé à la pensée religieuse, entièrement dispensé en arabe). Ces trois filières auront structuré durablement le champ socio-professionnel en fonction de leur ouverture sur les filières de prestige et la modernité.
Le poète marocain Jalal El Hakmaoui, contributeur à l’ouvrage collectif Maroc : la guerre des langues ? dirigé par Kenza Sefrioui et publié récemment[6], estime ainsi que l’infériorisation systématique des non francophones au Maroc traduit aujourd’hui encore « l’hégémonie d’une élite économique et politique arrogante usant de la langue française comme un outil capitaliste de classe, au nom de la modernité, pour dominer le reste analphabète et arabophone de la société ». Ainsi, si certains pans de la société marocaine, notamment la classe moyenne éduquée, se le sont appropriés comme vecteur d’instruction et d’émancipation, le français reste surtout aujourd’hui au Maroc une langue très clivée socialement.
Il semble par ailleurs encore difficile d’en assumer un usage national « propre », indépendant du modèle imposé par la France. Dans la classe intellectuelle, à l’indépendance, arabe et français s’opposent comme étant respectivement la langue légitime du peuple marocain et celle imposée par le colon, et l’idée qu’il faut se dégager de la francophonie, arme culturelle de la colonisation, commence à essaimer. Les écrivains marocains « francophones »doivent alors justifier leur choix d’une écriture en français. La revue avant-gardiste Souffles, créée en 1966 et passée du français à l’arabe en cours de route, illustre bien cette position complexe, toujours d’actualité : à ses débuts, l’expression en langue française semble une évidence, car au vue de leur génération et leur classe sociale, la maîtrise de l’arabe des participants à la revue n’est pas suffisante pour s’exprimer le plus fidèlement possible à leurs émotions. Si le français constitue alors un « legs problématique[7]», selon les mots du fondateur de Souffles, Abdellatif Laâbi, celui-ci appelle à renouveler le regard qui y est porté depuis le protectorat en assumant de se le réapproprier ; à le reconsidérer, plutôt que de le nier. Cette vision optimiste exprimée par Laâbi, qui sera remise en cause au sein même de la rédaction de Souffles, est loin d’être partagée, que ce soit dans le cas du Maroc ou au-delà. On peut invoquer à cet égard l’auteur franco-tunisien Albert Memmi, pour qui le bilinguisme colonial ne serait pas une simple « diglossie » mais un véritable « drame linguistique[8]».
Le rôle de l’écrivain de langue française serait donc nécessairement intenable, car il incarnerait « toutes les ambiguïtés, toutes les impossibilités du colonisé». En effet, écrire en arabe ne toucherait pas le peuple – illettré, ni l’élite – ne lisant que le français ; écrire en français constituerait une autre impasse car ce choix « dénaturerait» la pensée arabe et produirait une « infirmité linguistique» responsable d’une « œuvre de mauvaise foi »… Pour l’écrivain marocain Abdallah Laroui[9], cette diglossie, au-delà de l’impasse linguistique à laquelle elle mène en littérature, est aussi responsable du maintien d’un traditionalisme mortifère dans la société car, ayant instauré une association entre français et modernité, elle condamnerait les Marocains à une forme de mimétisme pour l’atteindre, comme si le progrès, uniquement accessible par une langue étrangère, ne pouvait être assimilé.
La littérature marocaine de langue française présente dès lors, aujourd’hui encore, un statut complexe
Dans son essai intitulé Je parle toutes les langues, mais en arabe[10], l’écrivain marocain Abdelfattah Kilito interroge, du point de vue interne au Maroc, les enjeux du bilinguisme pour la littérature marocaine actuelle, à la fois arabophone et francophone (l’arabe étant envisagé ici comme langue d’écriture, donc sous sa forme littérale). Selon lui, aujourd’hui, le « choix » d’écrire en français ou en arabe induit toujours un positionnement plus ou moins confortable pour les auteurs marocains. Le choix du français comme langue d’écriture peut ainsi obéir à une stratégie éditoriale très claire, parfois établie en fonction du registre littéraire : ainsi, dans l’exemple pris par Kilito, l’écrivain Abdallah Laroui se dirait « lucide » sur le retentissement – dans le monde arabe et au-delà – de son Idéologie arabe contemporaine, du fait qu’il a choisi de l’écrire directement en français : c’est ce succès qui lui aurait permis d’être traduit en arabe et si l’ouvrage avait été écrit directement en arabe, il aurait suscité moins d’intérêt et n’aurait pas été traduit vers le français. Ce prestige du français se doit néanmoins d’être nuancé, selon Kilito, qui souligne que la valorisation traditionnelle des écrits en langue française ne semble pas systématique selon le point de vue social ou politique adopté. Ainsi le statut des écrivains francophones marocains n’est-il pas si « confortable » : mêmes s’ils bénéficient d’une reconnaissance particulière, y compris en interne, ils peuvent paradoxalement se trouver sommés de justifier un choix réputé « colonial » ou « élitiste » auprès de certaines franges de leur public national (CF l’exemple de Souffles supra) – tout en pâtissant par ailleurs d’une certaine marginalisation sur la scène littéraire française.
Le malaise à se revendiquer comme écrivain « francophone » à l’international fait ainsi écho au malaise de certains écrivains marocains francophones y compris chez eux. Le parcours de l’écrivain Abdellah Taïa, né au Maroc et publié en France, illustre bien ce rapport extrêmement complexe entretenu à la fois vis-à-vis de son pays d’origine et vis-à-vis du « centre » parisien, de la langue française et de la France en général. Issu d’un milieu populaire et arabophone, Taïa est le premier auteur marocain à avoir assumé publiquement son homosexualité et en avoir fait un sujet d’écriture, dans Une mélancolie arabe[11], où il livre les étapes d’un parcours identitaire sous forme de va-et-vient entre Maroc, France et monde arabe, dans lequel il assume « devoir » à la France, à sa maison d’éditions (le Seuil) et à la langue française son statut d’écrivain « libre ». Malgré cela, il dénonce aussi la position dans laquelle l’ancienne puissance coloniale l’a confiné, à travers l’usage de sa langue et de son système – en tant que représentant d’un exotisme orientaliste satisfaisant les attentes du public, mais aussi en tant que simple immigré arabe méprisé. Depuis cette oeuvre fondatrice, son ambivalence s’est révélée de manière plus radicale encore, à travers ses interventions publiques comme de ses écrits, à l’image de sa récente contribution à l’ouvrage collectif Maroc : la Guerre des langues ?[12], dont le titre permet à lui seul de caractériser la violence :« Aimer et tuer : pourquoi j’écris en français ? » Le français y est décrit comme une arme, qu’il aurait d’abord dirigée contre sa langue maternelle et son milieu social, et qu’il retournerait aujourd’hui vers la France.
En tout état de cause, si la littérature marocaine post-indépendance recense aujourd’hui autant de publications en français qu’en arabe, Abdelfattah Kilito dénonce la grande étanchéité persistant entre ces deux littératures – regrettant qu’on ne puisse pas parler « d’une » littérature marocaine. Pour lui, deux mondes différents coexistent, avec leurs systèmes de valeurs respectifs ; cette dualité reflèterait au-delà de la littérature certaines des lignes de fracture de la société marocaine.
Au-delà même du fait colonial, la diglossie comme reflet de l’asymétrie historique des structures socio-linguistiques marocaines, renforcée par la fragilité des politiques éducatives
Le français, langue impériale… parmi d’autres
Omar Saghi, autre contributeur à Maroc : la guerre des langues[13](« Parler deux langues pour taire l’inégalité »), replace la question du français dans l’histoire plus large du fait linguistique au Maroc : pour lui, une langue minoritaire, l’arabe, était déjà venue asseoir sa domination culturelle autour d’une langue autochtone majoritaire, le berbère, avant même le protectorat et sa colonisation « glossophage »[14]. La tradition d’un bilinguisme asymétrique tendant à la diglossie avait donc déjà été instaurée autour d’une langue de « dominants » les distinguant des dominés. Le « français de l’arabe » serait ainsi comparable à « l’arabe du berbère », simple « dernière venue des langues impériales assimilées par les Maghrébins et converties, à leur usage, en instrument sociopolitique de distinction ».
Le bilinguisme hérité de la période coloniale se serait alors imposé assez naturellement dans une société marocaine « voulant » l’asymétrie culturelle. Dès lors, loin de se référer à l’usage de deux langues également parlées par tous, il se serait caractérisé d’emblée par la distribution de deux langues entre deux blocs monolingues, l’élite et son envers : « La langue est politique. Et au Maroc sans doute plus qu’ailleurs. Bilinguisme, diglossie, fracture linguistique, les appréciations, qui vont de la description à la qualification polémique, ne cessent de revenir sur cette ligne[…] qui semble couper la société en deux, dans ce qu’elle a de plus intime, la parole […] la situation linguistique marocaine reflète un état sociopolitique, un choix inconscient, ou du moins implicite, de la différence linguistique pour masquer, légitimer et adoucir la différence sociale. La langue au Maroc est une idéologie : elle masque et révèle à la fois la réalité de la structure sociopolitique. Ce n’est pas tant d’ailleurs de bilinguisme qu’il faudrait parler que d’apartheid linguistique, construit par un ensemble d’institutions et d’usages, pour se superposer au mieux à la réalité sociale du pays. »
Par extension, on peut déduire que ce bilinguisme français/arabe, imposé par le haut, par substitution et exclusion et non par complémentarité, a lui-même dessiné l’échelle de valeur pour une autre distinction, celle entre l’arabe littéral et la darija (le dialecte marocain), qui fait aussi l’objet d’intenses débats au Maroc. Abdelfattah Kilito conclut son essai[15]dans ce sens lui aussi : le rapport des marocains à l’arabe littéraire, sur un autre registre historique (n’ayant pas à voir avec la post-colonialité), n’est finalement pas si éloigné de leur rapport au français – puisqu’il ne s’agit pas non plus de leur langue maternelle, utilisée au quotidien, et qu’il comporte lui aussi une certaine dose d’étrangeté, une distance et une forme de valeur véhiculée par l’extérieur (souvent en référence aux « modèles » du Machrek ou du Moyen-Orient).
Quoi qu’il en soit, il est clair que la stigmatisation des non-francophones, ou à l’inverse des non-arabophones, va au-delà des niveaux linguistique et littéraire et prend les traits d’une véritable discrimination « glottophobe », i.e. un rejet de l’altérité passant par le langage ; la réprobation de l’usage de certaines langues servant à marginaliser des catégories sociales ou même des pans entiers de la population marocaine.
La précarité du système résultant de l’arabisation inachevée post-indépendance
Le « drame linguistique marocain », comme le caractérise l’écrivain Fouad Laroui[16], reprenant les termes d’Albert Memmi, est donc en bonne part le résultat de la période coloniale, mais son enjeu s’est trouvé renforcé par la structure historique de la société marocaine. La problématique actuelle autour de la langue française y est par ailleurs plus aiguë que dans d’autres pays anciennement colonisés, du fait d’une politique publique inachevée en matière d’arabisation, venue entretenir la fracture linguistique héritée de l’histoire. En effet, au Maroc, la ré-affirmation de l’arabe comme langue officielle après l’indépendance n’a pas été assortie d’une volonté politique culturelle et éducative visant à revaloriser cette langue arabe, que ce soit dans son usage quotidien, académique ou littéraire. À la suite du protectorat, et à l’inverse du voisin algérien, le royaume chérifien n’a pas mené de politique d’arabisation centralisatrice et systématique ; la ré-introduction de l’arabe dans l’enseignement n’a été que tardive et partielle, contribuant à maintenir le français dans sa position de langue d’élite, son enseignement continuant de ce fait à être en bonne part « sous-traité » à l’ancienne puissance colonisatrice. On parle alors parfois de « nilinguisme » pour caractériser toute une génération n’ayant pu à cette époque bénéficier d’une formation linguistique efficace dans aucune des deux langues.
Les différentes langues en présence au Maroc ont donc continué à coexister, selon les modalités socialement clivantes exposées plus haut, la distinction entre francophones et arabophones demeurant la plus prégnante, résultat de l’ambigüité des choix politiques se traduisant sur tous les plans. Comme l’observe l’universitaire Hubert Tullon dans un article publié en 2009 [17] : « La question des langues, qui a été au cœur des revendications nationalistes, se mue, après les Indépendances, en enjeu de politique intérieure dans les négociations que les élites qui ont accédé au pouvoir mènent avec leur population : tantôt l’arabisation décrétée d’en haut permet de diminuer la pression résultant de frustrations accumulées par la société, tantôt le retour, tout aussi discrétionnaire, vers plus de français ressemble fort à une tentative en vue d’échapper à un identitarisme désormais perçu comme menaçant dans ses exigences. »
La situation actuelle est directement issue de cette oscillation : « Cinquante ans après les Indépendances, les États tunisien et marocain sont dotés de systèmes éducatifs et de formation fondamentalement duaux, clivés en fonction de la langue d’enseignement. Ainsi, dans les deux pays, le cœur battant de l’enseignement supérieur, à savoir les formations d’ingénieur, les études commerciales et celles des professions de santé, qui ont constamment échappé aux tentatives d’arabisation[…], offre des débouchés valorisants à ses lauréats, particulièrement dans l’économie moderne ; inversement, les formations supérieures arabisées (essentiellement les sciences humaines et sociales, mais aussi les études juridiques pour une partie) semblent […] alimenter le chômage des diplômésmaintenant que le secteur public a, ou peu s’en faut, tari ses recrutements. » Le constat ainsi dressé est alarmant :« On est raisonnablement en droit de douter que le système actuel puisse perdurer longtemps sans conflits : l’asymétrie entre les deux langues réduit peu ou prou le bilinguisme à un privilège de classe, prélude à la manifestation de toutes sortes de rancœurs. »
L’insécurité linguistique dans laquelle se trouve une bonne part de la population marocaine vis-à-vis du français (mais aussi vis-à-vis de l’arabe littéraire), engendre donc une dualité éducative, académique, littéraire, professionnelle… socialement et politiquement délétère. Face à ce constat, on peut se demander quelles sont les voies qui permettraient d’apaiser cette « guerre des langues » et d’en sortir par le haut.
Quelle place donner à la francophonie au Maroc aujourd’hui pour faire du bilinguisme une force et non une ligne de fracture ?
Une politique culturelle marocaine visant un « multilinguisme heureux »
Face à l’impasse actuelle, de nombreuses voix se sont élevées au Maroc pour tenter de revenir sur les velléités d’arabisation et ménager une nouvelle place à la langue française, afin de faire du bilinguisme de fait un atout et non plus un facteur excluant. Le dramaturge et comédien Nabyl Lahlou, dans sa contribution à la Guerre des langues[18], estime ainsi que l’arabe comme le français devraient être des « langues de liberté ». Lui-même, qui a fait le choix d’écrire en arabe ou en français selon les contextes dans lesquels il a produit ses textes, se pose comme le fervent défenseur à la fois d’une « réintégration » de la langue française dans le paysage institutionnel marocain (il va jusqu’à appeler à en faire une langue officielle dans la constitution, aux côtés de l’arabe et du berbère), justement pour achever de la débarrasser de sa connotation coloniale, et aussi d’une re-valorisation de la langue arabe pour qu’elle puisse, elle aussi, représenter un outil d’émancipation et de souveraineté pour le Maroc.
(Ré)-assumer la place du français dans l’éducation
Sur le plan des politiques publiques, une loi-cadre sur l’enseignement votée le 20 août 2018 est venue rappeler les grands principes de la réforme de l’éducation nationale marocaine en cours depuis 2013, désignant les langues comme « vecteur d’universalisme et d’intégration ». Selon ce nouveau texte-référence, la langue d’enseignement principale reste l’arabe, et si l’école doit assurer la maîtrise des deux langues officielles du Maroc, l’arabe et l’amazighe, il est stipulé explicitement qu’elle doit favoriser la maîtrise de deux langues étrangères, en particulier dans les disciplines scientifiques et techniques, dans l’objectif de faciliter l’intégration des élèves à un enseignement supérieur et un marché de l’emploi encore largement dominés par le français, surtout dans ses filières les plus valorisées. Le Ministère de l’Éducation nationale, dans un communiqué ayant suivi le vote de la loi, indique ainsi que celle-ci « institutionnalise, sans ambiguïté aucune, l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères ». La réforme dont il est ici question vise en effet à réintroduire le multilinguisme dans l’enseignement, en permettant aux élèves du secondaire de recevoir un enseignement scientifique dans une « grande langue de communication internationale», afin de leur offrir un plus large accès aux formations post-bac. Dans les faits, 98% de ces filières du secondaire dites « internationales » sont francophones, et 70% des lycées (public et privé confondu) offrent aujourd’hui une telle section en langue française (contre 6 en 2013). Seules neuf sections en anglais et une en espagnol complètent ce panorama bilingue, qui devrait encore être nuancé par l’ouverture prochaine d’une section en allemand. Le dispositif s’est également ouvert récemment au collège, où il touche déjà un quart des établissements.
La rapidité de la mise en place de ces sections et leur niveau satisfaisant (94% de réussite au baccalauréat marocain, contre 50% pour les filières classiques) a entraîné d’emblée une large adhésion de la société marocaine à cette nouvelle donne, malgré l’expression d’une résistance « d’affichage » de la part de certaines franges conservatrices, promptes à dénoncer la mainmise de la France sur les chantiers en cours. Néanmoins, ces critiques, restées très ponctuelles, ont surtout constitué une instrumentalisation de la question scolaire par certains élus islamistes et sont restées sans écho, alors que la réforme, par ailleurs appuyée par le Roi, continue à faire l’unanimité chez les élèves et parents d’élèves. Face à ce succès, voire cette « pression » populaire, l’objectif affiché des autorités éducatives marocaines consiste désormais à scolariser en 2021-2022, 1/3 des élèves dans les sections internationales, avec la perspective de généraliser peu à peu le système (ce qui est déjà le cas dans l’académie de Rabat) et l’étendre également aux filières littéraires, afin de permettre leur « dé-marginalisation ».
Si sur le plan quantitatif, l’intérêt des établissements et de leurs usagers ne se dément pas, la réforme se réalise néanmoins dans un contexte humain très contraint, l’offre d’enseignements peinant encore à s’adapter à ces choix volontaristes. Les besoins liés à cette réforme concernent donc essentiellement la formation en langue française des enseignants de disciplines non linguistiques, notamment en raison du changement générationnel en voie de s’opérer, avec le départ à la retraite de ceux ayant commencé leur carrière avant l’arabisation des années 1980. La formation de ces enseignants a ainsi été définie comme une priorité de la coopération éducative et linguistique avec la France[19].
Valoriser le français du Maroc, via la création littéraire marocaine en français
Si la réforme en cours depuis 2013 semble à la fois aller dans le bon sens et rencontrer un écho favorable dans la population marocaine, elle semble néanmoins se limiter à l’aspect « technique » de l’éducation plurilingue, tout en l’associant encore systématiquement à une référence étrangère, voire une projection vers de possibles études à l’international. Ce qui se comprend aisément pour l’anglais ou l’allemand est cependant moins évident en ce qui concerne le français, qui, au vu de la situation passée et présente du Maroc, gagnerait à être explicitement considéré et valorisé comme une langue nationale, et non plus présenté comme une langue « étrangère ».
Or à ce stade, la réflexion sur l’évolution de l’éducation marocaine n’aborde pas cette question de l’appropriation ou la ré-appropriation de la langue française par les marocains, et les contenus des enseignements restent intouchés. A titre d’exemple, sur six œuvres au programme de l’épreuve de français du baccalauréat marocain l’année dernière, cinq relevaient des « classiques » français et une seule du patrimoine littéraire marocain francophone. Or la réhabilitation du français marocain y compris dans ses représentations, et pas seulement dans son « niveau » pratique, jaugé à l’aune de la référence franco-française, pourrait également contribuer à son usage pacifié. Celle-ci pourrait passer par une revalorisation de la littérature marocaine dite « francophone », en cherchant à dépasser le double « malaise » y étant encore associé (cf. supra).
Il s’agirait, d’une part vis-à-vis de l’extérieur, d’être considérée comme partie intégrante d’une grande « littérature mondiale en français » au même titre que les autres littératures non françaises de langue française ; et d’autre part, en interne, de réserver une place prioritaire à cette littérature nationale de langue française dans les cadre des cursus en français, au détriment des classiques français toujours dominants. Comme le suggère Hubert Tullon[20],« ne serait- il pas plus stimulant pour des élèves abordant la littérature de le faire viades œuvres susceptibles de parler immédiatement à leur sensibilité parce qu’ancrées dans un univers, imaginaire ou réel, un tant soit peu familier ? Où la littérature maghrébine d’expression française, plus largement francophone,[…] devrait trouver toute sa place avant qu’on ne passe au Horla, à La Chartreuse de Parme ou au Bourgeois gentilhomme… »
Généraliser les pratiques de traduction
Face à « l’apartheid linguistique » dénoncés par de nombreux Marocains, les politiques publiques sont aussi mises en cause à de nombreux niveaux, au-delà de la place et des modalités de l’enseignement du français. Le poète Jalal El Hakmaoui, autre contributeur à la Guerre des langues[21](« Après l’Empire, traduire »), note que le problème ne serait pas tant le statut du français ou de l’arabe, mais l’enseignement en général et celui des langues en particulier, qui aboutirait à « former des subalternes » ; il souligne en outre les conséquences de l’impasse linguistique sur la condition de la création littéraire marocaine, qu’il qualifie de « double périphérie éditoriale », entre France et Machreq. En dehors de la question du système éducatif, une stratégie de sortie serait alors le développement d’une politique de traduction volontariste arabe/français, nécessaire vis-à-vis de l’extérieur mais aussi dans un souci interne au Maroc, pour y favoriser le contact entre les différents groupes de locuteurs.
El Hakmaoui déplore ainsi le faible intérêt pour la littérature maghrébine en arabe et sa traduction vers le français, y compris en France, où les choix de traduction priorisent en général le Machreq : « La réception française des littératures arabes est prisonnière d’un imaginaire orientaliste et colonial, dans lequel la littérature du Maghreb serait exclusivement francophone ». Il appelle donc les responsables politiques et éditoriaux marocains (mais aussi français) à favoriser une politique active de traduction qui contribuerait à « décoloniser les esprits » dans les deux sens, réhabiliter la mémoire culturelle du continent africain et rapprocher les groupes sociaux entre eux.
D’autres voix font écho à cet appel : Abdelmajid Jahfa, professeur de linguistique à l’université Hassan II de Casablanca[22], milite lui aussi en faveur d’une systématisation des traductions pour dépasser l’écueil du bilinguisme arabe/français (selon lui beaucoup plus problématique que la disglossie entre arabe dialectal et littéraire), estimant que cette traduction constitue un véritable instrument d’émancipation et d’appropriation, permettant de formuler le monde par sa propre conception, au risque de rester « traversé » par celles des autres et condamné à un mimétisme permanent. Zakia Iraqi Sinaceur, directrice des curricula au ministère de l’Éducation nationale, estime de son côté (« La langue française : langue de l’autre, mais aussi la mienne »[23]) que la francophonie ne sera une chance pour les marocains qu’à la condition d’être « nourrie de traductions basées sur des échanges approfondis entre langue et cultures (…) investissement qui, en amont, pourrait mener vers un bilinguisme équilibré, vers un dialogue interculturel porteur de tolérance ». La revue Souffles, citée supra, constitue un exemple de dépassement du clivage linguistique via la traduction, en tout cas à ses débuts. Récusant toute dichotomie stérile entre écrivains arabophones et francophones, qualifiée de « dualité artificielle », et se voulant une tribune commune pour les nouvelles générations, elle publiera en effet des traductions et des numéros entièrement bilingues dès sa 3ème année d’existence.
Changer de paradigme : envisager le plurilinguisme comme une chance
Au total, c’est un changement de paradigme qui permettrait au bilinguisme marocain de sortir de son statut clivant pour se convertir en force. Revenant sur la situation en Tunisie et au Maroc, Hubert Tullon esquisse une porte de sortie à l’impasse actuelle consistant à assumer « l’héritage » linguistique et en faire un atout : « C’est que ces deux pays disposent avec le français, dont l’histoire les a rendus familiers, d’un marchepied vers le plurilinguisme. Le tout est de sortir cette langue d’un cadre où elle risque d’être perçue comme l’instrument d’une ségrégation sociale, en montrant au contraire qu’elle peut être le médium partagé d’un accès à certaines configurations de la modernité : si le bilinguisme précoce est la meilleure porte d’accès au plurilinguisme, le français peut jouer au Maghreb un rôle moteur dans l’intégration de ces pays au concert de la mondialisation et constituer un tremplin vers l’accès à de nombreuses autres langues. »
Cette richesse liée au multilinguisme devrait aussi être mise en valeur sur le plan littéraire, au profit des écrivains marocains francophones bilingues ou plurilingues, c’est-à-dire dont la langue maternelle – l’arabe – n’est pas la langue dominante, ou en tout cas de création littéraire, qui se trouve être le français (comme Kilito ou Taïa évoqués plus haut). À l’image des écrivains dits « translingues », tels que Milan Kundera, François Cheng ou Nathalie Sarraute – non français bien qu’écrivant en français, mais considérés comme des écrivains « français » et non « francophones », car n’étant pas issus des anciennes colonies françaises – ils pourraient alors revendiquer ce multilinguisme comme une spécificité, voire un « supplément d’âme » par rapport aux français monolingues. Abdelfattah Kilito, ajoutant à la question de la langue d’écriture celle de la langue de lecture, fait lui-même l’éloge du bilinguisme et de la richesse supplémentaire qu’apporte la maîtrise de plusieurs langues, non seulement dans la création mais aussi dans le plaisir retiré de la lecture[24].Quant à Abdallah Taïa, on pourrait considérer à l’instar du sociologue Jean Zaganiaris[25]que son œuvre, bien qu’elle soit une littérature de languefrançaise, n’est pas pour autant une littérature d’expressionfrançaise, mais bien marocaine : selon Zaganiaris, même si Taïa écrit en français, il « pense » en arabe, ajoutant une complexité à sa démarche ; c’est également ce mécanisme – « penser en arabe, écrire en français » dont se réclame Meriem Alaoui, romancière marocaine auteur du récent La vérité sort de la bouche du cheval[26], sans pour autant considérer que cette forme d’expression « dénature » sa langue d’écriture, mais au contraire qu’elle lui confère une dimension particulière. Le multilinguisme devrait ainsi être assumé comme une dimension constitutive de l’activité créatrice et de la réception des œuvres, et du même coup à l’origine d’une profondeur et d’une finesse supplémentaires, au lieu de renvoyer à un usage « déviant » du français.
Pour une éthique de la francophonie
Quelle responsabilité – et quel intérêt – pour le centre parisien vis-à-vis de la francophonie marocaine aujourd’hui?
Si l’État comme la société marocaine doivent à présent redéfinir leur rapport à la langue française et au multilinguisme en général, est-ce à dire que le « centre » linguistique encore représenté par l’ancienne puissance coloniale ne soit plus concerné par ces « chantiers francophones » en cours ? Si le français peut et doit désormais être vu comme un atout pour les pays anciennement colonisés, le fait que les anciens colonisés se l’approprient aux côtés de leurs propres langues doit aussi être salué par la France. L’écrivain Achille Mbembe[27]l’exprime en ces termes : « Le français sans l’Afrique est une langue ethnique […]. Je pense en langue française. Je contribue avec d’autres au rayonnement mondial de la pensée de langue française, et cela […] a à voir avec le fait qu’à un moment historique donné, la langue française a cessé d’être une langue ethnique. L’Afrique a permis à la langue française d’échapper à son destin ethnique. »
Le français, sans le dialogue avec la culture et la langue arabe, serait ainsi condamné à un monolinguisme suicidaire, sans avenir, les Marocains contribuant, entre autres ex-colonisés, à son rayonnement dans le monde. Il revient donc aussi à la France d’œuvrer à mettre fin aux jugements de valeur négatifs sur la francophonie pour en (re)faire une réalité positive ; mettre fin au sentiment de complexe résultant de l’intériorisation d’une norme linguistique franco-française, produit d’une violence symbolique ; contribuer elle-même, malgré son statut de centre, à relativiser le français de France dans l’espace francophone en reconnaissant sa diversité au-delà du cadre national. Une telle démarche se déclinerait elle aussi à la fois sur les plans culturel, éducatif, académique et littéraire, dans un souci d’intégration des littératures étrangères, y compris par une politique de traduction tournée vers les « autres » langues des anciennes colonies.
Du point de vue de la diplomatie culturelle, comment dépasser ce « paradoxe » de la francophonie ?
Faut-il conclure de ce qui précède que la politique traditionnellement menée par la France en faveur de la langue française dans les pays du Maghreb doive être totalement remise en cause ? Certes, la bannière de la francophonie « diplomatique » reste lourdement chargée d’ambiguïté dans le contexte que l’on sait, et où certaines catégories de la population – y compris issues de la classe politique au pouvoir, interlocutrice des représentations diplomatiques – affichent parfois une volonté officielle de se débarrasser d’un héritage francophone passéiste pour embrasser la « modernité » des autres aires culturelles… mais continuent en privé à envoyer leurs enfants à l’école puis à l’université française.
La volonté actuelle de réinstaurer des enseignements en français à l’école marocaine afin de « ré-égaliser » le système dans son ensemble est néanmoins le signe que le rejet du français a fait long feu, malgré les réserves de principe qui visent ponctuellement la réforme en cours (généralement issues des rangs de cette même élite, issue des franges les plus conservatrices de la société). La diplomatie linguistique de la France est donc toujours d’actualité, dans la mesure où elle permet de répondre à un besoin des pouvoirs publics désormais explicite, et pas seulement confiné aux catégories sociales favorisées et occidentalisées acquises depuis longtemps au système de l’AEFE (Association pour l’enseignement français à l’étranger), historiquement très présent au Maroc.
Loin d’une politique unilatérale et absolue en faveur de la langue française, il est donc d’abord essentiel d’adapter l’action de promotion de la francophonie à la situation spécifique du Maroc, en proposant une offre adaptée à la réforme actuellement menée par le ministère de l’Éducation nationale. Ainsi depuis le début de la réforme, en 2013, les autorités marocaines et françaises affirment la coopération linguistique comme une de leurs priorités, et la France a dans cette perspective développé ou mobilisé plusieurs dispositifs pour répondre à la demande des autorités marocaines, notamment en matière de formation professionnelle des enseignants, visant explicitement à accompagner la « Vision stratégique 2015-2030 » du ministère, dont fait partie intégrante la réforme linguistique de l’enseignement.
Par ailleurs, afin de contribuer au « décentrement » salutaire de la francophonie évoqué plus haut, cette diplomatie francophone gagnerait à doubler, voire remplacer, plus systématiquement la défense du français par celle de la diversité linguistique et culturelle et des valeurs politiques qui peuvent y être associées – démocratie, humanisme, multilatéralisme, horizontalité, soutien aux expressions minoritaires… Concrètement, il s’agirait par exemple de programmer davantage d’actions en s’appuyant sur le cadre multilatéral de l’Organisation internationale de la francophonie et de ses opérateurs (Agence universitaire de la francophonie, Association parlementaire de la francophonie, TV5 Monde…), que d’actions strictement bilatérales, et à agir en général aux côtés d’autres partenaires, afin d’atténuer la charge symbolique pouvant être associée à la valorisation du français « de France » au Maghreb, tout en poursuivant pour autant la promotion d’une langue française venant satisfaire des attentes toujours vives.
C’est d’ailleurs tout le sens et l’esprit voulu par la réforme actuelle de l’éducation, s’appuyant sur des sections dites « internationales » plutôt que françaises, même si d’un point de vue pragmatique, c’est l’enseignement du français qui est réhabilité en priorité. Rien n’empêcherait en revanche de faire participer les autres pays de la francophonie à la coopération mise en place dans le cadre de cette réforme.
Des années après l’époque de Souffles, Abdellatif Laâbi résume cette nouvelle approche dans un texte intitulé « Pour une éthique de la francophonie »[28], où il en expose les objectifs et les méthodes à l’adresse de la France comme des autres acteurs concernés. Il énumère ainsi une série de recommandations, dont pourraient utilement s’inspirer les politiques français comme marocains d’aujourd’hui :
- Sortir de l’association entre francophonie et France/assujettissement à la puissance coloniale, et plaider pour une francophonie libre, plurielle, extra-hexagonale, représentant avant tout un bien civilisationnel commun.
- Assurer une reconnaissance dans les faits à la pluralité de la francophonie, c’est à dire faire une place à la littérature d’expression française non française à travers les institutions académiques telles que les programmes scolaires, les cursus universitaires ou les prix littéraires.
- Démocratiser, « horizontaliser », ramener au niveau des locuteurs et créateurs la gestion des instances internationales de la francophonie.
- Promouvoir la diversité linguistique dans tous les sens – introduire de la réciprocité et de la symétrie entre les langues, y compris en France où la place de l’arabe maghrébin est sans commune mesure avec la place du français dans le monde arabe maghrébin.
On voit donc quelle « double peine » la France a assigné aux Marocains aujourd’hui francophones : le protectorat leur a à la fois imposé une langue extérieure et un agent de stigmatisation, voire de dissension culturelle et politique du fait de l’usage « déviant » de cette langue. Dans le même temps, il a jeté les bases d’un déséquilibre durable dans la société, marquée par une fracture linguistique dévastatrice à bien des niveaux, jusqu’ici source d’inégalités et de complexification des politiques publiques.
Indépendamment de cette histoire et de ses prolongements douloureux, le Maroc hérite aujourd’hui de ce bilinguisme de fait, qu’il doit en outre conjuguer avec la présence de nombreuses autres langues sur son territoire et au sein de sa population : amazighe bien sûr mais aussi dialectes arabes, parlers berbères, espagnol hérité de la présence historique et de la proximité du voisin européen dans le nord du pays…
Pour que la « guerre des langues » n’en soit plus une, il semble aujourd’hui essentiel, côté marocain comme côté français, d’adopter l’approche des études linguistiques postcoloniales tel que décrite par Charles Forsdick[29] : « contester le monolingue et subvertir le monoculturel », reconnaître que le contexte national et international d’aujourd’hui nous « condamne » à un dialogue des langues entre elles et à un multilinguisme salutaire, facteur d’intégration et d’avenir partagé.
Caroline Vabret
[1]Données consultables en ligne : https://www.francophonie.org/-Publications-.html
[2]Données consultables en ligne : https://rgph2014.hcp.ma/downloads/Publications-RGPH-2014_t18649.html
[3]Yacine, K. L’œuvre en fragments. Actes Sud, 1986
[4]Marçais, W. « La diglossie arabe », L’Enseignement public – Revue pédagogique, tome 104, 1930
[5]Ferguson, C.A. « Diglossia », Word n° 15, 1959
[6] El Hakmaoui, J. « Après l’Empire, traduire », inSefrioui, K. (dir.). Maroc : la guerre des langues ? En toutes lettres, 2018
[7]Laâbi, A. « Littérature maghrébine et francophonie », Souffles, numéro 18, mars-avril 1970
[8]Memmi, A., Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, Buchet/Chastel, 1957
[9]Laroui, A. in interview à Jeune Afrique, n° 700, 1974
[10]Kilito, A., Je parle toutes les langues, mais en arabe, Seuil, 2013
[11]Taïa, A., Une mélancolie arabe, Seuil, 2008
[13]Sefrioui, K. (dir.). Op. cit.
[14]Calvet, L.-J., Linguistique et colonialisme. Petit traité de glossophagie.Payot, 1974
[16]Laroui, F., Le drame linguistique marocain, Le Fennec, 2011
[17]Tullon, H., « Arabe et français dans le système éducatif marocain et tunisien au tournant du XXIème siècle », in Synergies Tunisie, n°1, 2009
[18]Sefrioui, K. (dir.). Op. cit.
[19]CF entretien avec Arnaud Pannier, attaché de coopération pour le français à Rabat, 14/11/2018
[21]Sefrioui, K. (dir.). Op. cit.
[22]Sefrioui, K. (dir.). Op. cit.
[23]Sefrioui, K. (dir.). Op. cit
[25]Zaganiaris, J. Un printemps de désirs, La croisée des chemins, Essais sur fond blanc, 2015
[26]Alaoui, M. La vérité sort de la bouche du cheval, Gallimard, 2018.
[27]Entretien, in Libération, 1erjuin 2016. Consultable en ligne sur :https://www.liberation.fr/debats/2016/06/01/achille-mbembe-la-france-peine-a-entrer-dans-le-monde-qui-vient_1456698
[28]Laâbi, A. Petites lumières, La différence, 2017
[29]Fordsick, C., « Challenging the Monocultural, subverting the Monocultural : the Strategic Purposes of Francophone Postcolonial Studies », in Francophone Postcolonial Studies, 1 :1 (2003)