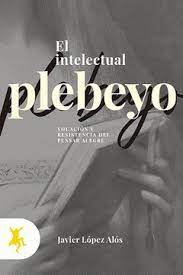Javier López Alós : Pour une écologie de l’écriture
Dans son deuxième ouvrage, El intelectual plebeyo (Taugenit, 2021), le philosophe espagnol Javier López Alós plaide pour une « écologie de l’écriture » fondée sur une éthique de la responsabilité.
L’écriture, au sens d’acte public de raison, a toujours une portée politique plus ou moins explicite. Quand on s’adresse à une communauté avec laquelle on a au moins en partage une langue, un temps et un espace, le message peut être interprété de manières très différentes, touchant parfois l’organisation de cette vie en commun. C’est pourquoi nous parlons de contenu politique lorsqu’un discours se présente explicitement comme tel, et d’acte de politisation lorsque nous supposons que la nature ou la vocation de ce discours n’avaient pas ce dessein initial et ont acquis un sens non prévu par l’auteur. Le discours paraîtra plus ou moins légitimement politisé selon qu’il démontre de façon vraisemblable l’incidence effective de ce dont on parle sur notre quotidien de membre de la société.

L’écriture politique telle que nous l’entendons a pour projet conscient et délibéré l’analyse des modalités selon lesquelles nous, êtres humains, vivons dans des organisations sociales complexes et des institutions reflétant les relations de pouvoir, réelles tout autant que souhaitées, et des principes qui les inspirent. L’écriture politique assume donc n’être ni innocente ni neutre, sans être non plus partisane ou partiale. Mais elle veut explicitement intervenir et participer à la transformation des conditions politiques et sociales dans lesquelles elle s’inscrit. En ce sens, elle est aussi une forme d’action politique, et peut être jugée sur ses résultats et de ses conséquences.
Du principe d’égalité au principe de responsabilité
Les actes politiques sont en général définis par deux paramètres : leurs intentions (en lien avec le champ des valeurs) et leurs conséquences (pouvant elles-mêmes constituer des valeurs, renforcer celles qui existent ou les affaiblir). La continuité entre ces deux facteurs permet d’identifier des éléments tels que le réalisme, la cohérence ou l’efficacité. De même pour l’écriture politique : un premier niveau d’analyse concerne les idées proposées au débat public, et un autre l’efficacité pratique du message pour la diffusion de ces idées. L’écriture étant un acte de communication, l’écriture politique perd toute utilité quand elle échoue sur ce plan. Car, au fond, l’écriture politique veut persuader autrui de ce qu’il est bon de faire dans un objectif commun, et ne peut obtenir d’action volontaire sans persuasion – ce qui est impossible si elle n’est pas comprise ; or, comme nous le verrons, il ne suffit pas d’être clair. Mais jusqu’où cela importe-t-il ? Est-il important que les lecteurs comprennent ce que d’autres écrivent sur la politique ? Quels lecteurs ? Quelle politique ? Et pourquoi n’est-il pas suffisant d’être clair ?
Il y a bien des manières d’écrire sur la politique, mais le choix se réduit quand on se demande, à propos du caractère politique d’un écrit, s’il entend influer sur la réalité à laquelle il se réfère. Dans une certaine mesure, on pourrait affirmer, dans ce contexte, qu’il y a une affinité élective entre l’idée d’écriture et l’idée de politique. Comme je l’ai déjà dit dans l’introduction à propos de la clarté, je ne parle pas de la difficulté du sujet ou du fait que le style soit plus ou moins facile à comprendre. Je parle d’un lien formel et pré-linguistique, qui dépasse la matière spécifique de ce qui est dit, et qui présuppose fondamentalement la présence d’un autre lecteur auquel nous attribuons certaines caractéristiques. Nous l’avons déjà un peu évoqué : une politique émancipatrice dont l’égalité est non pas un simple horizon, mais la raison d’être, devrait en toute logique prendre une forme qui confère au destinataire des capacités similaires à celles de l’émetteur. Nous savons pourtant que de telles capacités ne se matérialisent pas sans conditions ni en toutes circonstances, et que leur actualisation dépend dans une large mesure de facteurs sociaux. Réduire l’impact de ces facteurs est au cœur de l’égalité et de la justice, pour une politique de progrès social.
C’est au fond ce potentiel que reconnaît l’hypothèse anthropologique de l’égalité des êtres humains. Au-delà des variables naturelles, le principe d’égalité reconnaît à tous les êtres humains la capacité de construire leur propre jugement. Qu’ils le fassent avec plus ou moins de succès est une autre question : il faut souligner que l’idéal émancipateur tend justement à augmenter, en créant les conditions de vie nécessaires, le nombre de ceux qui peuvent se permettre d’avoir un jugement autonome[1].
Traiter l’autre en égal ne revient pas à supposer qu’il a la même formation, les mêmes centres d’intérêt, les mêmes lectures ou les mêmes références dans sa vie et sa culture – cela reviendrait à s’adresser à son reflet dans le miroir. Dans le monde académique, par exemple, c’est qu’on le veuille ou non une pratique qui fait sens précisément parce qu’on présuppose une petite communauté de pairs spécialisés. En revanche, l’intervention politique touche de larges espaces indéterminés, d’une composition très hétérogène. Ici, l’égalité des capacités ne désigne pas quelque chose d’existant, mais une potentialité à réaliser dans le futur… mais aussi dans le présent, à travers un discours performatif. Ce dont il s’agit, c’est de reconnaître la capacité d’autrui à identifier et comprendre ce qui est le mieux pour soi et pour sa société et, au-delà, pour les autres société et la planète dans son ensemble.
La politique articule ce jeu de coïncidences et de désaccords. Dans les conflits d’intérêts, ceux des individus, des différents niveaux d’association, ainsi qu’entre eux-mêmes, se jouent des questions cruciales : celle de la responsabilité, dont nous avons déjà parlé et qui est au cœur de ce que Hans Jonas a appelé « l’impératif écologique »[2] que nous appliquerons à notre domaine particulier.
L’écologie de l’écriture
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la nécessité de prendre en compte les conséquences de nos actes. En effet, chaque action laisse toujours une empreinte plus ou moins perceptible dans un environnement donné, souvent plus large que prévu. Il n’existe heureusement pas d’écriture claire à cent pour cent, prête à être recyclée et réincorporée dans un cycle infini de renouvellement. Cela ne serait possible qu’en annulant le sens de l’écriture et du langage en général, pour les réduire à de la matière inerte, à une simple énergie à disposition. Ou alors en confondant le sens du langage avec sa transparence, comme si le sens s’y nichait, prêt à être reconnu, considéré et traité, traversé par nous plutôt que nous par lui. C’est-à-dire qu’il serait, là aussi, complètement à la merci de nos décisions d’usage, sans la moindre résistance.
Mais l’écriture a ses lieux de friction et ses obstacles. Et surtout des vestiges, beaucoup de vestiges, impossibles à éliminer ou à contrôler. Ce n’est pas pour rien que beaucoup échappent à notre conscience. Toute écriture soulève des difficultés certes liées à son rapport à la langue, mais qui ne s’y limitent pas. Exprimer ce que nous voulons dire exactement, voire n’exprimer que ce que nous voulons dire en éliminant les excroissances linguistiques qui entravent notre discours, est déjà bien complexe. Mais il y a plus.
Un élément essentiel, auquel nous avons indirectement fait allusion, constitue l’autre pôle de l’écriture : la lecture. Ou, plutôt, une prévision singulière et impossible de la lecture. Quiconque écrit doit accepter qu’il ne sait pas qui le lira, ni comment, ni quand, ni pourquoi, ni dans quel but. Ni quelles seront les conséquences de cette lecture, donc de l’écriture elle-même.
Le désir de clarté que nous avons défendu plus haut n’est pas le désir de transparence. C’est précisément parce que l’écriture ne pourra jamais être transparente que la seule chose que l’on puisse faire en toute humilité, c’est d’essayer d’écrire aussi clairement que possible, ce qui sera toujours insuffisant. Cela, il faut aussi l’accepter, de la même manière que tout ce qu’on a voulu dire ne sera pas compris : parce qu’en fin de compte, l’auteur n’a pas (loin de là) le contrôle total de ce qu’il dit et que, même à un faible niveau de complexité, il n’est absolument pas certain de ce qu’il a voulu dire. Par conséquent, il sera parfois moins bien compris, des vestiges de discours restant à l’abandon. Cette inattention, contrairement à ce que lui fait croire sa vanité d’écrivain, n’est pas forcément négative, car elle permet aussi de passer sur les incorrections, les contradictions ou les faiblesses de l’argumentation que l’œuvre peut contenir. D’autres fois, la lecture permet de découvrir plus de choses, que l’auteur ne soupçonnait pas voire ne voulait pas vraiment dire, tantôt comme des vestiges inconsciemment laissés en cours de route, tantôt comme de purs apports résultant de l’intervention du lecteur.
On peut donc en conclure que tout acte linguistique (en ce qui nous intéresse ici, l’écriture et la lecture) contient une ambivalence radicale, puisqu’il produit surplus et manque dans une même opération, parfois simultanément. En effet, il y a un écart entre le sens originel voulu et le résultat de son expression. À son tour, l’expression elle-même génère de nouvelles significations et associations, en bloque, en efface ou détourne d’autres. Comment ? S’il ne s’agit pas d’un pur processus autopoïétique, ni tout à fait conscient ni tout à fait inconscient, dans quelle mesure est-il influencé par les conditions d’écriture ? Et inversement, comment l’écriture agit-elle sur ces conditions, sur l’environnement dans lequel elle se déploie, ainsi que celle d’autrui ? Voici une autre raison de penser une écologie de l’écriture comme partie prenante d’une écriture politique. Nous allons maintenant développer ce point, mais arrêtons-nous un instant sur d’autres facteurs en jeu.
On peut penser un environnement de communication de multiples manières. Je plaide ici pour le faire selon un impératif écologique, engagé pour la vie d’autrui : qui promeut ou préserve les conditions permettant aux autres de parler, non pas de façon occasionnelle ni sur le mode de l’exutoire éventuel, ce qui est possible aussi, mais pour faire publiquement usage de leur raison. En général, quand nous pensons la relation entre écriture et environnement, nous ne faisons référence qu’à un ensemble de préférences personnelles quant à l’acte, physique ou mécanique, d’écrire. Nous parlons par exemple des conditions de lumière, de bruit, de mobilier, de lieu et de temps. Ou alors nous nous intéressons à l’influence du contexte politique, social ou idéologique sur la production intellectuelle. L’histoire des intellectuels est aussi une histoire de revendication d’influence en sens inverse[3] : comment impulser et guider la transformation de l’environnement social. Mais c’est autre chose que je veux souligner ici par ces considérations sur l’écologie de l’écriture : comment, sur une scène de raison publique, ce que nous écrivons peut continuer à rendre possible notre propre écriture et celle d’autrui.
L’impératif écologique de l’écriture
L’impératif écologique de l’écriture pourrait être formulé ainsi : écrivez de manière à ce que vos actes d’écriture soient compatibles avec ceux des autres. En particulier, écrivez sur les autres avec le même respect et la même clarté que vous revendiquez pour vous-même et en reconnaissant que leur dignité personnelle est indépendante de la valeur de ce qu’ils disent. En fin de compte, il s’agirait d’assumer les conséquences de ses interventions discursives : ne jamais accepter la falsification ni la disqualification publique de qui que ce soit, si erronées soient ses déclarations. La seule exception, me semble-t-il, devrait être les cas de mauvaise foi manifeste et de mensonge intentionnel. Nul n’est à l’abri de l’erreur ou de la faute, mais l’action délibérée, c’est autre chose.
L’intervention publique, surtout lorsque certains de ses effets sont prévisibles, ne peut en aucun cas se fonder sur la fabrication de fausses prémisses, sur des sophismes ni sur la manipulation de données. De tels comportements détruisent la confiance et la présomption de bienfaisance indispensables à ce qu’un groupe de personnes accorde son temps et son attention au jugement d’autrui. Dans ces cas-là, ce n’est pas le contenu du discours qui est en cause, ni la capacité ou la préparation du sujet, mais la violation de ce principe de base. En fin de compte, dans la plupart des cas, l’erreur ou l’inadvertance peut être corrigée : c’est à cela que tend le travail de l’intellectuel, individuellement et collectivement. La falsification, en revanche, s’apparente à une manœuvre pour perpétuer l’erreur en la dissimulant. C’est pourquoi elle constitue une exception au précepte écologique de non-exclusion : de fait, l’exclusion ne vise pas les idées, mais les dommages que toutes les opérations visant à avancer celles-ci infligent à une communauté qui lui prête attention et lui fait confiance.
Ces quelques remarques peuvent renvoyer à des circonstances bien connues de beaucoup. Ont-elles déjà été formulées plusieurs fois ou pas du tout, là n’est pas la question. L’essentiel, c’est ce que nous faisons de ce que nous savons et comment nous mettons cette connaissance en rapport avec d’autres phénomènes et d’autres problèmes. Si j’y fais référence dans le cadre de cette réflexion sur une possible écologie de l’écriture, c’est précisément parce que cela fait partie de ce que l’on pourrait appeler « la nature de l’écriture », qui se développe également dans un habitat relativement concret et en cohabitation avec d’autres individus. Il n’est pas inutile de le rappeler. En d’autres termes, je crois que l’oubli des limites et des obstacles à tout acte d’écriture (et de lecture aussi, bien sûr) est à l’origine de bien des actes d’arrogance intellectuelle et de dogmatisme que nous commettons si souvent dans les sphères dites culturelles. Prendre en compte la faiblesse constitutive de toute tentative de nature linguistique, voire l’inéluctable précarité de la raison humaine, devrait en fait, me semble-t-il, susciter assez spontanément des comportements plus raisonnables et plus durables. Il ne s’agit pas d’un appel à l’humilité, vertu dont on sait que l’invocation cache souvent la plus grande pédanterie. Reconnaître ces limites est plutôt un principe de réalité : par essence, son effet n’est pas moral, mais ontologique.
Javier López Alós,
El intelectual plebeyo. Vocación y resistencia del pensar alegre,
chapitre 8, Madrid, Taugenit, 2021, pp. 133-141.
[1] Cette autonomie n’est pas l’indépendance absolue et ne signifie en aucun cas une déconnexion ou une indifférence par rapport au contexte. La question du temps est encore une fois fondamentale : avoir le temps de lire des livres et de les lire en profondeur n’est pas à la portée de tous. Bien sûr, il y a d’autres canaux pour la circulation des idées, mais c’est précisément le livre (un certain type de livre en particulier), pour le temps et la concentration qu’il requiert, qui est devenu le format marqueur des différences sociales. Quelques questions pour l’expliquer : qui a le temps de lire ? qui a le temps de lire des livres ? ceux qui ont le temps et ceux qui ne l’ont pas lisent-ils la même chose ? s’agit-il seulement de différences quantitatives ? des facteurs tels que la précarité et les nouveaux formats influencent-ils notre façon de lire ? peut-on écrire comme si tout cela n’avait aucun effet ?
[2] Jonas, Hans, El principio de responsabilidad : ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelone, Herder, 1995.
[3] Ou la répression de cette volonté.